 «Envelhecemos, e como os velhinhos gostamos das nossas comodidades. Tornou-se um crime ser-se mais e ter-se mais do que os outros. Devidamente privados dos entusiasmos fortes, tomámos em horror tudo o que seja poder e virilidade; a massa e o igualitarismo, são estes os nossos novos deuses. Uma vez que a massa não pode modelar-se pela minoria, que pelo menos o pequeno número se modele pela massa. A política, o drama, os artistas, os cafés, os sapatos envernizados, os cartazes, a imprensa, a moral, a Europa de amanhã, o Mundo de depois de amanhã: explosão de massa. Monstro de mil cabeças à beira dos grandes caminhos, espezinhando o que não pode engolir, invejosa, nova-rica, má. Uma vez mais, o indivíduo sucumbiu, mas não foram os seus defensores naturais os primeiros a traí-lo?»
«Envelhecemos, e como os velhinhos gostamos das nossas comodidades. Tornou-se um crime ser-se mais e ter-se mais do que os outros. Devidamente privados dos entusiasmos fortes, tomámos em horror tudo o que seja poder e virilidade; a massa e o igualitarismo, são estes os nossos novos deuses. Uma vez que a massa não pode modelar-se pela minoria, que pelo menos o pequeno número se modele pela massa. A política, o drama, os artistas, os cafés, os sapatos envernizados, os cartazes, a imprensa, a moral, a Europa de amanhã, o Mundo de depois de amanhã: explosão de massa. Monstro de mil cabeças à beira dos grandes caminhos, espezinhando o que não pode engolir, invejosa, nova-rica, má. Uma vez mais, o indivíduo sucumbiu, mas não foram os seus defensores naturais os primeiros a traí-lo?»
Ernst Jünger
in “A Guerra como Experiência Interior”, Ulisseia (2005).
jeudi, 22 janvier 2009
Henri DE MAN: Souvenir d'Ernst Jünger

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES / VOULOIR (Bruxelles) - Juillet 1995
Souvenir d'Ernst Jünger
Henri DE MAN
J'ai toujours trouvé le roman allemand, dans son ensemble, très inférieur aux romans français, anglais, russes, américains ou scandinaves. Ceci vaut, à plus forte raison, pour la nouvelle, qui exige plus encore les qualités d'objectivité et d'ordonnance concentrée qui sont à l'opposé de celles qui font le génie allemand. Le Faust de Gœthe n'a son équivalent dans aucune littérature, et il ne se passe guère deux ans sans que je le relise; par contre, l'Allemagne n'offre rien de comparable à Stendhal, Thackeray, Tolstoï, Poe ou Björnson; moins encore à Maupassant ou Tourguenieff.
Cette opinion est depuis si longtemps ancrée en moi qu'une espèce de parti pris me retient de m'intéresser à n'importe quel livre de "fiction" en allemand. Pourtant, au cours de ces trois dernières années, deux fois le hasard m'a fait faire une exception, et deux fois j'eus lieu de m'en réjouir. D'abord, le hasard d'un cadeau reçu me fit connaître Emil Strauss, dans des nouvelles d'une grande sensibilité et d'un style impeccable. Ensuite, le hasard d'une rencontre avec l'auteur —le Capitaine Ernst Jünger, avec qui je passai une soirée chez des amis à Paris— m'amena à lire son dernier livre paru, Gärten und Strassen (paru en traduction française, je crois, sous le titre Routes et Jardins). Depuis longtemps, je n'avais plus lu de livre qui m'eut fait autant de plaisir, et qui m'eût été plus sympathique. Et d'abord, il est d'une forme très soignée. C'est chose rare en Allemagne, ou il se publie beaucoup de livres pleins de substance, mais mal écrits, à l'opposé de la France, qui est inondée de livres bien écrits mais creux. La phrase est ciselée avec un sens du rythme qui est presque poétique, et qui surprend d'autant plus agréablement qu'il s'agit de prose authentique, concise, précise, transparente.

Quant au contenu, j'ai trouvé dans ce journal qui chevauche sur la fin de la paix et le début de la guerre —d'avril 1939 à fin juillet 1940— le reflet d'une personnalité que j'avais déjà trouvée singulièrement attachante en chair et en os. Ernst Jünger est fils d'un apothicaire hanovrien; et on n'est pas plus Allemand du Nord, ni plus fils de son père. Un petit homme blond, maigre et sec, à l'aspect réticent, qui parle posément et doucement; qui dès son entrée dans une pièce s'en va flairer l'atmosphère et fureter du côté des bibelots, qu'il palpe de ses doigts presque caressants; qui parle des choses les plus profondes comme des plus banales avec le même souci de justesse et d'économie dans l'expression, comme un professeur de mathématiques qui exposerait un théorème.
Cependant cet homme à l'aspect timide et placide est un grand soldat et un grand poète. Pendant la première guerre mondiale, il accomplit tellement d'actions d'éclat qu'il se trouva être le seul lieutenant d'infanterie a obtenir l'Ordre Pour le Mérite, la plus haute distinction de l'Empire; et en 1939, il saisit l'une des rares occasions qui se présentèrent sur le front du Rhin pour mériter une nouvelle croix de fer. Pourtant, son journal de guerre n'a rien d'une Chanson de Roland; ce sont les annotations, au jour le jour, d'un officier qui aime le service, certes, comme on aime un devoir, mais qui aime surtout ses hommes. D'ailleurs, il reste homme lui-même au point de s'intéresser à tout ce qu'il voit, même et surtout aux choses qui n'ont aucun rapport avec le drame dont il est témoin avant que d'en être acteur. Ainsi, il parle de ses contacts avec des civils ou des prisonniers français, comme de ceux avec des militaires allemands, d'une façon qui fait oublier qu'il s'agit de deux nations en guerre. Et il ne manque aucune occasion de sacrifier à sa passion d'entomologiste en se livrant, surtout en forêt, à ce qu'il appelle la "chasse subtile".
Ce qu'il y a en moi de l'ancien officier s'est réjoui de trouver, dans les confidences de ce capitaine allemand, une étonnante similitude de réactions et de conceptions quant à la grandeur et la servitude militaires. Son récit fourmille de traits —notamment à propos de la discipline, du moral de la troupe, de l'éthique de la guerre, des réactions psychologiques en général— qui correspondent tellement à ma propre expérience que j'aurais voulu pouvoir les exprimer à sa place, et aussi bien. Jünger dit à ses soldats que quand ils trouvent dans une maison abandonnée des cuillers dont ils ont besoin, ils peuvent en prendre une; mais s'il y en a en argent et en étain, ils doivent se contenter de la cuiller d'étain. Quand il quitte la cure d'un village ardennais où il avait été cantonné, le curé dit qu'il est triste de devoir se séparer quand on commence à peine à se connaître; Jünger commente simplement: "Cela me fit plaisir; dans les cantonnements, je m'en vais toujours un peu à la chasse aux hommes". Sur le même thème, cette méditation: "Le rapport entre le logeur et le soldat est particulier, en ce qu'il est encore régi, comme le droit sacré d'asile, par les formes de l'hospitalité primitive, que l'on accorde sans égard de personne. Le guerrier a le droit d'être l'hôte dans n'importe quelle maison, et ce privilège est l'un des plus beaux que confère l'uniforme. Il ne le partage qu'avec les poursuivis et les dolents".
A propos d'une femme qui se lamente près du cadavre de son mari: "De cette façon, on apprend à connaître aussi l'effet indirect des projectiles, qui sans cela échappe au tireur. La balle touche beaucoup de gens; on voit tomber l'oiseau et on se réjouit de voir s'éparpiller les plumes; mais on ne voit pas les œufs et les jeunes et la femelle dans le nid où il ne retourne plus". Dans Laon abandonné où il a été détaché avec sa compagnie pour y improviser une Kommandantur, il va installer des gardes dans les bâtiments les plus exposés au pillage. Aux archives, il se plonge dans la lecture des autographes, où il trouve notamment des lettres du Maréchal Foch. "On les avait jointes au moyen d'une épingle, selon la manière déplorable des bibliothécaires français; l'épingle ayant taché le papier de sa rouille, je me suis permis de l'enlever". Il ne s'agit dans tout cela que de détails quelquefois infimes, mais toujours significatifs. Le détail significatif est d'ailleurs la méthode d'évocation employée dans ce livre, et qui fait son charme.
Après avoir rencontré Ernst Jünger d'abord, lu son livre ensuite, je me suis surpris à penser: "Toi, je voudrais t'avoir presque indifféremment sous moi comme officier subalterne, au-dessus de moi comme chef, ou en face de moi comme adversaire". Je sais fort bien ce que pareille pensée comporte d'atroce; mais je sais aussi que pour beaucoup d'hommes qui ont fait la guerre, elle ne sera que trop compréhensible. La guerre est un destin contre lequel on peut se révolter, mais que l'on ne peut pas fuir; et le droit à la révolte n'appartient qu'à ceux qui n'ont pas esquivé le devoir. Le pacifisme est un titre que les hommes de ma génération n'auront pu, pour leur malheur, conquérir qu'en combattant.
Je viens de dire que j'aime presque autant m'imaginer Jünger en face de moi que du même côté. Réflexion faite, je crois que l'expression a quelque peu dépassé ma pensée. Je me souviens qu'en causant avec lui, je lui demandai sur quels fronts il avait combattu de 1914 à 1918: or. après avoir constaté qu'il n'avait jamais pu me faire face, je me sentis indubitablement soulagé. Et il me vint soudain à la mémoire une bribe d'un poème, appris jadis par cœur à l'école:
" Ah ! que maudite soit la guerre
Qui fait faire de ces coups-là ! "
Cette malédiction est la conclusion à laquelle je voulais principalement arriver.
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, lettres allemandes, littérature allemandes, lettres, littérature, deuxième guerre mondiale, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 janvier 2009
Walter Flex: une éthique du sacrifice au-delà de tous les égoïsmes

Robert STEUCKERS:
Walter Flex: une éthique du sacrifice au-delà de tous les égoïsmes
Né à Eisenach en 1887, Walter Flex a grandi dans une famille de quatre garçons: son frère aîné, Konrad, qui a survécu à la tourmente de la guerre, et deux cadets, Martin, qui mourra des suites de ses blessures et d'une pneumonie en 1919, et Otto, qui tombera en France en 1914. Son père décèdera en juillet 1918 et sa mère en octobre 1919. Konrad Flex, seul survivant de cette famille unie, préfacera en 1925 les deux volumes des œuvres complètes de son frère. Le père Rudolf Flex était un grand admirateur de Bismarck; esprit religieux, mais éloigné des églises, il est un croyant plus ou moins panthéiste, proche de la nature, qui s'engage résolument dans un combat politique national-libéral, pétri de l'esprit du «Chancelier de Fer». A l'occasion, Rudolf Flex rédige des poèmes ou des petites pièces de théâtre d'inspiration nationale, que jouent en partie sa propre femme et ses enfants. Homme du peuple, issu de lignées de paysans et d'artisans, parfaitement au diapason de ses concitoyens, Rudolf Flex s'intéresse au dialecte d'Eisenach, sur lequel il publie deux petits travaux de philologie. Sa mère, née Margarete Pollack, lui transmet un héritage plus précis, bien qu'hétérogène à première vue: enthousiasme pour l'aventure prussienne et l'éthique qui la sous-tend, religiosité encadrée par l'église évangélique, culte du premier empereur Hohenzollern. Dans la transmission de cet héritage, explique Konrad Flex, il n'y a aucune sécheresse: Margarete Pollack-Flex possède les dons de l'imagination et de la narration, assortis d'une bonne culture littéraire. La mère des quatre frères Flex a de nombreuses activités publiques dans les œuvres de bienfaisance de la ville d'Eisenach, notamment dans les associations caritatives placées à l'enseigne du roi de Suède, Gustave-Adolphe, champion de l'Europe septentrionale protestante au XVIIième siècle. Cet engagement social dans le cadre protestant-luthérien montre l'impact profond de ce protestantisme national dans le milieu familial de Walter Flex. Les associations caritatives protestantes tentaient de faire pièce à leurs équivalentes catholiques ou socialistes. Pendant la guerre, Margarete Pollack-Flex s'est engagée dans les associations qui venaient en aide aux soldats revenus du front.
Konrad Flex conclut: «L'intérêt pour les choses de l'Etat et pour l'histoire, la volonté d'œuvrer dans les affaires publiques, la volonté de créer une œuvre littéraire, de dominer la langue par la poésie, l'humour, le talent d'imiter les paroles des autres et le sens des arts plastiques sont des qualités que Walter Flex a essentiellement hérité de son père; en revanche, sa mère lui a légué cette pulsion décidée et consciente d'accomplissement de soi et de négation de soi dans un cadre éthique, un sens aigu de l'observation de soi, l'imagination, le talent narratif, la pensée abstraite, un intérêt fort motivé pour la philosophie et, dans une moindre mesure, le souci des questions sociales».
Le jeune Walter Flex rédigera très tôt, à onze ans, ses premiers poèmes et sa première pièce de théâtre. Son tout premier poème fut rédigé à l'occasion du décès du Prince Bismarck. Pendant la guerre des Boers, il a pris passionnément le parti des colons hollandais, allemands et huguenots en lutte contre l'armée britannique. Ce sera encore l'occasion de quelques poèmes. A dix-sept ans, une petite pièce de théâtre, intitulée Die Bauernführer (Les chefs paysans) est jouée dans son Gymnasium et connaît un indéniable succès. Un peu plus tard, le lycéen Walter Flex rédige un drame plus élaboré, Demetrius, basé sur une des thématiques les plus poignantes de l'histoire russe, débutant par la mort mystérieuse de Dmitri, fils d'Ivan le Terrible, vraisemblablement assassiné; à la suite de la mort de ce dernier descendant direct du chef varègue Rurik, trois faux Dmitri revendiquent successivement le trône occupé par Boris Goudounov, plongeant la Russie dans une suite ininterrompue de guerres civiles au début du XVIIième siècle. La version définitive de ce drame de Walter Flex ne paraîtra que quelques années plus tard, quand il sera à l'université. Le Théâtre de la Ville d'Eisenach le jouera en 1909.
Après le Gymnasium, il étudiera la philologie germanique et l'histoire à Erlangen et à Strasbourg entre 1906 et 1910. Pendant ses années d'études, il adhérera à une corporation d'étudiants, la Bubenruthia. Malgré un handicap à la main droite, qui le forçait à être gaucher, il était bon en escrime et redouté par ses challengeurs dans les duels traditionnels des étudiants allemands (la Mensur). Le 31 octobre 1910, il défend son mémoire sur «le développement de la problématique tragique dans les drames allemands sur la thématique de Demetrius, de Schiller à aujourd'hui».
De 1910 à 1914, il deviendra le percepteur des enfants de la famille Bismarck. D'abord de Nicolas de Bismarck, puis de Gottfried et Wilhelm. Outre cette fonction de précepteur, il assume la tâche de ranger et de classer les archives de la famille. Ce qui lui donne l'occasion de rédiger sa nouvelle historique Zwölf Bismarcks (= Douze Bismarcks) et sa tragédie Klaus von Bismarck. Ces ouvrages paraissent en 1913; la tragédie est jouée la même année au Théâtre de la Cour à Cobourg en présence du Duc. Ces récits sont pour l'essentiel pure fiction; il ne s'agit donc pas d'une chronique sur la famille Bismarck mais l'intention de l'auteur est de camper des profils psychologiques, qui affrontent le réel, le modèle selon leurs canons éthiques, politiques ou esthétiques ou connaissent l'échec en restant stoïques. En 1913, il publie également Die evangelische Frauenrevolte in Löwenberg (La révolte protestante des femmes à Löwenberg), au profit de la Gustav-Adolf-Frauenverein (Association féminine Gustav-Adolf) que présidait sa mère.
Ensuite Walter Flex devient précepteur des enfants du Baron von Leesen à Retchke en Posnanie. C'est là qu'il se trouve quand éclate la guerre en août 1914; il se porte tout de suite volontaire, en dépit de sa légère infirmité à la main droite qui l'avait auparavant dispensé du service militaire. Armé de ses convictions éthiques et stoïques, il se jure de mobiliser tous ses efforts pour vaincre les résistances du terrain, de la souffrance, de ses faiblesses physiques. Il demande à servir dans l'infanterie. Soldat-poète, ses vers enthousiasmeront ses contemporains, engagés sur tous les fronts d'Europe. Walter Flex combattra d'abord sur le front occidental, dans la Forêt d'Argonne. C'est le 3 octobre 1914 qu'il pénètre sur le territoire français avec son régiment. Il écrit, le 5, à ses parents: «Au moment où, avant-hier, nous franchissions la frontière française, il y avait un magnifique clair de lune à trois heures du matin. Nous pensions à la scène du Serment de Rütli dans le récit de Guillaume Tell et nous nous en sommes réjouis. Hier nous avons eu une longue marche, que je n'ai pas trouvé extraordinaire; nous avons pris nos quartiers de nuit dans la paille d'une écurie: au-dessus de nous un ciel tout éclairé par la lune que nous contemplions à travers le trou percé dans le toit par un obus. Du côté des hauteurs devant nous, vers lesquelles nous marchions, nous entendions le fracas des canons et le crépitement des fusils. Pendant la nuit nous pouvions apercevoir le bombardement de Verdun. Au-dessus des collines, des ballons captifs. Hier soir, j'ai passé la soirée autour d'un feu avec trois femmes françaises, heureuses d'entendre quelqu'un leur parler dans leur langue; elles me répétaient sans cesse: nous aussi nous serons Allemands».
Le 7 octobre, toujours dans une lettre à ses parents, sa philosophie générale de la guerre se précise: «Nos souffrances sont très grandes, mais c'est un sentiment sensationnel d'engager ses forces dans la lutte de notre peuple pour son existence». Quelques jours plus tard: «Le froid des nuits dans les hauteurs ardennaises nous transperce les os quand on est couché en plein champ ou dans les tranchées. Malgré cela, c'est un sentiment extraordinaire de se sentir membre de cette fraternité de fer qui protège notre peuple». Jamais la tendresse n'est absente quand il écrit à sa mère: «Très chère maman! Hier je t'ai envoyé trois violettes cueillies devant nos tranchées, et la première chose que je reçois aujourd'hui et qui m'illumine de joie, c'est ton cher courrier de campagne qui contient trois petites violettes d'Eisenach. N'est-ce pas l'adorable symbole de notre communauté de cœur?». A la veille de Noël, le 17 décembre 1914, nous trouvons cette première réflexion importante sur la mort, suite à la disparition de son jeune frère Otto: «Je pense que, réunis tous en cette veillée sacrée à Eisenach, vous lirez ma lettre. Pour nous tous, c'est un jour grave, difficile, mais qui reste beau tout de même. Comme moi, vous penserez à notre Petzlein (= Otto) et à toutes les touchantes transformations qu'a connues ce jeune être de vingt ans, vous penserez tantôt au bambin en tablier tantôt au jeune randonneur aux yeux graves, intelligents et bons, et il sera presque vivant au milieu de la pièce où vous célèbrerez la Noël. Mais ces souvenirs ne doivent pas nous affaiblir. Nous devons rester modestes et savoir que, nous les vivants, ne pourrons jamais voir, avec nos sens amoindris et malhabiles, la dernière et sans doute la plus belle des mutations de l'être aimé, mutation qui l'a arraché à notre cercle et l'a placé au-dessus de nous, sans pour autant mettre fin aux effets qu'il suscite encore en nous et par nous. Sans doute ceux que nous appelons les morts ressentent-ils l'état dans lequel nous nous trouvons, nous, les vivants, comme un état antérieur à la naissance et ils attendent que nous venions, après eux, à la vraie vie. La mort et la naissance ne me semblent pas être en opposition, mais sont comme des stades supérieur et inférieur dans le développement de la vie... Ceux qui sont tombés pour le soleil de leur terre et pour protéger la joie des générations futures ne veulent pas que nous les trahissions par des deuils qui ne sont indices que de nos faiblesses, des deuils qui ne pleurent que la part que nous aurions pu avoir dans les moissons de leur vie. Une douleur sans limite est si terne, si dépourvue de vie, alors que nos chers morts sont tombés pour que nous soyions forts en nos cœurs et en nos œuvres. Nous n'avons pas le droit de regarder l'éclat des bougies de Noël avec les yeux embués de larmes, parce qu'elles nous renvoient comme le reflet d'une âme aimée, lointaine mais tout de même si proche!...».
Au printemps de 1915, Walter Flex est envoyé au Warthelager (Le Camp de la Warthe), pour y subir une formation d'officier. C'est là qu'il rencontrera Ernst Wurche. L'été venu, le climat plus clément, Walter Flex écrit à ses parents, le 2 juin, cette lettre qui exprime la joie de la vie militaire en campagne sur le Front de l'Est, avec des mots d'une simplicité qui étonne, où l'éternité des choses de la nature semble primer par rapport au cataclysme guerrier qui embrase l'Europe d'Ouest en Est. Cette lettre du 2 juin 1915 est aussi la première qui fait mention de Wurche: «C'est en direction de cette languette de terre, à l'Ouest [du Lac Kolno], que j'ai commandé une patrouille il y a quelques jours; j'ai brisé la résistance d'un détachement russe de 23 hommes avec mes quatre gaillards; j'ai personnellement capturé un Yvan dans le marais; il nous a communiqué des renseignements intéressants. Le pistolet Mauser qui j'ai acheté avec notre chère maman m'a donc porté bonheur. Je me sens très heureux dans ma nouvelle position et, sans doute, ce moment est-il le plus heureux de ma vie. Cette nuit, j'ai occupé une nouvelle position avec mon peloton; elle doit encore être aménagée. Je viens d'instruire mon état-major de chefs de patrouille des plans de travail et j'ai réparti les postes. Dans mon dos, il y a un petit pavillon d'été non encore entièrement construit, que je pourrai sans doute occuper dès demain. Cette nuit, j'ai servi de pâture aux moustiques dans la forêt. Parmi mes hommes, il y a beaucoup de gars bien, utilisables, beaucoup sont de Rhénanie et, quand ils parlent, ils me rappellent Bonn et notre cher Petzlein. Mon ordonnance Hammer est lui aussi Rhénan, c'est un garçon jardinier fort habile qui aménage tout autour de moi avec grand soin et beaucoup de complaisance. Un jour, il m'a dressé une table de jardin sous de hauts sapins, et c'est là que je suis en ce moment et que je vois le soleil et les moustiques jouer au-dessus du marais et de la forêt... Avec moi, il y a un Lieutenant issu de Rawitsch —Wurche— détaché par les “50” à la même compagnie, c'est un fameux gaillard, dont j'apprécie beaucoup la présence. Ne vous faites pas de souci pour moi. J'aime vous raconter des petites choses et d'autres sur mon vécu quotidien et je sais que je puis le faire sans vous inquiéter».
Le 24 août, Flex a le pénible devoir d'envoyer une lettre aux parents du Lieutenant Wurche, annonçant la mort de leur fils au combat. «Jamais je n'ai tant eu de peine à écrire une lettre mais j'ai demandé au chef de compagnie de votre cher fils de me permettre d'être le premier à vous écrire et à vous dire ce que Dieu vient d'infliger à votre famille. Car je voulais que l'annonce de la mort héroïque de votre garçon, si formidable, si bon, soit faite par un homme qui l'aimait. Depuis la mort de mon propre frère cadet, il y a presque un an, rien ne m'a touché aussi profondément que la mort de votre fils, mon excellent ami, de cet homme fidèle et droit, chaleureux et sensible à l'égard de tout ce qui est beau et profond. Mais permettez-moi de vous dire que, après sa mort, quand je me suis agenouillé pour prendre longuement, silencieusement, solitairement congé de lui, et que j'ai regardé son visage pur et fier, je n'ai eu qu'un seul souhait pour ses parents: s'ils pouvaient le voir couché comme je le vois, ils accepteraient plus sereinement leur douleur. En effet, leur fils Ernst avait toujours su susciter de la joie en mon cœur le plus profond parce que ses sentiments étaient toujours d'une exceptionnelle clarté, parce qu'il ignorait la peur qui tenaille si souvent les hommes et parce qu'il était toujours prêt en son âme à accepter tous les sacrifices que Dieu et sa patrie lui auraient demandés. Et le voilà étendu devant moi, il avait consenti au sacrifice suprême et ultime et sur ses traits jeunes, je lisais l'expression solenelle et formidable de cette sublime disposition d'âme, de ce don de soi, reposant dans la volonté de Dieu. Nous, votre cher fils et moi-même, nous nous trouvions la nuit dernière, chacun à la tête de nos services de garde respectifs, séparés par une distance d'environ trois kilomètres, sur les hauteurs bordant le lac, à Simno, à l'Ouest d'Olita. Soudain, le téléphone de campagne de la dixième compagnie, à laquelle il avait été très récemment affecté, m'apprend que le Lieutenant Wurche est tombé face à l'ennemi en effectuant sa patrouille. J'ai attendu, le cœur complètement déchiré, pendant toute cette longue nuit, parce que je ne pouvais pas abandonner mon poste, et, enfin, peu après quatre heures du matin, à bord d'une charrette russe, j'ai pu me rendre à Posiminicze, où il était basé en tant que responsable de la garde et où l'on avait ramené son corps. Une main devait l'amener au repos éternel, une main appartenant à quelqu'un qui l'aimait d'un amour fraternel, sans qu'il n'en soit sans doute entièrement conscient. C'est alors que je me suis trouvé devant lui, que j'ai vu la fierté tranquille et la paix dominicale de son visage pur et que j'ai eu honte de ma douleur et de mon déchirement.
Ernst était parti en patrouille pendant la nuit, pour aller voir à quelle distance s'étaient retirés les Russes qui fléchissaient et abandonnaient les positions qu'ils occupaient face à nous. Il a rampé seul, selon son habitude de chef de s'engager toujours en tête, il a avancé ainsi à 150 mètres devant ses hommes face à une position russe, dont ne ne savions pas si elle était encore occupée ou non. Une sentinelle ennemie l'a remarqué et a aussitôt fait feu sur lui. Une balle lui a traversé le corps, en lacérant plusieurs grosses veines, ce qui a provoqué la mort en peu de temps. Ses hommes l'ont ramené de la ligne de feu. Quand ils le portaient, l'un d'eux lui a demandé «Ça va ainsi, mon Lieutenant?». Il a encore pu répondre, calme comme toujours, «Bien, très bien». Il a alors perdu connaissance, et est mort sans souffrir.
Ce matin, je me suis hâté d'arriver à Posiminicze, afin de faire préparer sa tombe de héros, sous deux beaux tilleuls dressés devant une ferme lettone, se trouvant dans un petit bois à l'Ouest du Lac de Simno. Dans la tombe toute bordée de verdure, je l'ai fait descendre, portant tout son équipement d'officier, avec son casque et sa baïonnette; dans la main je lui ai glissé une grande tige de tournesol, avec trois belles fleurs dorées. Sur le petit monticule recouvert de gazon, se dressent une autre fleur de tournesol et une croix. Sur celle-ci figure l'inscription: “Lieutenant Wurche, R.I. 138, mort pour la patrie, le 23.8.1915”. Enfin, sur la croix, j'ai accroché une couronne tressée de cent fleurs aux couleurs éclatantes; pour la confectionner, ses hommes ont pillé tous les parterres des paysans lettons. Votre Ernst repose dans la plus belle tombe de soldat que je connaisse. Devant la tombe ouverte, j'ai récité un “Notre Père”, dont les paroles se sont noyées dans mes larmes, et j'ai jeté les trois premières poignées de terre sur lui, ensuite, ce fut le tour de sa fidèle ordonnance, puis de tous les autres. Ensuite, j'ai fait fermer et décorer la tombe, comme je vous l'ai décrite. J'ai demandé à un dessinateur, que j'ai fait venir de ma propre compagnie, de réaliser pendant la cérémonie un petit dessin du modeste tumulus sous lequel repose notre héros. Je vous le ferai parvenir dès qu'il sera possible de faire ce genre d'envoi, avec une esquisse en forme de carte indiquant le lieu, de même que ses objets de valeur. Je demande à notre compagnie de vous faire parvenir, à votre adresse, ses affaires personnelles. Je dois cependant vous dire que de tels envois venus du front demandent souvent beaucoup de temps. Mais vous recevrez assez vite le dessin de sa tombe, du moins si Dieu me laisse la vie. Comme l'ordre de marche vient d'arriver par le téléphone de campagne, je dois partir au galop jusqu'à mon poste de garde et m'élancer, à la tête de ma compagnie, à la poursuite de l'ennemi qui recule. Nous allons emprunter le chemin qu'il a découvert en fidèle éclaireur avec sa patrouille au sacrifice de sa vie. Maintenant, nous nous terrons dans une ferme que les Russes bombardent au shrapnel et nous attendons les ordres de la division. Je profite de ce bref répit qui me reste, pour vous écrire ce message de deuil sur ces fiches de rapport (c'est le seul papier que j'ai sur moi). Que Dieu donne à vos cœurs de parents une parcelle de la force et de la fierté de son âme héroïque! Croyez-moi, donnez-lui ce dernier témoignage d'amour, en acceptant sa mort comme il en a été digne, et comme il l'aurait souhaité! Que Dieu permette que ses frères et sœurs, à qui il vouait un grand amour fraternel, grandissent pareils à lui en fidélité, en bravoure, avec une âme aussi vaste et aussi profonde que la sienne! Avec mes sentiments les plus respectueux. Dr. Walter Flex, Lieutenant de réserve».
Dans une lettre à ses propres parents, le 29 août, il fait un récit plus concis de la mort de son camarade, mais exprime aussi d'autres sentiments, impossibles à dire au père et à la mère de Wurche, dans une première lettre de circonstance: «Wurche est mort. Il est tombé lors d'une reconnaissance audacieuse, en commandant un poste de garde à Posiminicze sur les rives du Lac Simno. Moi, j'étais de garde à Zajle —à cinq kilomètres de là— et j'ai appris la nouvelle par le téléphone de campagne et je n'ai pu me rendre auprès de lui que le matin, car je ne pouvais pas abandonner mon poste. A cinq heures, notre bataillon devait reprendre la marche et je n'ai donc eu qu'une heure et demie pour le voir une dernière fois et le faire enterrer. J'ai dû, revolver au poing, forcer un paysan à atteler un équipage et à me conduire à travers champs à P. J'ai enterré ce fidèle compagnon entre deux tilleuls et j'ai placé entre ses mains une fleur de tournesol aussi haute qu'un homme, avant qu'on ne le descende dans la tombe. Ses derniers mots, avant de partir pour son poste de garde, ont été: «Flex, revenez donc encore me voir à P.!». Je lui ai répondu que moi aussi j'étais de garde. Mais je suis tout de même retourné à P.! La mort de Wurche, je l'ai ressentie comme une deuxième mort de Petzlein, à qui il ressemblait beaucoup, par sa jeunesse, son idéalisme, sa pureté —lui aussi était Wandervogel!—. Mais cette douleur-là élargit aussi les horizons du cœur, qui refuse désormais de s'imposer des exigences [individuelles] et bat désormais au même rythme que celui du peuple. Sa montre fonctionnait encore, quand je la lui ai enlevée. Je la prend souvent dans le creux de la main et je sens cette douce et lente pulsation de vie, que ses propres mains ont impulsée. Ne croyez pas que je sois triste, j'ai désappris la tristesse. A côté de la volonté et du don de soi, il n'y a plus de place pour ce sentiment-là...».
Dans une lettre du 4 novembre 1915, adressée à son père seul, le ton est plus philosophique, plus dur aussi, comme si Walter Flex tentait d'épargner à sa mère, qu'il adorait, des récits qui auraient pu accroître son chagrin et son inquiétude: «... Nous sommes tous devenus bien différents parce que nous avons vécu des moments que nul mot humain ne peut exprimer, nous sommes devenus plus riches, plus graves, et les souhaits que nous nous formulons dépassent le niveau purement personnel et se portent sur des choses qui se trouvent certes en nos propres cœurs mais s'élèvent quand même bien au-dessus de nous. Les désirs pressés, exprimant l'espoir de se revoir bientôt pendant assez longtemps, s'estompent pour faire place à des désirs tenaces, que nous cultivons en nous, auxquels nous préparons nos âmes, le désir d'arriver enfin à réaliser les objectifs que s'est donnée la patrie. C'est avec ce qui est arrivé ce matin que mon cœur s'est renforcé dans ce sens, avec beauté et gravité. Lors d'une patrouille, un homme de ma compagnie a reçu une balle dans l'articulation de la hanche, la blessure était très sérieuse. Avec quelques hommes munis d'une toile de tente, je suis sorti pour le ramener dans nos positions. Le pauvre gars était exposé aux vents du nord-est et à une neige mordante, complètement désemparé, et il perdait beaucoup de sang. Il appartenait à la réserve la plus récente qui était arrivée en septembre seulement. Je lui ai demandé: «Alors, mon garçon, vous souffrez beaucoup?» - «Non, mon Lieutenant!», soupira-t-il en serrant les dents, «mais... mais... cela me fait enrager que le gars d'en face m'ait eu ainsi!» - «Quoi!», lui répondis-je, «quand on a fait son devoir aussi bien que vous, on a le droit de passer quelques bonnes semaines dans un beau lit tout blanc à l'hôpital de campagne allemand» - «Mais mon Lieutenant», me répondit ce brave garçon en avalant sa colère et en se raidissant, «je ne suis au front que depuis quelques semaines et je dois déjà partir!». Il a haleté brièvement et s'est mis à pleurer de colère, et les larmes coulaient sur son visage sale. Croyez-moi, une telle attitude est rare malgré les idées reçues qui nous évoquent l'impavide héroïsme de la multitude. Mais rien que le fait que cela arrive tout de même, est une grande et belle chose, et ce courageux petit bonhomme mérite bien de s'en sortir... Nos hommes endurent des privations, des souffrances et des peines indescriptibles, mais seul a de la valeur et du poids ce qu'ils font et supportent volontairement, en faisant fièrement et en toute conscience le don de leurs propres personnes...».
En décembre 1915, Walter Flex écrit deux lettres qui précisent encore sa vision de la vie, comme “pont entre deux mondes”, thématique essentielle de Der Wanderer zwischen beiden Welten. La première de ces lettres date du 16 décembre, est adressée aux parents de Wurche et a été rédigée lors d'une permission à Eisenach: «... J'ai oublié de vous dire quelque chose. Votre Ernst avait souvent l'habitude de dire, quand nous parlions de nos soldats morts au combat: «La plus belle chose que l'on puisse dire sur la mort en héros, c'est ce qu'a dit un Pasteur quand son propre fils est tombé: «Quoi qu'il ait pu réaliser dans sa vie, il n'aurait jamais pu atteindre quelque chose d'aussi haut». Cette vision, si belle et si sublime, que cultivait votre cher fils, doit avoir le pouvoir de vous réconforter, vous aussi».
La seconde date du 25 décembre, est adressée à un ami et nous révèle les premières intentions de l'auteur, d'écrire le livre qui le rendra immortel: «Enfants, nous avions chacun une branche à nous sur l'arbre de Noël, où brûlait une bougie que nous réétoffions sans cesse jalousement à l'aide de la cire qui coulait, afin qu'elle soit la dernière à brûler. Hier soir, lorsque je regardais scintiller notre petit arbre russe dans mon abri souterrain gelé, chaque petite bougie semblait avoir un nom. J'étais aux côtés de beaucoup d'êtres que j'avais aimés, et quand la dernière bougie s'est éteinte, j'étais assis dans un cercle formé de beaucoup de morts. Petzlein était près de moi, ainsi qu'un ami, Ernst Wurche, que j'ai connu et perdu à la guerre et que j'ai enterré près de Posiminisze. Dans les moments où les morts sont si proches de moi, je me sens bien, et seule la compagnie des vivants m'apparaît étroite. Fidèle, tu m'écris si souvent; ne sois pas fâché si je t'écris plus rarement; je ne suis pas moins cordial à l'égard du seul vivant qui me reste. Mais la compagnie des morts fait que l'on devient plus tranquille et que l'on se contente de penser aux uns et aux autres. Les quelques mots que l'on jette sur le papier semblent si pauvres et si démunis à côtés des relations si vivantes que l'on peut entretenir dans nos rêves et nos souvenirs... La plupart des gens ne valent pas grand'chose; si nos pensées s'occupent trop de cette multitude, ne fût-ce que par colère et par rejet, nos souvenirs ne sont plus qu'un fatras hétéroclite. Il ne faut pas que cela soit ainsi. Le divin est dans l'homme comme l'oiseau niche dans une haie d'épines, il ne faut qu'écouter son chant et ne pas regarder les épines. Les yeux, les oreilles et les lèvres doivent se fermer devant toutes les petites mesquineries, laideurs et misères, et l'âme toute entière doit se consacrer aux moments, aux choses et aux personnes qui nous révèlent le beau: voilà tout l'art de la vie. Ernst Wurche, que j'ai évoqué dans quelques-unes des lettres que je t'ai écrites, avait une manière si fine, si exemplaire, de passer à côté de toutes ces laideurs humaines, il en riait et récitait son petit vers de Goethe favori: “Voyageur, c'est contre cette misère-là que tu veux t'insurger? Tourbillon, étron séché, laisse le virevolter, se pulvériser!”. L'immense fatigue physique et nerveuse est passée, dès que nous avons repris la guerre de mouvement; je suis sur le point d'écrire mes souvenirs d'Ernst Wurche et toutes mes expériences de la guerre deviendront ainsi le vécu de cet homme tout de beauté et de richesse d'âme...».
A Mazuti, le 11 mars 1916, Walter Flex écrit à sa correspondante Fine Hüls, jeune femme du mouvement Wandervogel, une lettre dans laquelle sont précisées ses intentions de consacrer un livre à Ernst Wurche: «Je me suis mis depuis plusieurs semaines à un travail, auquel je consacre mes meilleurs instants et qui résumera mes souvenirs d'un ami tué au combat. Lui aussi était un Wandervogel et je puis dire déjà que mon travail fera ressortir de la manière la plus vivante qui soit l'esprit du Wandervogel, sublime et illuminant, tel qu'il m'est apparu chez ce garçon. Car c'est cet esprit-là dont l'Allemagne aura besoin dans l'avenir. Moi même, je n'ai jamais été Wandervogel, mais mon jeune frère l'était, et j'ai habité pendant de longs mois le même abri souterrain avec l'autre [Wandervogel que j'ai connu], le mort sur qui je vais écrire [mon livre]...».
Le 14 mars 1916, toujours à Mazuti, Walter Flex écrit à son frère et précise plus nettement encore ses intentions quant au livre qu'il prépare et rédige sur la figure sublime du Wandervogel Ernst Wurche. Outre des réflexions philosophiques intenses, simples, essentielles pour entrevoir la première mouture de son ouvrage en gestation, la lettre révèle qu'il a toujours caché à ses parents, et surtout à sa mère, les vraies horreurs du quotidien de la guerre, horreurs qu'il accepte avec un remarquable et admirable stoïcisme, parce, comme toute souffrance, ou toute maladie, elle construit la personnalité: «...Plus cette guerre durera, plus elle prendra des formes destructrices, et il serait effronté de calculer et de songer à mener sa petite mission dans ce grand jeu, tout en espérant échapper à la mort. En disant cela, je ne cherche pas à te faire peur —bien sûr, ne montre pas cette lettre à nos parents— mais je veux tout simplement te signaler des évidences que tout officier d'infanterie te confirmera et qui, personnellement, ne m'inquiètent pas le moins du monde, sauf quand je pense à notre maison. Mon grand ami Ernst Wurche m'a un jour dit à peu près ce qui suit: «Si [nous savons que] le sens et le but de la vie humaine sont de parvenir au-delà de la forme humaine, alors nous avons déjà accompli notre part dans le [grand processus] de la Vie, et quelle que soit la fin qui nous advienne aujourd'hui ou demain, nous savons davantage que le centenaire ou le sage. Personne n'a jamais vu tomber autant de masques, de coquilles vides, vu autant de bassesse, de lâcheté, de faiblesse, d'égoïsme, de vanité, vu autant de dignité et de noblesse d'âme silencieuse que nous. Nous n'avons plus grand'chose à exiger de la vie: elle nous a davantage révélé qu'à d'autres, et au-delà de cela il n'y a pas d'exigence humaine [à formuler]; attendons calmement, ce que la vie va nous demander. Si elle nous demande tout, alors qu'elle nous a tout de même déjà tout donné, les factures s'équilibrent». Ces paroles proviennent de la dernière conversation tranquille que j'ai eue avec Wurche; elles ne me quittent plus, elles sont si vraies, un profane resté en dehors de cette guerre peut à peine les comprendre et les sentir, mais ce n'est pas une phrase creuse que je t'écris quand je te dis qu'en ce qui concerne ma personne, je suis totalement serein. Mais peut-être qu'une tâche t'attend, surtout à l'égard de maman, dont je ne peux guère mesurer l'ampleur. Nous devons être capables de parler de cela en adultes et en toute sérénité, sans nous émouvoir. Je pense que tu dois te préparer et t'armer à l'avance pour affronter cette tâche, si elle t'échoit. Savoir comment tu la mèneras à bien, est ton affaire...».
Sa philosophie éthique se précise encore plus nettement dans une lettre du 28 avril 1917 à Fine Hüls: «Je me suis porté volontaire avec quelques camarades, parmi lesquels un vieux major, un type formidable, pour le front de l'Ouest. C'est pénible quand je pense à ma mère qui ne le sait pas encore. Pour le reste, vous connaissez ma pensée. Il ne suffit pas de poser des exigences d'ordre éthique, il faut les accomplir, pour leur donner vie. Goût de l'aventure et idéalisme ont souvent été confondus au début de cette guerre, et l'idéalisme inflexible, refusant toute concession, où seul compte le salut présent et futur de notre peuple, est devenu rare... Vous m'écrivez: «Toutes sortes de soucis me troublent l'âme, quand je pense à vous». Très chère madame, il n'y a aucune raison de se soucier. Ce souci ne serait fondé que si j'avais enfreint, en renonçant à mon engagement, le principe de cette unité d'action et de pensée, pour des raisons de cœur. En mon fors intérieur, je suis tout autant volontaire de guerre qu'au premier jour. Je ne le suis pas et je ne l'étais pas, comme beaucoup le croient, par fanatisme nationaliste, mais par fanatisme éthique. Ce sont des exigences éthiques, et non pas des exigences nationales, que je mets en avant et que je défends. Ce que j'ai écrit sur l'«éternité du peuple allemand» et sur la mission rédemptrice de la Germanité dans et pour le monde, n'a rien à voir avec l'égoïsme national, mais relève d'une foi éthique, qui pourra même se réaliser dans la défaite ou, comme Ernst Wurche l'aurait dit, dans la mort héroïque au combat de tout un peuple. Je n'ai jamais été le poète du parti pangermaniste, comme on le croit un peu partout, et j'avoue que ma pensée politique n'est pas trop claire, qu'elle n'a jamais hésité ni réfléchi outre mesure sur les nécessités de la politique intérieure et extérieure. Je m'en suis toujours tenu à une pensée claire et limitée: je crois, en effet, que l'évolution de l'humanité a atteint sa forme la plus parfaite, pour l'individu comme pour son évolution intérieure, dans le peuple, et que le patriotisme pan-humanitaire représente une dissolution, qui libère une nouvelle fois l'égoïsme personnel, normalement bridé par l'amour porté au peuple, et fait revenir l'humanité entière à l'égoïsme dans sa forme la plus crue... Voici ce que je crois: l'esprit allemand en août 1914, et après, a atteint un degré d'élévation inouï, comme chez aucun peuple auparavant. Heureux celui qui a pu atteindre ce sommet et n'a plus eu besoin d'en redescendre. Les descendants de notre peuple et des autres peuples verront la trace de ce déluge voulu par Dieu, au-dessus d'eux, le long des rives vers lesquelles ils s'avanceront. Voilà donc ce que je crois, voilà ma fierté et ma joie, qui m'arrachent à tous les soucis personnels».
A partir de mars 1915, Flex a donc servi continuellement sur le front russe, avec un repos de quelques mois au ministère de la guerre en 1917, où il participera à la rédaction d'une histoire officielle de la guerre en cours. Il a toujours refusé les nominations au département de la presse, qu'on lui a souvent proposées, préférant servir au feu. C'est à la fin de 1916 que paraît Der Wanderer zwischen beiden Welten, chez Beck. En deux ans, 250.000 exemplaires seront vendus (en 1940, le chiffre sera de 682.000 exemplaires). Walter Flex a donc eu le bonheur de connaître le succès de son livre et la joie de recevoir un courrier très abondant de soldats et d'officiers du front, qui lui disaient avoir trouvé dans ce texte consolation, force et sérénité. En décembre 1916, Walter Flex part en permission à Eisenach chez ses parents, avec, dans son sac, une nouvelle pièce de théâtre, Die schwimmende Insel (L'Ile flottante), à thématique mythologique. Elle sera jouée peu avant Noël au théâtre de la ville. Mais cette version originale n'est demeurée qu'un premier jet et n'a jamais été retravaillée. Walter Flex se jette alors corps et âme dans la rédaction d'un nouvel ouvrage, Wolf Eschenlohr, qui restera à l'état de fragment. Il se porte volontaire pour le Front de l'Ouest, mais sa demande est rejetée. Il continuera donc le combat contre les Russes, avec un répit à l'état-major à Berlin, où on lui demande de rédiger un rapport précis sur l'offensive russe du printemps 1916 («Die russische Frühjahrsoffensive 1916»), qui figurera dans un ouvrage collectif édité par l'armée et paraîtra aussi sous forme de livre après sa mort. A Berlin, il fait la connaissance d'une jeune femme du Wandervogel, Fine Hüls, à qui il enverra des lettres poignantes, révélant clairement ses positions. Fine Hüls était une collaboratrice de la Tägliche Rundschau, et avait fait mettre en musique certains poèmes de Walter Flex pour les cercles berlinois du Wandervogel. Le 6 juillet 1917, il reçoit la Croix de Fer de première classe. Fin août 1917, il rejoint son Régiment dans le “Baltikum”. Il participe au franchissement de la Duna et à la prise de Riga. Ensuite, sa compagnie est envoyée sur l'île d'Oesel, face aux côtes lettones et estoniennes. Mais l'obsession de la mort demeure, malgré cette progression fulgurante des armées du Kaiser qui contraste avec le piétinement à l'Ouest. Il écrit à Fine Hüls: « De tous mes camarades qui sont partis à l'Ouest il y a quelques mois, un seul est encore en vie. Parmi eux, il y avait quelques hommes formidables, avec qui j'aurais aimé partir. Je les revois encore dans la gare, qui me font signe du train qui partait. «Dommage que vous ne puissiez venir avec nous!», me criait Erichson, un Mecklembourgeois, qui formait avec Wurche et moi un trio de chefs de peloton de la 9ième Compagnie devant Augustov[o]. Maintenant il est enterré en face de Verdun. S'il avait su que nous aurions pris Tarnopol et Riga peu après, il serait sûrement resté avec nous. Où serais-je si mon engagement de l'époque n'avait pas été refusé? Est le hasard ou le destin? Je suis toujours reconnaissant de conserver cette égalité d'âme, qui n'a jamais été sérieusement ébranlée. Non pas que j'aie le sentiment d'être différent des autres ou supérieurs à eux, mais j'ai la conviction tranquille et intérieure que tout ce qui peut m'arriver est une parcelle de l'évolution de la vie, sur laquelle la mort n'a nulle emprise...».
Le 15 octobre 1917, le jour où cette lettre arrive à Berlin, une balle mortelle atteint Walter Flex sur l'île d'Oesel. Plusieurs lettres existent, qui témoignent de sa mort, ainsi qu'un rapport rédigé par la Général von Hutier, commandeur du Régiment. Voici comment Konrad Flex résume l'ensemble de ces récits et rapports dans son introduction aux œuvres complètes de son frère: «Dans la cour du domaine de Peudehof, près du village de Leval, s'était retranché un fort parti de Russes avec leurs chariots à bagages. Le représentant du corps des officiers, Weschkalnitz, est allé de l'avant et a demandé aux Russes de se rendre. Un officier russe lui a mis la main sur l'épaule et lui a dit: «Non, vous êtes mon prisonnier». Weschkalnitz a fait un bond en arrière et a cherché à s'abriter derrière un rocher, tandis que les Russes ouvraient le feu sur lui. C'est alors que Flex a sauté sur un cheval cosaque qui n'était plus monté, a sorti son épée du fourreau et s'est élancé vers l'ennemi. W. lui a crié: «Mon Lieutenant, ils ne veulent pas se rendre!». Au même moment, plusieurs balles ont été tirées. L'une d'elles a sectionné l'index de la main droite du cavalier qui avançait et puis s'est logée dans le corps. Walter Flex est tombé de cheval et a crié à W., qu'il devait prendre le commandement de la compagnie. Un homme du Landsturm allemand (= équivalent de la Territoriale française) s'est élancé furieux, pour massacrer à coups de crosse le tireur russe, mais mon frère lui a dit: «Laisse-le, lui aussi n'a fait que son devoir». Immédiatement, les Russes ont abandonné le combat et déposé les armes. Le blessé a été amené par ses hommes dans une petite maison le long d'un chemin, où un sous-officier du service sanitaire lui a prodigué les premiers soins. Sa première question a été de s'enquérir de la situation à la suite de cet engagement. La réponse l'a satisfait et il s'est affaissé. Dans le château du domaine de Peudehof, les Russes avaient installé un hôpital de campagne, qui venait de tomber aux mains des Allemands. Le blessé y a été transporté sur un chariot et pansé par les médecins russes. Peu après, un médecin militaire allemand est arrivé à son chevet, après s'être concerté avec ses collègues russes, il a jugé qu'une opération était exclue, car le blessé avait perdu trop de sang et était trop affaibli. La balle avait traversé le ventre et manifestement touché des organes vitaux. A Zimmer, sa fidèle ordonnance, mon frère a dicté la carte suivante: «Chers parents, j'ai dicté cette carte, parce que je suis légèrement blessé à l'index de la main droite. Autrement tout va très bien. Ne vous faites aucun souci. Salutations chaleureuses. Votre Walter». Lorsque Zimmer lui a demandé s'il devait écrire comme mon frère avait l'habitude de le faire «A Monsieur le professeur et Madame Flex», il a dit en souriant: «Non, Zimmer, n'écrivez cette fois que “Professeur Flex”, pour que ma mère ne soit pas effrayée». Pendant la nuit, Zimmer est venu plusieurs fois au chevet de son Lieutenant et l'a toujours trouvé apaisé, les yeux fermés. Lorsqu'il lui a demandé s'il avait mal, Walter Flex a répondu par la négative, mais lui a parlé de difficultés au niveau du cœur. Le matin du jour suivant, il a reçu la visite du Pasteur de la Division, von Lutzki, qui, à sa grande joie, lui a apporté le salut du Régiment. Comme le blessé était fort affaibli, von Lutzki n'a pu rester que quelques instants. Il a demandé s'il devait saluer le Régiment pour lui, et mon frère a répondu: «Bien sûr que oui! Excusez-moi de ne pas vous le dire moi-même, mais avec tout ça, je me sens tout de même un peu perturbé». Le Pasteur von Lutzki voulait revenir l'après-midi. Lorsque mon frère, pour prendre congé de lui, a lancé un «Au revoir», il a remarqué un geste chez le prêtre et a ajouté sur un ton mi-plaisant mi-interrogateur: «Quoi qu'il en soit, nous nous reverrons tout de même, n'est-ce pas?». Son état de faiblesse s'est alors rapidement amplifié. Beaucoup voulaient rendre une visite au blessé, mais personne n'y a été autorisé. Walter Flex est mort au début de l'après-midi du 16 octobre. Le jour de sa mort correspondait au jour de l'anniversaire de son frère Otto, qui l'avait précédé dans la mort du soldat. Le corps de Walter a été ensuite amené dans un petit pavillon du parc. Normalement, le régiment entier aurait dû prendre part aux obsèques, mais, le soir même, il a reçu l'ordre d'aller de l'avant. Ainsi, seuls neuf hommes de sa chère compagnie ont pu rester, pour lui faire une dernière escorte, accompagnés par quelques médecins militaires allemands. L'enterrement a eu lieu dans le cimetière du village de Peude, à dix minutes de là. Sa tombe se trouve juste en face du caveau de la famille von Aderkas, à qui appartenait le domaine avant qu'il ne soit exproprié. Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Peude. La croix de bois, érigée par nos soldats, s'est décomposée depuis et a été remplacée par une autre, payée par des fonds récoltés dans les cercles baltes. Sur un petit socle de granit, se dresse, fine et élégante, une croix de fer forgé peinte en blanc, pourvue d'une plaque de laiton portant le nom et les dates de naissance et de décès du défunt. Cette croix est provisoire, mais elle a été dressée par des cœurs fidèles et des bonnes volontés. C'est une croix de soldat comme des milliers d'autres et je l'aime telle qu'elle est, comme je l'ai vue pour la première fois ce jour-là, tôt dans la matinée. C'est pourquoi je pense qu'elle peut rester quelque temps, jusqu'à ce qu'elle se décompose à son tour et qu'elle soit remplacée par une pierre tombale définitive. Le cimetière de Peude est tout encombré de gros arbres, un peu négligé, ce qui le rend d'autant plus pittoresque».
Au moment de sa mort, paraît un recueil de poèmes sur ses expériences de guerre, Im Felde zwischen Nacht und Tag, qui, la même année a connu vingt-et-une éditions. Walter Flex a pu lire et corriger les épreuves mais n'a jamais vu son livre. Les droits d'auteur devaient revenir à une fondation créée en faveur des orphelins de guerre.
Sa nouvelle de guerre, Wolf Eschenlohr, est restée inachevée. Le 23 août 1917, il avait envoyé le premier chapitre à son éditeur. Le manuscrit du second se trouvait dans un porte-cartes, qu'il a eu le temps de remettre à son ordonnance, en lui demandant d'y veiller tout particulièrement. Zimmer expédia tout à la famille. Ce manuscrit, un cahier noir et d'autres papiers ont été transpercés par la balle fatale. Konrad Flex écrit: «Le livre aurait dû décrire les expériences de guerre du poète, les expériences extérieures et intérieures, dans une intrigue purement fictive. L'auteur voulait prendre position face aux nombreuses questions, notamment de natures religieuse et éthique, que la guerre avait éveillées en lui. Il voulait aussi y traiter de la question sociale et de l'opposition entre les classes (...)».
Le noyau de la vision poétique de Flex, qui est aussi une vision de l'homme et de la mission qu'il a à accomplir sur la Terre, constitue une réflexion intense, soumise constamment au contrôle du vécu, sur le rapport entre l'individu et la société (ou la communauté; le poète Flex n'opère pas de distinction entre les deux concepts comme les sociologues). Dans ses pièces de théâtre, le social est la condition existentielle qui permettra à l'individu de vivre en adéquation avec ses propres canons éthiques. L'individu qui croit pouvoir s'élever au-dessus des conditions sociales, qui croit détenir un savoir supérieur ou mener seul une mission sublime, d'essence métaphysique ou divine, ou qui s'isole en déployant seul une éthique pure de tout contact avec le réel, est irrémédiablement condamné à l'échec.
Libre de tout engagement politique, Walter Flex n'introduit aucun ferment idéologique dans sa poésie, ses drames et sa prose. De même, jamais, ni dans ses poèmes ni dans ses récits ni dans ses fictions ni dans les lettres qu'il adressait à ses parents, ses frères et ses amis, il n'écrit un seul mot désobligeant envers l'ennemi français ou russe. Pour lui, le peuple (Volk) est mis en équation avec l'ethos: car ce Volk est le cadre spatio-temporel où, lui, Allemand, où l'autre, Russe ou Français, doit stoïquement, sans fléchir, incarner l'éthique du service à la communauté, devant les tourments et les souffrances de la guerre, qui est la tragédie portée au pinacle, l'örlog de l'Edda, le chaos déchaîné qui reste finalement le fond-de-monde auquel nous sommes livrés, de par notre conditio humana. On est sur Terre pour servir et pour souffrir, non pour recevoir ou pour jouir. Ainsi, Walter Flex touche à l'essentiel et garde un cœur pur, limpide: des souffrances qu'il endure, avec ses millions de camarades du front, il n'attend aucune récompense, aucune promotion, ni même aucune victoire. La guerre est l'occasion, pour lui, de vivre pleinement la condition humaine.
Der Wanderer zwischen beiden Welten est un monument à son ami Ernst Wurche, un jeune officier issu des Wandervögel, le mouvement de jeunesse idéaliste né sous l'impulsion de Karl Fischer, à Steglitz, dans la banlieue de Berlin en 1896. Wurche avait étudié la théologie, participé à ce mouvement de jeunesse en quête du “Graal” au moment où la société se vidait de toute éthique sous les coups de l'industrialisme, de la consommation, de la publicité, des plaisirs frivoles et commercialisables. Wurche incarnait l'intégrité, la pureté des idéaux, une grâce forte et virile, une dignité sereine, la Gelassenheit: bref, toutes les qualités du mouvement Wandervogel. Si Flex, plus âgé que Wurche, hérite encore de l'ancienne notion prussienne du service, plus âpre, plus militaire, plus politique, plus ancrée dans une histoire institutionnelle précise, le jeune officier issu des Wandervögel, développe un idéalisme au-delà de ces circonstances historiques spécifiquement prussiennes, donc un idéalisme plus pur, visant, en fait, à dompter les tensions et les contradictions multiples qui traversaient la nation allemande. Les clivages entre confessions religieuses et idéologies politiques, entre intérêts divergents et opposés, doivent disparaître au profit d'une synthèse nouvelle, qui ne sera pas bruyamment nationaliste, mais rigoureusement et sereinement éthique. La germanité nouvelle, rêvée autour des feux de camp du Wandervogel puis des bivouacs de l'armée impériale en campagne, serait une synthèse entre la foi du Christ, la sagesse vitaliste de Goethe et l'idéal de la surhumanité nietzschéenne. Cet homme nouveau, ce nouveau Germain stoïque et serein, calme et maître de soi, devra avoir le sens du sacrifice suprême, sans poses et sans coups de gueule. Son sacrifice, sa mort au combat, comme celle de Wurche qui, en ce sens, est exemplaire, n'est pas une perte irréparable, ne réclame pas vengeance: elle est une consécration religieuse, un accès au sacré. Comme la Passion du Christ. Dans cette perspective qui reste absolument chrétienne, et plutôt de facture évangélique-luthérienne, Flex écrit, dans Nachtgedanken: «La guerre est l'un des dévoilements les plus sacrés et les plus importants, par lequel Dieu répand de la lumière dans notre vie. La mort et le sacrifice des meilleurs de notre peuple ne sont qu'une répétition, voulue par Dieu, du miracle le plus profond de la vie qu'ait jamais connu la Terre, c'est-à-dire de la souffrance vicariale de Jésus Christ».
De cette vision de la vie et de la mort, de la souffrance et du don de soi, doit découler une pédagogie nationale, dont le dessein premier est d'insuffler une vigueur morale de telle ampleur, que le peuple qui la pratique échappe à la mort. La véritable vie du moi se situe dans le don au toi. Il y a dès lors primauté de l'éthique sur le national et sur le social (qui offrent chacun un contenant à la pratique de l'éthique). Le social n'est rien en soi mais est tout pour l'individu, parce qu'il lui présente toutes les facettes de ce Protée qu'est le toi, et lui offre donc la possibilité d'être altruiste. Dès les dernières années de son Gymnasium, Walter Flex a élaboré sa philosophie du service et de l'altruisme, où se mêlent, dans une synthèse sans doute assez maladroite, le vieil idéal prussien du service et une sorte de social-darwinisme coopératif; jeune lycéen il écrit: «J'ai trouvé l'ancienne montagne magnétique, vers laquelle convergent tous les efforts humains: c'est le groupe, la patrie». C'est la vie en groupe qui donne son sens à l'individu: «La volonté vise un but, et ce but, c'est la durée. Or le moi n'a pas de durée. La durée, c'est la famille, c'est la patrie». Mais l'égoïsme est une force indéniable parmi les multiples mobiles humains. L'individu, par le truchement des institutions nationales, du cadre nationalitaire, du Volk organisé en Etat, sublime ses pulsions égoïstes naturelles et les hisse à un niveau plus élevé, celui du service à la collectivité. Cette vision éthique et politique peut être considérée comme l'expression simplifiée d'un hégélianisme nationaliste, encore fort teinté des premiers écrits romantiques de Hegel, avant qu'il ne s'insurge contre les simplismes des “teutomanes”. Le Volk est, dans cette optique, le fondement à partir duquel se déploie une éthique, une morale, une Sittlichkeit unique, non interchangeable, non transmissible à d'autres Völker. Par le truchement du droit, des institutions politiques et de l'Etat, cette Sittlichkeit peut s'ancrer dans les esprits et créer de véritables “organismes politiques”, lesquels postulent qu'il y ait identité entre les gouvernants et les gouvernés, que les uns commes les autres participent de la même Sittlichkeit, dérivée du même humus, c'est-à-dire de la même substance populaire, du même Volk. La Sittlichkeit politique de facture hégélo-nationale s'oppose ainsi, comme le constate le philosophe italien Domenico Losurdo à la suite d'une enquête minutieuse, au strict individualisme kantien et aux sentimentalismes irrationalistes et mystiques, qualifiés de “criticismes stériles”. La Sittlichkeit n'a rien à voir avec la Schwärmerei (= l'enthousiasme) romantique, refuse les “évasions consolatrices”. Elle se déploie dans un cadre politique, dans un cadre national, dans une éthique du service, au-delà des intérêts personnels et des idéologies qui leur servent de justifications. Si Flex n'a jamais rien écrit de systématique sur ses options politiques, il est évident qu'il a vécu tout compénétré de cet hégélianisme implicite du monde protestant allemand.
Walter Flex propose ainsi un idéal de l'accomplissement de soi par la négation de soi, un dépassement de l'égoïsme personnel. Notre vie sur terre ne constitue nullement un but en soi, mais n'est seulement qu'une parcelle infime de notre être éternel, qui nous pousse graduellement, par la lente action du temps, vers le divin. Les souffrances que nous affrontons, et que les soldats de la première guerre mondiale affrontent, rendent les forts plus forts et les faibles plus faibles. En ce sens, la guerre est révélatrice: elle montre les créatures de Dieu telles qu'elles sont vraiment, sans fard, sans masque.
La germaniste Irmela von der Lühe écrit, dans une étude consacrée à Flex: «Les valeurs spirituelles, vis-à-vis desquelles il se sent obligé et responsable, sont simples et droites. L'étudiant en théologie Ernst Wurche lit Goethe et, dans les tranchées, il apprend encore des poèmes par cœur, il lit aussi les aphorismes poético-philosophiques du Zarathoustra de Nietzsche, trimbale ce livre partout avec lui, et il ne cesse d'en citer des passages ainsi que de l'édition de campagne du Nouveau Testament. Ce qu'il cite (...) il le cite sans crispation intellectuelle. La beauté de l'art, l'idéal du combat pour le bien et contre le mal, et la prière comme requête pour obtenir la force et la bravoure du soldat: voilà les valeurs qui remplissent la bibliothèque du soldat Ernst Wurche. Y transparaît surtout son christianisme guerrier. Le Dieu d'Ernst Wurche est un ennemi des faibles, il porte lui aussi l'épée, qui brille pure et claire dans le soleil...».
Symbole de l'homme parfait, de cet homme nouveau que doit imposer la pédagogie populaire et nationale souhaitée par Walter Flex (et par Fine Hüls dans ses écrits d'hommage au poète dans la presse du Wandervogel, après la guerre), Ernst Wurche traverse deux mondes, le monde terrestre et le monde du divin, qui fusionnent dans l'intensité brève et incandescente de l'assaut ou dans la mort héroïque. En France, Pierre Drieu La Rochelle écrira des pages aussi sublimes sur l'assaut dans La comédie de Charleroi.
Dans les poésies de Flex —et dans sa philosophie implicite de la vie que l'on rencontre très souvent dans sa prose—, se dégage une sorte de proximité avec la nature, de volonté de fusion avec la cosmicité, proche à maints égards des pensées asiatiques. Observateur français critique, proche de l'Action Française, Maurice Muret, écrit dans La Revue universelle, en août 1921, que l'anti-asiatisme bruyant —violent et très agressif lors de la Guerre des Boxers— de Guillaume II, vitupérant sans discontinuité contre le “péril jaune”, a fait place à une “asiatomanie” anti-occidentale parce qu'anti-rationaliste et, partant, anti-française et anti-anglaise. Le néo-orientalisme allemand est, aux yeux des critiques germanophobes et antisémites français, dont Muret, une sorte de néo-rousseauisme, véhiculé par les cercles et les publications de la Freideutsche Jugend et par des philosophes comme Rudolf Pannwitz (très critique à l'égard des formes militaristes du nationalisme et de l'impérialisme allemands) ou Martin Buber (traducteur des Discours et similitudes du sage taoïste chinois Tchouangtsé). Muret insiste également, pour appuyer sa thèse de l'“asiatisme” des Allemands, sur le succès que connaissait, dans l'Allemagne vaincue, l'auteur indien Rabindranath Tagore, qui condamnait l'Angleterre, se montrait indulgent pour le Reich battu et définissait les nations occidentales comme celles de l'“égoïsme organisé” où triomphait la “mécanisation sans idéal”. Tagore, avec le langage des traditions védique et bouddhique pluri-millénaires, tentait de prouver que le bouddhisme ne prêchait nullement l'anéantissement de soi-même, mais l'éternisation de soi-même, non seulement par l'abolition de la personnalité mais aussi et surtout par son ascension dans le spirituel. Ce sera Henri Massis, dans un texte célèbre de 1925, Défense de l'Occident, qui donnera une forme et un argumentaire définitif à cette critique occidentale de l'asiatisme de la pensée allemande. On peut tracer à l'évidence un parallèle avec Flex, même si celui-ci n'a aucune référence orientale. Sans oublier de dire quand on aborde ce contexte, que cette “asiatomanie” que Muret et les germanophobes antisémites de la place de Paris dans les années 20 attribuent à un ressentiment allemand devant la défaite et le Traité de Versailles, est en fait beaucoup plus ancienne et remonte à Schopenhauer.
Celui-ci avait annoncé la fin de l'euro-centrisme en philosophie et un retour à la philosophie indienne. Cette reconnaissance de la pertinence des philosophies extra-européennes ne s'accompagne pourtant pas, chez Schopenhauer, d'une fébrilité de converti, d'une “désertion de l'Europe”. En réhabilitant la pensée indienne, Schopenhauer et ses émules parmi les philosophes allemands du début du siècle réintroduisent dans le discours philosophique des linéaments aussi importants que l'idée du malheur structurel et incontournable, inhérent à la vie humaine et animale, l'égalité en rang du règne animal et humain, un principe de réalité non intellectuel, etc. Car, dans cette perspective, l'unité fondamentale de toute chose et de toute vie ne peut se saisir que par une mystique. La mystique, en effet, saisit la réalité au-delà de tout disible et de tout pensable. C'est la réalité d'avant le langage (donc d'avant tous les travestissements, les calculs anthropocentriques, les dérivatifs qu'il induit), la réalité non cognitive, laquelle se borne à “se montrer”, se dévoiler. Le langage et les concepts abstraits, tout comme les conventions sociales dénoncées par le Wandervogel ou les idéologies des groupes politiques conventionnels de droite et de gauche, masquent le réel, masquent la prolixité féconde et ubiquitaire de l'indicible et de l'impensable, de l'incommensurable.
Flex opte, dans le contexte de cette postérité schopenhauerienne où il est finalement inconscient de l'héritage de Schopenhauer, pour une contemplation de la nature, source d'inspiration spirituelle du poète. En effet, toute son œuvre poétique est imprégnée de notations révélatrices du sentiment d'intime participation à l'organicité du monde. Au-delà des raisons “hégéliennes” que nous évoquons par ailleurs, au-delà des héritages luthériens de sa famille, Flex fait usage d'une terminologie extra-philosophique, faisant implicitement et inconsciemment référence à un “socle” préexistant à tout concept abstrait, à toute religiosité plaquée sur le tronc germanique et européen, c'est-à-dire, schopenhaueriennement parlant, à cette réalité d'avant le langage, d'avant tout disible et tout pensable... Le reconnaissance, tout naturelle, parfois joyeuse et confiante, acceptante, de ce socle est la nouveauté religieuse et métaphysique apportée par l'homo novus germanique, à la fois “goethéen, chrétien et nietzschéen”, en guerre contre le “vieux monde” occidental. Ce naturalisme spiritualisé ou cette spiritualité naturelle justifient l'engagement allemand dans le premier conflit mondial. L'homo novus, assez proche de l'“ange” de Rilke, n'apporte pas aux hommes, humains trop humains, une idéologie rationnellement construite ou des principes intangibles ou des concepts juridiques ou des préceptes moraux qu'il s'agit de défendre comme les fondements immuables, —soustraits à toutes les vicissitudes de la vie—, d'une civilisation avancée sur la ligne du “progrès” mais appelle à préserver une certaine forme d'être contre cette modernité mercantile et ce matérialisme démocratique défendus par l'Entente. Cette forme d'être, c'est finalement l'homme pleinement relié au cosmos.
De Schopenhauer à Keyserling puis à Hauer, la pensée allemande a effectivement redécouvert l'hindouisme et le bouddhisme. Elle y voit une forme particulière de la sensibilité indo-européenne, orientale certes, mais préservée finalement de l'influence chrétienne. La rencontre est d'autant plus profondément ressentie qu'elle croise et confirme l'intuition romantique qui ne cesse de se développer depuis la fin du XVIIIième contre l'esprit des Lumières.
Les poèmes de Flex rendent compte de cette rupture. Les invocations au soleil de gloire, aux corps libres, au sang lumineux, à la terre fraîche, aux forêts du Septentrion, parlent avec émotion de la fusion sensuelle au mystère du monde. Le choix du Pélerin-migrateur, dans le titre, associé à l'Oie Sauvage, comme leitmotiv, renvoie à un folklore dont l'origine, en Europe du Nord, se perd dans la nuit des temps: «Symbole d'une très ancienne sagesse, la messagère qui unit le ciel et la terre [...], l'oie ou le cygne sauvage, qui parcourent le continent d'un bout à l'autre, symbolisent l'âme transmigrant de vie en vie [...], spirale mystique symbolisant la difficile pérégrination de l'âme vers le centre, le sanctuaire intérieur et caché, où elle rencontrera son Etre essentiel, la permanence de son impermanence, ce qui [...] ressemble à l'itinéraire intérieur accompli en zazen» (Jacques Brosse, Zen et Occident, Albin Michel, Paris, 1992).
Dans les poèmes de Flex, on ne compte plus les allusions aux tournesols, aux fleurs de soleil associées à l'éclat de l'or apollinien:
“Es deckt des Sonnenjünglings Brust
Als Sonnenwappen des Blütenbrust
Der gold'nen Blumenlanze”.
[Il couvre la poitrine de cet homme jeune et solaire, comme des armoiries solaires orneraient un buste en pleine croissance, comme une lance de fleurs toute dorée...].
Image du porteur de lumière:
“Als Fackel trägt er in weißer Hand
Eine goldene Sonnenblume”.
[Dans sa main blanche, il porte comme un flambeau un fleur de tournesol dorée].
Ou encore:
“Glüh', Sonne, Sonne glühe!
Die Welt braucht soviel Glanz!”.
[Resplendis, ô Soleil, ô Soleil, resplendis!
Le monde a bien besoin d'autant d'éclat!].
La mort elle-même devient expérience vivante, rupture sans abandon, intensification du lien spirituel et attachement charnel à la glèbe habitée. L'évocation du coup sur la nuque lors du rappel intense de l'absent correspond précisément à l'expérience décrite par Carlos Castañeda lors de circonstances similaires. L'énigme du monde n'est plus simple champ de spéculations dialectiques (de l'aristotélo-thomisme au pur formalisme teinté d'hégélianisme) mais domaine de réalisation tangible de sa propre nature (le gnothi seauton apollinien). Soit un recours à l'extra-philosophique, comme le réclamait Schopenhauer dans un certain désordre et une certaine confusion, mais en demeurant au niveau du sublime. Nous touchons là à la Voie du Guerrier telle que l'a pratiquée aussi bien l'Inde que le Japon ou l'Amérique précolombienne (cf. Bernard Dubant, La Voie du Guerrier, Ed. de la Maisnie, Paris, 1981).
Autre signe: le culte de l'épée.
“Das Schwert, so oft beschaut mit Lust
Glüht still in eig'nem Glanze”.
[L'épée, si souvent contemplée avec désir, repose, tranquille, dans son propre éclat].
On songe à la réponse du chef alain auquel un prélat chrétien, à l'époque de la grande migration des peuples, consécutive à l'assaut des Huns et l'effondrement des structures romaines, demandait quel était son dieu, l'Alain planta son épée dans une motte: «Voilà mon dieu». L'épée est indissociable de la lumière de la torche:
“Dann bricht er mit Fackel und Schwert hervor
Und leuchtet durch der Ewigkeit Tor”.
[Alors, il s'élance avec flambeau et épée et illumine le chemin qui passe par la porte de l'éternité].
Vient la synthèse, dans cette description poétique de Wurche mort, dans sa tombe, une fleur de tournesol entre les mains:
“Drin schläft ein Jüngling mit Fackel und Schwert
Unter des Kreuzes Pfosten”.
[Là (dans cette tombe) dort un homme jeune, avec flambeau et épée, sous la croix].
Nous sommes proches finalement de cette tradition christo-païenne de la littérature médiévale courtoise; le Graal n'est pas loin dans ces deux vers évoquant l'ami Wandervogel:
“Er war ein Hüter, getreu und rein,
Des Feuers auf Deutschlands Herde”.
[Il était un gardien, fidèle et pur, du feu qui brûle en l'âtre de la Terre Thioise]. Flex nous offre finalement une synthèse de paganisme viril, —au sens de vir, l'homme accompli— et de compassion bouddhique.
Der Wanderer zwischen beiden Welten, les lettres et les poèmes de guerre de Walter Flex sont avant toute chose une réflexion intense sur la mort. Le mystère de la mort tourmente puis fascine Walter Flex. Sa lettre, où il évoque les bougies du sapin de Noël de son abri sur le front russe et le “cercle des morts” où siègent Petzlein et Wurche, nous indique bien que leur troupe est la troupe des purs, celle des saints artisans qui «tirent l'acier du roc de nos âmes et le mettent à jour». La mort arrache les meilleurs soldats à la terre et les envoie dans son “royaume élyséen”. Ce sont bien les meilleurs qui ne reviennent pas, car ils sont appelés à incarner pour toujours, pour les siècles des siècles, l'idéal éthique; leur pureté et leur intangibilité en font des exemples immortels pour le peuple. Le Royaume des Morts, dans la vision de Flex, est le Royaume des vrais Vivants, il est comme l'idéal face aux imperfections du réel. Ces vrais Vivants, ces Purs, échappent aux viles petites passions des humains, englués dans leurs égoïsmes non sublimés. Mais s'ils sont exemples, et s'ils demeurent, dans la vision de Flex, haut dans l'empyrée des modèles impassables, ils sont aussi réfugiés, retournés, dans un sein maternel et tellurique. Leur tombe froide et l'image de la douceur du sein maternel fusionnent dans la poèsie et l'imaginaire passionnés du poète: car ces Morts, ces Purs, voyagent de leur empyrée sublime et idéale aux mystérieuses profondeurs fécondes de la terre, où ils rencontrent et illuminent ceux qui attendent encore leur naissance. Ils placent en eux la semence de leur excellence. Afin que le peuple puisse, plus tard, engranger une nouvelle moisson de héros. Significatif à cet égard est le poème Chor der deutschen Toten in Polen, où le poète prédit un grand avenir au peuple polonais, parce que, dans sa terre, demeure pour l'éternité une vaste cohorte de héros allemands, qui communiqueront leur excellence aux fils et aux filles de Pologne.
Der Wanderer zwischen beiden Welten a été le bréviaire de toute une génération. Il a redonné confiance et procuré consolation aux Allemands vaincus, après novembre 1918. Il a été un livre important. Qui a marqué le siècle, au même titre que les souvenirs de guerre d'Ernst Jünger (Orages d'acier, Le Boqueteau 125) ou A l'Ouest, rien de nouveau du pacifiste Erich Maria Remarque, très éloigné des valeurs des nationalistes, et aussi, finalement, de l'éthique hégélienne de la vieille Prusse. Il reste un immense travail de comparaison à faire sur l'impact philosophico-idéologique de la Grande Guerre et sur les innombrables écrits qu'elle a suscités. On a pu dire, dans notre insouciance, dans notre volonté de faire du passé table rase, dans notre course suicidaire à la consommation, que la Grande Guerre appartient définitivement au passé, qu'elle n'a plus rien à nous communiquer, qu'elle est la preuve la plus manifeste de la folie des hommes. Ces opinions ont peut-être leur logique, recèlent sans doute quelque pertinence positiviste, il n'empêche que sur le plan littéraire, elle a suscité des monuments éternels de la littérature universelle, elle a provoqué d'indicibles souffrances à des millions d'hommes, elle a porté au pinacle les affres de notre déréliction terrestre, les a démultipliés de manière exponentielle. Mais cette déréliction est un fait de monde incontournable. On n'échappe pas, on n'échappera jamais à la douleur en dépit des vœux pieux des intellectuels, des rêveurs, des eudémonistes de tous poils qui tentent de vendre leur camelote inessentielle. On n'abolira pas la mort qui obsédait Walter Flex et Ernst Wurche. Elle demeure, pour nous tous, au bout du chemin. Il faut l'assumer. En nous rapportant les paroles d'un tout jeune théologien jeté dans la guerre, en les immortalisant, en forgeant les mots simples qui ont touché et marqué durablement les combattants et tout son peuple, Walter Flex nous oblige à regarder ce destin en face, sans aucune grandiloquence —car il abominait la grandiloquence—, avec des mots d'une sublime simplicité, où le cœur garde la toute première place, où jamais l'immense tendresse du poète et du fils, de l'ami et du pédagogue n'est absente. Car l'œuvre de Flex est aussi une grande leçon de tendresse, surtout quand elle jaillit du pire carnage guerrier de ce siècle. Walter Flex, et par son intermédiaire, Ernst Wurche, et derrière Ernst Wurche, les jeunes idéalistes du Wandervogel, demeurés inconnus, dormant au fond d'une tombe à Langemarck ou ailleurs, nous ont légué un bréviaire, un livre de stoïcisme, à ranger dans nos bibliothèques à côté de Sénèque, de Marc-Aurèle et de l'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à Kempis. (*)
Robert Steuckers,
Forest, janvier-avril 1995.
Sources:
- Nicola COSPITO, I Wandervögel. La gioventú tedesca da Gugliemo II al Nazionalsocialismo, editrice il corallo, Padova, 1984.
- Walter FLEX, Gesammelte Werke, 2 vol., Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, s.d. (Introduction de Konrad Flex).
- Walter FLEX, Für dich, mein Vaterland. Ein Auswahl aus den Kriegsbriefen, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1939.
- Walter FLEX, Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis, Orion-Heimreiter-Verlag, Heusenstamm, 1978 (postface de Martin Flex).
- Michael GOLLBACH, Die Wiederkehr des Weltkrieges in der Literatur. Zu den Frontromanen der späteren Zwanziger Jahre, Scriptor Verlag, Kronberg/Ts., 1978.
- Hermann HELLER, Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte, Aalen, Otto Zeller Verlagsbuchhandlung, 1963.
-Ernst KELLER, Nationalismus und Literatur. Langemarck. Weimar. Stalingrad, Francke Verlag, Bern/München, 1970.
- Hellmuth LANGENBUCHER, Die deutsche Gegenwartsdichtung. Eine Einführung in das volkhafte Schrifttum unserer Zeit, Junker u. Dünnhaupt Verlag, Berlin, 1940.
- Walter LAQUEUR, Die deutsche Jugendbewegung. Eine historische Studie, Verlag Wissenschaft und Politik/Berend von Nottbeck, Köln, 1978.
- Eric J. LEED, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale, Il Mulino, Bologna, 1985.
- Robert LEGROS, Le jeune Hegel et la naissance de la pensée romantique, Ousia, Bruxelles, 1980.
- Domenico LOSURDO, Hegel. Questione nazionale. Restaurazione. Presupposti e sviluppi di una battaglia politica, Università degli studi di Urbino, Urbino, 1983.
- Irmela von der LÜHE, «Der Wanderer zwischen beiden Welten von Walter Flex», in Marianne Weil (Hrsg.), Wehrwolf und Biene Maja. Der deutsche Bücherschrank zwischen den Kriegen, Verlag Ästhetik und Kommunikation/Edition Mythos, Berlin, 1986.
- Reinhard MARGREITER, «Die achtfache Wurzel der Aktualität Schopenhauers», in Wolfgang SCHIRMACHER (Hrsg.), Schopenhauers Aktualität. Ein Philosoph wird neu gelesen, Passagen Verlag, Wien, 1988. A propos de ce livre, lire en français: Robert STEUCKERS, «Un ouvrage collectif sur Schopenhauer ou huit raisons de le relire», in Orientations, n°11, juillet-août 1989.
- Henri MASSIS, L'Occident et son destin, Grasset, Paris, 1956 (ce volume reprend in extenso le texte «Défense de l'Occident» de 1925).
- Arno MULOT, Der Soldat in der deutschen Dichtung unserer Zeit, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1938.
- Maurice MURET, «La pensée allemande et l'Orient», in La Revue Universelle, Tome VI, n°10, 15 août 1921.
- Rita THALMANN, Protestantisme et nationalisme en Allemagne (de 1900 à 1945), Librairie Klincksieck, 1976.
- Michel TODA, Henri Massis, un témoin de la droite intellectuelle, La Table Ronde, Paris, 1987.
(*) Moine germano-néerlandais, né à Kempten en 1379 ou en 1380 et décédé à Agnietenberg près de Zwolle en 1471, auteur de cette Imitation de Jésus-Christ qui influença considérablement la pratique quotidienne du christianisme catholique jusqu'en ce siècle, probablement plus que les quatre évangiles! Thomas à Kempis met davantage l'accent sur l'ascétisme que sur la mystique et demande à ses lecteurs de pratiquer une austérité modérée, non extrême, nouant ainsi avec un leitmotiv à la fois hellénique et nordique: celui de la mesure. Mais l'essentiel de cet ouvrage, écrit dans un contexte religieux particulier, celui des Frères de la Vie Commune, dévoués à l'éducation des plus démunis et à la charité. Le sens du service y est très présent. Le texte réclame l'engagement personnel total au profit d'autrui. Dans une perspective politique, et non plus simplement religieuse, cet engagement pourrait être étendu à la Cité entière. Le parallèle que l'on pourrait tracer entre l'Imitation de Jésus-Christ et Der Wanderer zwischen beiden Welten, c'est que les deux ouvrages, l'un religieux, l'autre laïc et militaire, sont des bréviaires anti-individualistes qui ont façonné en profondeur des générations; pendant des siècles pour l'œuvre majeure de Thomas à Kempis; pendant deux à trois décennies pour celle de Flex.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, première guerre mondiale, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 décembre 2008
Erwin Guido Kolbenheyer
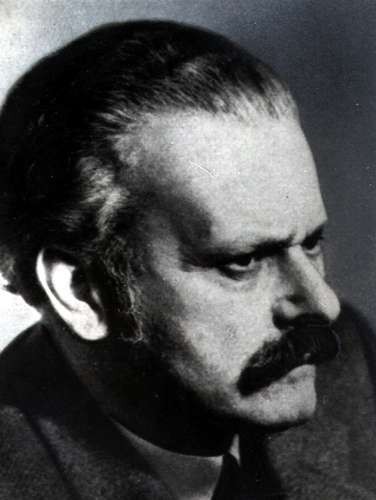
Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962)
Robert Steuckers
Né le 30 décembre 1878 à Budapest, Erwin Guido Kolbenheyer, poète, dramaturge et philosophe, voit le jour dans le foyer d'un célèbre architecte austro-hongrois. Orphelin dès 1881, il s'installe avec sa mère à Karlsbad, dans le pays des Sudètes, où il fréquente le Gymnasium. En 1900, il part à Vienne pour y étudier la zoologie et la philosophie, notamment sous la tutelle des professeurs Hatschek et A. Stöhr. C'est avec l'appui de ce dernier qu'il acquiert son titre de docteur en philosophie en 1904. Mais il renonce à toute carrière universitaire pour se consacrer entièrement à sa poésie, ses drames et ses romans. En 1925, il fait paraître une première version de son ouvrage philosophique majeur, Die Bauhütte, qui sera définitivement achevé en 1940. Honoré de plusieurs prix, il continuera à ¦uvrer jusqu'à sa mort, survenue le 12 avril 1962. Dans toute sonoeuvre, tant philosophique que poétique ou romanesque, Kolbenheyer pose des héros qui incarnent l'être le plus profond de l'homme germanique, caractérisé par un élan vital sans repos; partant, ses héros recherchent, infatigables et tragiques, une connaissance, une puissance, un absolu, un idéal, un dieu, eux-mêmes. Son Paracelse, par exemple, est toujours en errance, toujours à la recherche de la connaissance suprême; dans ce cheminement interminable, Paracelse, précurseur de Faust, s'éloigne toujours davantage de l'Eglise et de ses lois. Il cherche, dans la foi, une liberté totale et, en Dieu, le repos éternel, sans jamais trouver ni l'une ni l'autre. Chacun des volumes de sa trilogie paracelsienne est précédé d'un dialogue entre le Christ et Wotan et contient plusieurs dialogues entre Paracelse et un représentant de la "vieille culture" classique, désormais incapable d'étancher la "soif métaphysique" des hommes. A un représentant de la Curie romaine, venu en Allemagne pour enquêter sur les progrès de la Réforme, Paracelse reproche de défendre des formes, figées et raidies, sans contenu, sans substance. Le Réforme est, aux yeux de Kolbenheyer, le retour de l'humanité germanique à la substance vitale, au-delà des formes figées, imposées par l'Eglise de Rome. Dans l'¦uvre de Kolbenheyer, resurgissent tous les débats de la réforme et de la renaissance, de l'humanisme et de la nouvelle vision du cosmos (celle d'un Giordano Bruno notamment), autant de Schwellenzeiten, d'époques-seuil, où il est impératif d'adapter l'esprit au temps. Pour notre auteur, l'histoire de la pensée européenne est marquée par l'opposition entre, d'une part, un dynamisme adaptatif/mouvant/plastique, ancré dans un humus populaire précis, et un statisme absolu rigide, immobile et planant au-dessus de l'oikos des hommes. Spinoza, Paracelse, Giordano Bruno, le personnage de Kolbenheyer Meister Joachim Pausewang, sont des représentants du dynamisme. Les églises et les dogmes, religieux ou laïques, sont des éléments de statisme, des cangues dont il faut sortir.
L'atelier. Eléments pour une métaphysique des temps présents (Die Bauhütte. Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart) 1925-1952
Idée centrale de cet ouvrage philosophique de Kolbenheyer: l'humanité, fascinée par les absolus postulés par les métaphysiques désincarnées, ne parvient plus à s'adapter aux impératifs des temps présents. Ceux-ci exigent une métaphysique souple, plastique, sans forme systématique définitive. L'homme a besoin de métaphysique pour s'orienter dans l'avalanche de données que lui communique le monde. La métaphysique lui sert de fil d'Ariane. Sans elle, il tâtonne. Les métaphysiques classiques ont toutes été des systèmes qui se voulaient définitifs et absolus, qui avaient pour but d'ordonner les idées, les connaissances et les valeurs humaines selon une idée centrale, généralement une conception de Dieu ou du monde, issue d'un état particulier d'adaptation de l'homme au monde dans un contexte spatio-temporel déterminé mais révolu. Mais quand le monde change sous la pression des événements, quand le changement provoque à l'échelle européenne une "crise de conscience", les métaphysiques classiques, de Pascal à Leibniz et à Rousseau, s'effondrent. On tente de les remplacer par l'idée du Moi, l'idée de la matière ou l'idée de l'esprit, l'idée de la collectivité ou l'idée du rien (nihilisme), sans se rendre compte que ces idées n'ont pas de contenu réel correspondant au nouvel état d'adaptation de l'humanité. Pire: ces idées sans contenu réel ont servi à construire des systèmes que l'on a posé comme définitifs, alors que la vitesse des changements, donc la nécessité vitale d'adaptations rapides successives, impliquait de se débarrasser de toute espèce de rigidité.
Question majeure que pose Kolbenheyer: qu'est-ce que la pensée? Elle est 1) l'intégration consciente de tout ce que nous vivons dans le monde de la conscience et 2) le fait de compléter, de classer et de construire sans cesse ces diverses sensations. Le siège de ce processus d'intégration, de complétement, de classification et de construction est le cerveau humain, conditionné par une biologie et une hérédité précises. Ce site, différent d'une multitude d'autres sites analogues, exclut la croyance naïve et dépassée en un esprit d'essence indépendante. Ces déterminations du siège de la pensée, c'est-à-dire du cerveau, lié à d'autres cerveaux par le jeu infini et kaléidoscopique du code génétique, se heurtent à des résistances continuelles qu'il faut vaincre, dépasser ou contourner. Les communautés de cerveaux unies par un même code génétique, lequel est variable à l'infini, produisent des idées directrices qui font montre d'une certaine durée dans l'histoire. Ces idées directrices sont métaphysiques, selon Kolbenheyer, car elles transcendent les individualités qui les incarnent plus ou moins bien. La métaphysique, de cette façon, est descendue de l'au-delà dans le monde réel. Les données du problème de la métaphysique sont les hommes, les hommes dans la vie et la vie dans les hommes et non pas un au-delà quelconque auquel il s'agit d'arriver, non pas un absolu fixé d'avance, indéterminé et indéterminable auquel l'homme doit adapter sa vie. La métaphysique est de ce fait "un point parfait d'adaptation intérieure et extérieure de l'homme" qui, nécessairement, diffère d'un individu à l'autre, d'un peuple à l'autre. De cette définition différenciée à l'infini de la métaphysique découle un dépassement de l'idéalisme et du rationalisme; ces systèmes faisaient de la pensée un "cadre" sans contenu. Pour Kolbenheyer, la pensée est et cadre et contenu en interaction ininterrompue. La pensée est ainsi à la foi force absorbante et force créatrice et n'a de valeur et d'importance que si elle remplit ce double rôle.
L'horizon de la pensée est, chez Kolbenheyer, celui de la "vie plasmatique", qui n'est pas un être en soi supérieur auquel les formes d'individuation sont subordonnées; il n'existe pas d'être plasmatique en dehors des formes d'individuation, ce qui n'empêche pas de penser à un rapport originel et générateur entre les formes d'individuation sur le plan de l'évolution générale. Ce qui existe en tant que vie, est de la vie différenciée, de la vie en train de s'adapter. Kolbenheyer dégage les lois de la "plasmogénèse" c'est-à-dire de l'individuation du plasma et de sa conservation dans les individus; le plasma adapté (c'est-à-dire l'individu) ne peut être ramené à un degré d'individuation par lequel il a passé précédemment; la part de plasma dont les capacités ne résistent pas par l'adaptation au changement des époques géologiques cosmiques disparaît. La substance vitale, le plasma, est répartie entre tous les peuples de la terre. Pour parfaire leur rôle historique, pour créer des formes culturelles viables et sublimes, pour exprimer les potentialités de ce plasma qui leur est échu, les peuples épuisent graduellement leur capital en plasma. Les peuples jeunes sont ceux qui disposent encore d'une grande quantité de plasma non transformé en formes. Plus la quantité de plasma résiduel est importante, plus la vitalité du peuple est intense. Les peuples trop encombrés de formes ont terminé leur cycle et se retirent petit à petit de la scène du monde.
De cette vision biologico-mystique, Kolbenheyer déduit une éthique individuelle répondant à une maxime paraphrasant Kant: "Agis toujours de façon telle, que tu puisses être convaincu d'avoir fait par tes actions le meilleur et le maximum pour que le type humain, dont tu es issu, puisse être maintenu et se développer". L'individualité est, dans cette optique, "exposant de fonction"; il est une modalité de l'adaptation au réel du donné plasmatique. Par conséquent, ne sont immortelles que les prestations de l'individualité qui ont accru les capacités adaptatives du plasma. De la maxime énoncée ci-dessus et de cette notion d'immortalité des prestations, découle une éthique du devoir. L'individualité doit maintenir et développer la vie, au-delà de sa propre existence individuelle, et mettre en ¦uvre, dans ce but, toutes ses énergies. L'individu en soi, dans la perspective kolbenheyerienne, n'existe pas car tous les hommes sont reliés au paracosmos, et ont ainsi en commun bon nombre de traits supra-individuels; de plus, l'individualité, au cours de son existence, change et est appelée à jouer des rôles différents: celui de l'enfant, puis celui de l'époux, du père, celui que postule sa fonction sociale, etc. Il y a différenciation constante, ruinant toute rigidité posée comme en soi. On a parlé de l'¦uvre philosophique de Kolbenheyer comme d'un "naturalisme métaphysique" (R. König) ou d'un "matérialisme biologique" (E. Keller).
(Robert Steuckers).
- Bibliographie non exhaustive; nous ne reprenons que les ouvrages littéraires de Kolbenheyer ayant un intérêt philosophique; une bibliographie complète, établie par Kay Nieschling, se trouve dans Peter Dimt (cf. infra); par ailleurs, le lecteur pourra s'adresser à la Kolbenheyer-Gesellschaft e. V., Schnieglinger Straße 244, D-8500 Nürnberg, pour tout renseignement sur l'auteur. Cette société édite également un périodique d'exégèse de l'¦uvre d'EGK, intitulé Der Bauhütten-Brief.
Giordano Bruno, 1903 (tragédie); Die sensorielle Theorie der optischen Raumempfindung, 1905 (thèse); Amor Dei, 1908 (roman sur Spinoza); Meister Joachim Pausewang, 1910 (roman où intervient la figure de Jakob Böhme); Montsalvach, 1912; Die Kindheit des Paracelsus, 1917 (premier tome de la trilogie paracelsienne); Wem bleibt der Sieg?, 1919; Das Gestirn des Paracelsus, 1922 (tome 2); Die Bauhütte. Grundzüge einer Metaphysik der Gegenwart, 1925 (première version); Das dritte Reich des Paracelsus, 1926 (tome 3); Heroische Leidenschaften, 1929 (nouvelle mouture de Giordano Bruno); Aufruf an die Universitäten, 1930 (discours); Das Gesetz in dir, 1931 (théâtre); Die volksbiologischen Grundlagen der Freiheitsbewegung, 1933 (essai); Gregor und Heinrich, 1934 (pièce de théâtre mettant en scène le Pape et l'Empereur et les valeurs qu'ils incarnent); Unser Befreiungskampf und die deutsche Dichtung, 1934 (discours); Der Lebensstand der geistig Schaffenden und das neue Deutschland, 1934 (discours); Arbeitsnot und Wirtschaftskrise biologisch gesehen, 1935 (article); Das gottgelobte Herz, 1938 (roman avec pour thème la mystique allemande); Der Einzelne und die Gemeinschaft, 1939 (discours); Goethes Denkprinzipien und der biologischen Naturalismus, 1939 (discours); Die Bauhütte, 1940 (nouvelle version); Das Geistesleben in seiner volksbiologischen Bedeutung, 1942 (discours); Menschen und Götter, 1944 (tétralogie dramatique); Die Bauhütten-Philosophie, 1952 (troisième édition, complétée de textes nouveaux); Sebastian Karst über sein Leben und seine Zeit, I, 1957 (autobiographie); Sebastian Karst über sein Leben und seine Zeit, II & III, 1958 (autobiographie, suite); Metaphysica viva, 1960; éditions posthumes: Wem bleibt der Sieg?, 1966 (anthologie comprenant le texte de 1919 portant le même titre); Vorträge, Aufsätze, Reden, 1966 (‘uvres complètes, 2/VII); Die Bauhütte, 1968 (4ième éd.); Mensch auf der Schwelle, 1969; Du sollst ein Wegstück mit mir gehn, 1973 (anthologie); Gesittung. Ihr Ursprung und Aufbau, 1973; Kämpfer und Mensch. Theoretischer Nachlaß, 1978; Rationalismus und Gemeinschaftsleben, 1982. Les ‘uvres complètes, publiées à l'initiative de la Kolbenheyer-Gesellschaft, sont parues entre 1956 et 1969.
- Sur Kolbenheyer: Conrad Wandrey, Kolbenheyer. Der Dichter, der Philosoph, Langen/Müller, Munich, 1934; Franz Westhoff, E.G. Kolbenheyers Paracelsus-Trilogie - eine Metaphysik des deutschen Menschen, Thèse, Münster, 1937; Ernst Heinrich Reclam, Die Gestalt des Paracelsus in der Dichtung. Studien zu Kolbenheyers Trilogie, Thèse, Leipzig, 1938; H. Vetterlein, "Kolbenheyer-Bibliographie", in Dichtung und Volkstum (Euphorion), 40, 1939, pp. 94-109; E. Fuchs, Das Individuum und die überindividuelle Individualität in Kolbenheyers historischen Romanen, 1940; Franz Koch, "E.G. Kolbenheyers Bauhütte und die Geisteswissenschaften", in Dichtung und Volkstum (Euphorion), 41, 1941, pp. 269-296; H. Seidler, "Kolbenheyer über die Dichtkunst", in Dichtung und Volkstum (Euphorion), 41, 1941, pp. 296-321; Paul Lespagnard, "Erwin Guido Kolbenheyer", in Bulletin de l'Ouest, Bruxelles, 15 avril 1942, 2, pp. 18-20; Paul Lespagnard, "L'oeuvre de E.G. Kolbenheyer. La "Bauhuette"", in Bulletin de l'Ouest, Bruxelles, 15 nov. 1943, 20, pp. 230-233 et 30 nov. 1943, 21, pp. 241-244; St. R; Townsend, Kolbenheyers Conception of the German Spirit and the Conflict with Christianity, 1947; H.D. Dohms, Die epische Technik in Kolbenheyers Roman "Das gottgelobte Herz", 1948; Franz Koch, Kolbenheyer, Göttinger Verlagsanstalt, Göttingen, 1953; Robert König, Von Giordano Bruno zu E.G. Kolbenheyer, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1961; A.D. White, The Development of the Thought of E.G. Kolbenheyer from 1901 to 1934, 1967; Otto Schaumann, Die Triebrichtungen des Gewissens, Orion-Heimreiter, Francfort s.M., 1967; Ernst Frank, Jahre des Glücks. Jahre des Leids. Eine Kolbenheyer-Biographie, blick + bild, Velbert, 1969 (principale biographie de l'auteur; avec 95 ill.); Ernst Keller, "Der Weg zum deutschen Gott: E.G. Kolbenheyer", in Ernst Keller, Nationalismus und Literatur, Francke, Berne/Munich, 1970; Robert König, Der metaphysische Naturalismus E.G. Kolbenheyers, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1971; Robert König, Ein Gedenkblatt zu seinem 10. Todestag am 12. April 1972, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1972; Alain de Benoist, "Paracelsus: roman d'Erwin Guido Kolbenheyer", in Nouvelle Ecole, 29, 1976, pp. 126-131; Robert Steuckers, "Le centenaire de Kolbenheyer", in Pour une renaissance européenne, Bruxelles, 27/28, 1979, pp. 270-276; Herbert Seidler, "Erwin Guido Kolbenheyer", in Neue Deutsche Biographie, Band 12, Duncker u. Humblot, Berlin, 1980; Peter Dimt, Schlederloher Teestunde. Vierzig Anekdoten um Erwin Guido Kolbenheyer, Türmer, Berg, 1985 (avec bibliographie complète des ¦uvres de EGK); Hedwig Laube, Von Erwin Guido Kolbenheyers Ethos aus Naturerkenntnis, Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1985; Hedwig Laube, Religion in Kolbenheyers Werk, tiré à part édité par la Kolbenheyer-Gesellschaft, Nuremberg, 1989; Karl Hein, "Er hieß Kolbenheyer und schuf den biologischen Sozialismus für das 21. Jahrhundert", in Elemente, Kassel, 4, 1990.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne, autriche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 17 novembre 2008
E. Diederichs: grand éditeur, romantique et universaliste
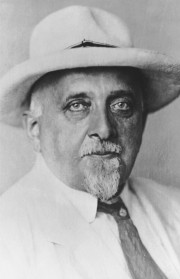
Eugen Diederichs: grand éditeur, romantique et universaliste
Michael MORGENSTERN
«S'il y avait des conspirateurs parmi nous, des conspirateurs rassemblés dans un cénacle à la fois ouvert et secret, qui médite et œuvre pour forger le grand avenir et auquel peuvent se joindre tous ceux à qui il peut donner la parole pour exprimer leur aspirations et qui disent: “nous sommes las de nous satisfaire de choses achevées et préfabriquées”»: ce texte figurait en exergue sur le papier à en-tête des éditions Eugen Diederichs d'Iéna au début du siècle. Son auteur était Paul de Lagarde, qu'Eugen Diederichs vénérait et qu'il considérait comme l'un de ses principaux inspirateurs à côté de Nietzsche et de Julius Langbehn (l'auteur de Rembrandt als Erzieher, = Rembrandt comme éducateur). Avec ces trois grandes figures de la pensée allemande de la fin du XIXième siècle, l'éditeur Diederichs partageait la conviction que tout véritable renouveau ne proviendrait que de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle le nom de l'éditeur d'Iéna apparaissait à l'époque partout où surgissait de la nouveauté.
Ses intérêts le portait tout particulièrement à valoriser et à diffuser les linéaments idéologiques véhiculés par les mouvements réformateurs néo-romantiques et “alternatifs” nés au tournant du siècle: la FKK (la “culture des corps libres”, soit le naturisme), les méthodes nouvelles en pédagogie, le mouvement végétarien, les tentatives de généraliser l'homéopathie, le mouvement des cités-jardins en urbanisme, les compagnonnages de travailleurs, etc. Pour promouvoir toutes ses innovations, Diederichs proposait aussi une nouvelle esthétique du livre, où textes, couvertures, lettrages, etc. reflétaient les idées et pulsions nouvelles dans le domaine de l'art. En effet, Diederichs était avant tout un éditeur.
Né en 1867 dans la propriété foncière d'une lignée de chevaliers près de Naumburg, Diederichs a d'abord voulu perpétuer la tradition familiale et devenir agriculteur. Mais très rapidement, son penchant à dévorer des livres a pris le dessus et le jeune homme a choisi une profession qui ne mettrait aucun frein à son insatiable fringale de lectures. Diederichs n'était pas qu'un rêveur passionné et un romantique perdu dans ses songes: il était doué d'un solide sens pratique des affaires, qu'il a étayé au cours de quelques années d'apprentissage en Allemagne du Sud. Pendant un voyage en Italie, il décide à Rimini, en août 1896, de s'engager totalement “et tout seul dans un combat contre son époque”. Avec pour atouts les poèmes d'un ami et un héritage, il fonde sa maison d'édition à Florence, puis la transplante rapidement à Leipzig. Elle connaître son apogée à Iéna quelques années plus tard.
Dès ses premiers mois d'activités en Italie, le jeune éditeur avait noué des contacts avec toute une série d'auteurs et leur avait fait part de ses intentions. Pour Diederichs, le néo-romantisme du tournant du siècle n'était nullement un tissu de rêveries désincarnées, mais “après l'âge des spécialistes, après l'ère d'une culture ne reposant que sur la seule raison raisonnante, ce néo-romantisme veut regarder le monde et en jouir dans son intégralité. Dans la mesure où ce néo-romantisme saisit à nouveau le monde par le truchement de l'intuition, il dépasse aussitôt ces phénomènes que sont le matérialisme et le naturalisme qui procèdent tous deux de cette culture de la raison raisonnante”. A cette intention de Diederichs correspond l'œuvre des philosophes de la Vie qui critiquent le morcellement conceptuel du monde, dû à un excès d'analytisme, et revalorisent la pensée holiste, tout en déplorant les dégâts de l'industrialisme et en appelant à un retour à la nature. Cette option holiste et “écologique” (avant la lettre) conduit Diederichs à éditer les travaux de Henri Bergson, qui deviendra rapidement le philosophe le plus emblématique de la maison.
Diederichs était un universaliste, dans le sens où il ne voulait rester étranger à rien de ce que les cultures humaines avaient produit, et ambitionnait d'éditer dans sa maison le meilleur de ce que l'esprit des hommes avait généré. Ainsi, Diederichs a publié les sagas, les légendes et les contes de tous les peuples de la Terre, de même que les chroniques de la Renaissance, la poésie vieille-norroise (dans la collection “Thule”), les textes des philosophes chinois et indiens. Ensuite, Diederichs a soutenu les efforts des nouvelles orientations religieuses en Allemagne, les religiosités libres, qui critiquaient les églises servant de piliers à l'Etat, en publiant les écrits des mystiques allemands —Diederichs estimait que Maître Eckehart était de loin supérieur à Luther— et l'œuvre de Kierkegaard.
Dans les années qui ont immédiatement précédé la première guerre mondiale, les intérêts de Diederichs glissent du religieux au politique. Il suscite tout de suite l'intérêt général du public en éditant des autobiographies d'ouvriers comme la Lebensgeschichte eines modernen Fabrikarbeiters (Histoire de la vie d'un ouvrier des fabriques moderne) de William Bromme. Son objectif était de “déprolétariser le socialisme” et d'“approfondir l'idée nationale”. Diederichs se positionnait comme un héritier spirituel de Herder et s'intéressait dès lors à la culture des héritages populaires, dans une perspective authentiquement ethnopluraliste: «Nous n'aurons le droit de nous affirmer nationalistes que lorsque nous aurons compris et respecté la spécificité des autres peuples. Car c'est en cela que réside la richesse de la Vie, qui est une polysymphonie; il n'y a aucun peuple qui puisse s'ériger en exemple absolu et il n'y a pas d'idéologie qui puisse prétendre à la domination absolue». Cette phrase, Diederichs l'a faite inscrire dans le catalogue de sa maison d'édition en 1912. Pour détenir un organe de presse capable de véhiculer sa vision du monde et de la politique, il rachète une revue fondée auparavant par le “mouvement religieux libre”, Die Tat, qu'il transforme en un mensuel de culture et de politique. Elle deviendra ultérieurement, sous la direction de Hans Zehrer, l'organe majeur de la “Konservative Revolution”.
Diederichs, homme d'âge mûr, s'est d'abord montré assez réservé face au mouvement de jeunesse “Wandervogel”, dont le style était franchement bohème, rustaud et anarchisant au début. Ses premiers contacts avec les jeunes contestataires du tournant du siècle eurent lieu par l'intermédiaire du Cercle “Sera”, qu'il avait lui-même contribué à lancer. Ce Cercle “Sera” devait son nom à une danse festive dont le refrain était “Sera, sera, sancti Domine”). En organisant des solstices, en réhabilitant les danses populaires, en relançant le théâtre en plein air et les randonnées des Vaganten médiévaux, ce Cercle Sera entendait expérimenter de “nouvelles formes de socialité sur l'herbe des prairies”. Diederichs a évoqué ses raisons: «Ce qui m'a amené à soutenir de telles initiatives, est tout simplement ma propre nostalgie des fêtes dans la nature, où il n'y avait pas de spectateurs, mais où tous participaient».
L'enthousiasme de l'éditeur pour ces fêtes champêtres ne manquait pas de comique, se souvient l'un de ses auteurs les plus en vue, Hans Blüher. Celui-ci se remémore dans ses souvenirs le temps “où ce monsieur vieillissant, vêtu d'un costume ressemblant à celui d'un paysan balkanique, avec un bâton de Thyros à la main et du lierre dans les cheveux, traversait les rues d'Iéna pour s'en aller dans les collines autour de la ville, juché sur une calèche branlante, entouré de toute une jeunesse, de préférence de sexe féminin, afin de sacrifier à des cultes de nature dionysiaque». En compagnie de son Cercle Sera, Diederichs a participé à la grande fête de la jeunesse Wandervogel qui eut lieu en 1913 sur le Hoher Meissner. Il édita le livre consacré à cette rencontre historique avec, en frontispice, la célèbre gravure de l'artiste Fidus, intitulée Hohe Wacht.
Diederichs a développé une véritable critique de l'Etat autoritaire wilhelminien, en s'insurgeant principalement contre la rigidification des églises, de l'école et de la science. Très logiquement, il devait aboutir à une théorisation du Volksstaat, qui aurait parfaitement pu se passer du parlementarisme à l'occidentale et aurait dû être construit selon des principes “organiques et décentralisés”. Diederichs parlait de “conservatisme social”. Quand éclate la révolution socialiste des conseils d'ouvriers et de soldats en 1918, il est gonflé d'espoir mais cet enthousiasme s'effondre rapidement, dès que l'élan révolutionnaire s'enlise dans le plus plat et le plus vulgaire des matérialismes. Alors l'“Eugen aux yeux de spectre” (dixit Julius Hart), qui n'avait jamais perdu sa mélancholie, fond de sa personnalité, se retira de toute vie publique, mais s'engagea résolument dans la défense de la culture populaire allemande, contre l'“américanisation et l'atomisation [sociale]”.
En 1930, Eugen Diederichs meurt. Quelques années avant de quitter ce monde, il avait encouragé la création des “Cellules pour la Reconstruction Spirituelle de l'Allemagne” (Zellen zum geistigen Neuaufbau Deutschlands), émanations du mouvement de jeunesse Wandervogel d'avant la guerre: «Il est bon que ces cellules demeurent encore discrètes pendant quelque temps, car la psyché du peuple n'a pas à défiler dans les rues: elle doit se reconstituer et croître dans le silence et la tranquillité. Tous ceux qui vivent pour maintenir, conserver et développer leur psyché spécifique, sentent qu'ils appartiennent à un Cénacle secret, où tous se sont juré fidélité, en attendant le Grand Matin. Car il viendra ce Grand Matin. Mais il ne viendra pas tout seul, car il faut d'abord labourer la terre avant de pouvoir la semer».
Michael MORGENSTERN.
(article tiré de Junge Freiheit, n°4/1995; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, lettres, littérature, édition, lettres allemandes, littérature allemande, édition allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 14 novembre 2008
Os novos deuses
Os novos deuses
ex: http://inconformista.info/
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : allemagne, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 novembre 2008
Ecrits de guerre, mobilisation totale et "Travailleur": Jünger, penseur politique radical
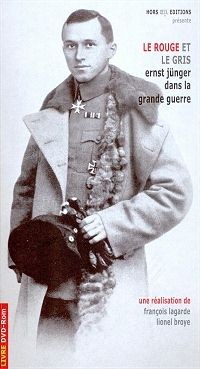
Ecrits de guerre, mobilisation totale et «Travailleur»: Jünger, penseur politique radical
Wolfgang HERRMANN
Toutes les idées que le nationalisme révolutionnaire a développé pendant les dix premières années qui ont suivi la Grande Guerre ont trouvé leur apex dans l'œuvre d'Ernst Jünger. Les résidus du Mouvement de Jeunesse —qui avait littéralement “fondu” au cours des hostilités— les éternels soldats par nature, les putschistes, les révolutionnaires et les combattants du Landvolk ont toujours trouvé en Jünger l'homme qui exposait leurs idées. Mais Ernst Jünger est allé beaucoup plus loin qu'eux tous, ce qu'atteste le contenu du Travailleur. Il n'en est pas resté à une simple interprétation des événements de la Guerre, ce qui fut son objet dans Der Kampf als inneres Erlebnis, résumé de ces impressions de soldat. Ce mince petit volume sonde les sensations du soldat de la première guerre mondiale, en explore la structure. Et ce sondage est en même temps l'expression d'une nouvelle volonté politique, la première tentative de fonder ce “réalisme héroïque”, devenu, devant les limites de la vie, sceptique, objectif et protestant. En revenant de la guerre, Jünger a acquis une connaissance: l'empreinte que ce conflit a laissé en lui et dans l'intériorité de ses pairs, est plus mobilisatrice, plus revendicatrice et plus substantielle que le message des idéologies dominantes de son époque. Voilà pourquoi la Guerre a été le point de départ de ses écrits ultérieurs, dont Le Travailleur et La mobilisation totale. Ces deux livres pénètrent dans une nouvelle “couche géologique” de la conscience humaine et modifient la fonction de celle-ci dans le monde moderne. Les deux livres partent du principe de la mobilisation totale, que la Guerre a imposé aux hommes. D'un point de vue sociologique, la guerre moderne est un processus de travail, de labeur, immense, gigantesque, effroyable dans ses dimensions; elle mobilise l'ensemble des réserves des peuples en guerre. Les pays se transforment en fabriques géantes qui produisent à la chaîne pour les armées. Par ailleurs, la guerre de matériel devient pour les troupes combattantes elles-mêmes une sorte de processus de travail, que les techniciens de la guerre ont la volonté de mener à bien. Le nouveau type d'homme qui est formé dans un tel contexte est celui du Travailleur-Soldat, chez qui il ne reste rien de la poésie traditionnelle du Soldat et qui ne jette plus son enthousiasme mais son assiduité dans la redoute qu'il est appelé à occuper. Jünger sait désormais que “la mobilisation totale, en tant que mesure de la pensée organisatrice, n'est qu'un reflet de cette mobilisation supérieure, que le temps accomplit en nous”. Et cette mobilisation-là est inéluctable, la volonté consciente de l'individu ne peut rien y changer. La mobilisation totale des dernières énergies prépare, même si elle est en elle-même un processus de dissolution, l'avènement d'un ordre nouveau. La figure qui forgera cet ordre nouveau est celle du Travailleur. L'image de ce Travailleur, de ce phénomène qui fait irruption dans notre XXième siècle, nous la trouvons dans l'éducation et les arts modernes; Jünger l'a conçue d'après les caractéristiques du Soldat du Front et d'après le modèle russe où le Travailleur devient le Soldat de la Révolution. Jünger ne conçoit pas la catégorie du Travailleur comme un “état” (Stand) de la société, comme le veut la science bourgeoise, ou comme une classe, à l'instar du marxiste, mais voit dans le Travailleur un nouveau type humain en advenance, une nouvelle mentalité en gestation, qui réussira la fusion de la liberté et du pouvoir. Seul le Travailleur entretient encore une “relation illimitée avec les forces élémentaires”, qui ont pénétré dans l'espace bourgeois, en opérant leur œuvre de destruction. Conservateurs traditionnels et Chrétiens ont attaqué ce livre radical avec une véhémence affirmée. Le Travailleur reste néanmoins un ouvrage difficile à lire: il recèle une indubitable dimension philosophique; il aborde la problématique en changeant constamment de point de vue, ce qui exige de la part du lecteur une communauté de pensée et une capacité à se remettre perpétuellement en question. (...).
Wolfgang HERRMANN.
(extrait de Der neue Nationalismus und seine Literatur, San Casciano Verlag, Postfach 1306, D-65.533 Limburg; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, allemagne, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 octobre 2008
H. von Hofmannsthal et "l'enténèbrement du monde"
Hugo von Hofmannsthal et « l’enténèbrement du monde »
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, autriche, révolution conservatrice, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 octobre 2008
"Ich wollte nicht danebenstehen..."
Bräuninger, "Ich wollte nicht danebenstehen ..." |
| Werner Bräuninger ist unter den zahllosen Autoren, die sich auch Jahrezehnte nach dessen Untergang mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Er will in seinem Buch Männer und Frauen vorstellen, "deren Namen schon fast ausgelöscht schienen". Seine Darstellungen helfen, jene Zeit zu verstehen, die uns offenbar nicht losläßt. |
| Werner Bräuninger ist unter den zahllosen Autoren, die sich auch Jahrzehnte nach dessen Untergang mit dem Nationalsozialismus beschäftigen, einer der originellsten. Jetzt legt er mit seinem Buch "Ich wollte nicht daneben stehen ..." eine Sammlung von Essays vor, die sich mit Lebensentwürfen von bemerkenswerten Persönlichkeiten befassen, die von vielen Aspekten des Nationalsozialismus wie der Person Adolf Hitlers fasziniert waren, auch wohl in großen Zügen den von ihm verkündeten Zielen zustimmten, wie etwa Deutschland aus seiner tiefen Erniedrigung nach dem Ersten Weltkrieg herauszuführen und die deutsche Parteizwietracht zu überwinden, die sich aber meist der nationalsozialistischen Bewegung nicht anschlossen. Manche verwendeten sich nach den ersten Jahren der NS-Machtausübung enttäuscht ab, keiner war an der praktischen Politik beteiligt. Da stößt man auf Namen wie dem des politischen Pädagogen und führenden nationalsozialistischen Philosophen Alfred Baeumler, der sich weigerte, Berlin zu verlassen und als Volkssturmmann an der Verteidigung teilnahm; auf Arno Breker, der bis 1945 und dann auch wieder nach Jahrzehnten der Diffamierung als einer der großen Bildhauer des 20. Jahrhunderts anerkannt wurde; auf Ernst Bertram, der in den 20er und 30er Jahren als einer der führenden Gelehrten der Zeit galt, befreundet mit Thomas Mann, dem Stefan-George-Kreis angehörend, der seine ganze Hoffnung auf Hitler setzte, aber nie NSDAP-Mitglied wurde; auf die Engländerin Winifred Wagner, Ehefrau des Richard-Wagner-Sohns Siegfried, die auch nach 1945 zu ihrer Freundschaft zu Adolf Hitler stand. Berichtet wird über den erstaunlichen Gelehrten Ernst Kontorowicz, 1895 in Posen geboren, deutscher Jude, Offizier, im Ersten Weltkrieg hoch dekoriert, Freikorpskämpfer, dessen Hauptwerk über den Staufen-Kaiser Friedrich II. auch heute noch von hoher Bedeutung ist. Auch er gehörte zum Kreis von Stefan George. Sein Ziel war eine deutsch-jüdische Symbiose. Als er als Professor den Amtseid auf Hitler ablegen mußte, verweigerte er ihn und emigrierte, blieb aber stets Deutschland verbunden. Ernst Jünger ist ein langes Kapitel gewidmet, Wandervogel, Offizier, Pour-le-Merite-Träger, Autor. Seine Bücher fanden in der intellektuellen Welt höchste Beachtung. Den nationalen Aufbruch hatte er zunächst freudig begrüßt, zog sich aber später enttäuscht zurück. "Krieger und Träumer, Autor und Soldat, radikaler Nationalist und Künder einer neuen Zeit, Dandy und Einzelgänger" apostrophiert ihn Bräuninger. Leni Riefenstahl ist ein verständnisvolles Kapitel gewidmet, jener genialen deutschen Filmregisseurin, die international mit höchsten Preisen geehrt wurde. Ihr Film über die Olympischen Spiele 1936 wurde als "bester Film der Welt" 1938 in Paris prämiert. Ihr ging es um nichts anderes, als in ihren Filmen "das Schöne, Starke, Gesunde" darzustellen, kurz: "Ich suchen die Harmonie." 1945 wurde auch sie verfemt und boykottiert, bis ihr vor einigen Jahrzehnten eine Renaissance zuerst im Ausland, dann auch in Deutschland Gerechtigkeit widerfahren ließ. Bereichert werden die Essays durch ein Personenverzeichnis, in dem man intellektuell wichtige Persönlichkeiten aus dem Deutschland des 20. Jahrhunderts findet, deren Leben und Bedeutung kurz skizziert wird. Bräuninger will in seinem Buch Männer und Frauen vorstellen, "deren Namen schon fast ausgelöscht schienen". Seine Darstellungen helfen, jene Zeit zu vertehen, die uns offenbar nicht losläßt. "Preußische Allgemeine Zeitung 19. Mai 2007" |
00:18 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  | Index&media=news" rel="nofollow">
| Index&media=news" rel="nofollow"> Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 septembre 2008
Jünger et l'Allemagne secrète

Jünger et l'Allemagne secrète
Antonio GIGLIO
La polémique qui s'est déclenchée à propos d'Ernst Jünger, remet à l'avant-plan, une fois de plus, les fantasmes nés de la guerre civile européenne et du passé qui ne passe pas, mais, pire encore, les fantasmes plus insidieux générés par l'incompréhension totale de nos contemporains face à l'histoire politique et culturelle de ce siècle. A Jünger qui est aujourd'hui, à 100 ans, le plus grand écrivain européen vivant, on a reproché d'être, dans le fond, un complice des nazis. Pour clarifier cette question, il nous apparaît opportun de récapituler, depuis le début, l'histoire des activités politiques et culturelles de Jünger, le héros de la Première Guerre mondiale, un des rares soldats de l'armée impériale, avec Rommel, à avoir reçu la plus haute décoration militaire allemande, l'Ordre “Pour le Mérite”. Le thème des premières œuvres littéraires de Jünger est l'expérience de la guerre, dont témoigne notamment son célèbre roman Orages d'acier. Ces livres de guerre lui ont permis de devenir en peu de temps l'un des écrivains les plus lus et les plus fameux de l'Allemagne. En outre, Jünger est rapidement devenu l'un des chefs de file du nouveau nationalisme, suscité par les conditions de paix très dures imposées à l'Allemagne. Il réussit à forger une série de mythes politiques représentant la synthèse ultra-révolutionnaire de tout ce que la droite allemande avait produit à cette époque.
L'écrivain évoluait entre les bureaux d'études de l'armée, les groupes paramilitaires et nationaux-révolutionnaires, et réussissait à fusionner plusieurs projets politiques: celui du philologue Wilamowitz visant la création d'un Etat régi par un Ordre ascétique ou une caste sélectionnée d'hommes de culture et de science, celui de Spengler visant le contrôle et la domination des nouvelles formes technologiques en train de transformer le monde, celui du poète Stefan George chantant une nouvelle aristocratie, celui de Moeller van den Bruck axé sur la nécessité de rénover de fond en comble le “conservatisme” ou plutôt sur la nécessité de lancer une “révolution conservatrice”, formule inventée par le poète Hugo von Hoffmannsthal et traduite par Jünger en termes ultra-nationalistes et guerriers. Pourtant, Jünger, influencé par la furie iconoclaste de Nietzsche, propose à l'époque de détruire totalement la société bourgeoise, ce qui lui permet d'utiliser aussi les mythes politiques de la gauche, dont l'idée bolchévique suggérée par Lénine, soit la mobilisation totale et militaire de l'Etat, utilisée auparavant en Allemagne par le Général Erich Ludendorff; chez Jünger, cette mobilisation totale deviendra la mobilisation totale de tout ce qui est allemand. Enfin, il utilise le mythe du travailleur-soldat, déjà loué par Trotsky; Jünger l'adopte et le propose, transformé par la pensée du philosophe Hugo Fischer. Cette synthèse de Lénine, Trotsky et Fischer deviendra Le Travailleur, au moment même où Jünger est l'allié du national-bolchévique Ernst Niekisch. Il faut encore noter que la pensée philosophique et politique de Heidegger a été profondément influencée par ce célébrissime essai de Jünger, qui moule audacieusement en une puissante unité philosophique la technique, le nihilisme et la volonté de puissance.
Parallèlement, l'écrivain se propose d'unifier tous les mouvements nationalistes allemands; c'est cette intention qui explique sa tentative initialement favorable à Hitler; il suffit de penser à la dédicace rédigée de son livre de 1925, Feuer und Blut (= Feu et Sang) à l'intention du “Führer national” Adolf Hitler, même si l'année précédente, il avait désapprouvé la décision des nazis d'adopter des méthodes légales et craint une trahison nationale-socialiste à l'égard de la pureté des idéaux nationaux-révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, en 1927, Hitler propose à Jünger un siège au Parlement, mais l'écrivain ne l'accepte pas parce qu'il refuse le parlementarisme et toute forme de parti. Après 1933, Jünger se retire complètement de la politique parce qu'il est trop élitaire, aristocratique et révolutionnaire pour accepter qu'un mouvement de masse s'accapare de ses idées; par ailleurs, il se sent trop impliqué dans bon nombre d'idées nationalistes pour pouvoir critiquer ouvertement le nouveau régime. En 1939, cependant, Jünger semble vouloir intervenir directement, de manière critique, dans le régime nazi, en publiant son roman Sur les falaises de marbre. Selon un philosophe allemand contemporain, Hans Blumenberg, Jünger a rassemblé dans ce roman toutes les allusions aux événements de l'époque dans un scénario mythique, surtout après l'élimination des opposants à Hitler lors de la “nuit des longs couteaux”, décidant ainsi de n'opposer plus qu'une résistance animée par la pure force de l'esprit. Un spécialiste plus connu du nazisme, George L. Mosse affirme que Jünger, dans ce roman, rejette les idées de sa jeunesse et retourne au protestantisme. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes.
De fait, Jünger, en 1938, dans la seconde version de son livre Le cœur aventureux, fait allusion pour la première fois au mystérieux Ordre des Maurétaniens, une élite mystique de mages savants et guerriers, qui deviendra le protagoniste collectif du roman Sur les falaises de marbre, et, par la suite, de tous les autres romans de l'auteur. En premier lieu, nous devons souligner que Jünger et les révolutionnaires nationalistes de sa génération sont obsédés par le mythe politique d'un Ordre qui régit l'Etat et guide les masses. Les Maurétaniens sont à mi-chemin entre les Templiers et les Chevaliers Teutoniques, ils sont l'incarnation de ce mythe.
Donc, en 1938, Jünger écrit qu'au lieu de rester coincé dans ses chères études, il va s'introduire dans le milieu des Maurétaniens, qu'il définit comme des polytechniciens subalternes du pouvoir, parmi lesquels il nomme Goebbels et Heydrich, un des chefs de la SS. Ce n'est dès lors pas un hasard si Carl Schmitt écrit, dans son journal, que les Maurétaniens sont une allégorie des SS. Jünger, en outre, ajoute textuellement qu'«une équipe sélectionnée des nôtres est au travail dans les lieux secrets du plus secret Thibet». Effectivement, à cette époque, existait une organisation culturelle liée à la SS et dénommé l'Ahnenerbe (= l'Héritage des Ancêtres), qui organisait entre autres choses des expéditions plus ou moins secrètes au Thibet, et était reçue par le Dalaï Lama en personne. Par ailleurs, il faut signaler que cette structure avait été mise sur pied, au départ, par un ami de Jünger, Friedrich Hielscher, le chef spirituel des jeunes nationalistes allemands, avant d'être incluse par Himmler dans les institutions SS. Mais quand paraît le roman-pamphlet Sur les falaises de marbre, certains nazis, ignorant ces faits, réclament la tête de Jünger, qui sera défendu par le “Maurétanien” Goebbels, et ensuite par Hitler lui-même, qui, ne l'oublions pas, avait confessé à Rauschning, stupéfait et attéré, avoir fondé un Ordre mystérieux. Nous sommes donc en présence d'un mystère historiographique et politique du 20ième siècle.
Le roman de Jünger est probablement le témoignagne d'un conflit politique et culturel qui se déroulait à l'intérieur du noyau dirigeant national-socialiste, et aussi, sans doute, à l'intérieur même de cet Ordre mystérieux, pour savoir comment imposer et diriger la politique intérieure et extérieure du IIIième Reich. Jünger, qui plus est, considère que l'un des protagonistes du roman, le Maurétanien Braquemart, est semblable à Goebbels, et que la figure démoniaque et destructive du Forestier peut être ramenée à Staline. Ensuite, en 1940, il attribue la victoire fulgurante des troupes allemandes en France à la Figure du Travailleur, décrite dans son livre Der Arbeiter. En 1942, il fait rééditer son essai sur la mobilisation totale, au moment même où Hitler mobilise totalement et désespérément tout ce qui est allemand. Ce conflit interne entre les Maurétaniens, dans lequel Jünger entendait bel et bien intervenir en publiant son roman-pamphlet, s'est avivé pendant la durée du conflit, à cause des conséquences catastrophiques de la guerre voulue par Hitler et non par les autres membres de l'Ordre des Maurétaniens. Voilà pourquoi Jünger et son ami Hielscher en sont arrivés à comploter contre le Führer: ils voulaient désespérément éviter le destin tragique qui allait frapper l'Allemagne, ou au moins l'atténuer.
Jünger, en effet, fut l'un des organisateurs de la tentative de coup d'Etat du 20 juillet 1944, qui aurait dû avoir lieu après l'attentat contre Hitler. A Paris, où il est officier d'état-major dans le Haut Commandement des troupes d'occupation, centre du complot contre Hitler, Jünger écrit l'essai La Paix qui est, en fait, le texte politique essentiel de ce complot, et dont le manuscrit avait été lu et approuvé par Rommel, le seul officier supérieur capable de mettre un terme à la guerre sur le front occidental et à affronter la guerre civile. Mais le complot échoue, Rommel est contraint au suicide parce qu'il est condamné à mort. Le Maurétanien Hielscher est arrêté à son tour. Jünger semble vouloir nous dire que le Prince Sunmyra, un des auteurs malchanceux de l'attentat contre le Forestier dans le roman-pamphlet, peut être comparé au Colonel von Stauffenberg, l'auteur malchanceux de l'attentat contre Hitler. Claus von Stauffenberg, héros de la “Résistance allemande”, était un disciple de Stefan George, donc un représentant de ces Maurétaniens qui s'étaient donné le devoir de préserver l'Allemagne secrète. Et Hitler ne pouvait pas condamner à mort l'Allemagne secrète, incarnée dans l'œuvre et la personne de Jünger.
Antonio GIGLIO.
(article extrait de l'Italia settimanale, n°13/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lettres, lettres allemandes, allemagne, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, résistance, anti-nazisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 septembre 2008
J. Evola: Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois
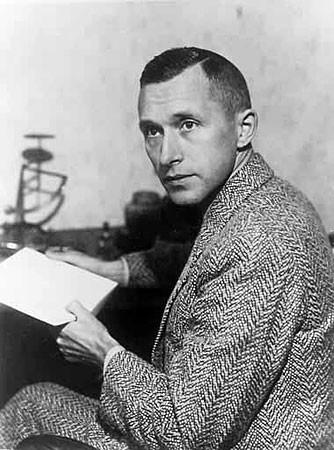
Julius EVOLA:
Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois
Il est visible et il nous paraît évident qu'à travers l'économie se sont réveillées des forces «élémentaires», qui, en de nombreux domaines, échappent au contrôle du bourgeois et, ainsi, deviennent le substrat d'une nouvelle unité, collective cette fois.
Ce constat nous amène effectivement à certains aspects de la crise du monde bourgeois et à les étudier; selon Jünger, il faut tourner notre attention vers quelques traits caractéristiques du bourgeois qui correspondent à son idéal de sécurité commode et d'exclusion de toute force élémentaire hors de sa vie.
Le concept d'élémentaire joue un rôle central dans le livre de Jünger. Comme chez d'autres auteurs allemands, le terme «élémentaire» n'est pas utilisé chez Jünger dans le sens de “primitif”; il désigne bien plutôt les puissances les plus profondes de la réalité qui échappent aux structures intellectuelles et moralistes et qui sont caractérisées par une transcendance, positive ou négative selon l'individu: c'est comme si l'on parlait des forces élémentaires de la nature. Dans le monde intérieur, il existe des puissance qui peuvent faire irruption dans la vie, tant la vie personnelle que la vie collective, en venant d'une strate psychique plus profonde. Quand Jünger parle de l'exclusion de l'élémentaire dans le monde bourgeois, il est évident qu'il s'associe à la polémique développée par plusieurs courants d'idées contemporains, depuis l'irrationalisme, l'intuitionnisme, la religion de la vie (ou vitaliste) jusqu'à la psychanalyse et à l'existentialisme; il s'insurge contre la vision rationaliste-moraliste de l'homme, prédominante hier encore. Mais nous allons voir que la position de Jünger est originale dans ce contexte, car il conçoit des formes actives, lucides, non régressives des rapports de l'homme à l'élémentaire, ce qui le distingue de l'orientation problématique, propre à la grande majorité des courants que nous venons de mentionner.
La préoccupation constante du monde bourgeois est donc «de fermer hermétiquement l'espace vital à tout irruption de l'élémentaire», de «se créer une ceinture de sécurité face à l'élémentaire». De ce fait, la sécurité dans la vie est donc l'exigence de ce monde, que devra consolider et légitimer le culte de la raison: une raison «pour laquelle tout ce qui est élémentaire équivaut à l'absurde et à l'insensé». Inclure l'élémentaire dans l'existence, avec tous les problèmes et les risques que cela peut impliquer, voilà ce qui apparaît inconcevable au bourgeois; pour lui, c'est une aberration qu'il faut prévenir par le truchement de techniques pédagogiques adéquates. Jünger écrit: «Le bourgeois ne se sent jamais assez hardi pour se mesurer au destin en luttant et en s'exposant aux dangers, parce que l'élémentaire réside en dehors de son monde idéal; pour lui, l'élémentaire est l'irrationnel voire l'immoral. Il cherchera donc à le tenir toujours à distance, que celui-ci lui apparaisse sous le mode de la puissance ou de la passion, ou se manifeste dans les forces de la nature, dans le feu, l'eau, la terre ou l'air. De ce point de vue, les grandes villes du début du siècle apparaissaient comme les citadelles de la sécurité, comme le triomphe des murs qui, à ce moment-là, cessaient d'être les murs antiques des enceintes fortifiées et se manifestaient désormais comme pierres, asphalte et vitres encerclant la vie, similaires à la structure des rayons d'une ruche, pénétrant jusqu'à la trame la plus intime de la vie. Dans ce sens, toute conquête de la technique est un triomphe de la commodité et toute apparition de l'élémentaire est régulée par l'économie».
Pour Jünger, le caractère anomal de l'ère bourgeoise ne réside pas tant dans la recherche de la commodité «que dans ce trait spécifique qui s'associe à ces tendances: c'est-à-dire dans le fait que l'élémentaire se présente comme l'absurde et, partant, que les murs d'enceinte de l'ordre bourgeois se présentent simultanément comme les murs d'enceinte de la rationalité». Tel est donc bien le point d'ancrage de la polémique anti-bourgeoise de Jünger. Il distingue bien la rationalité du culte de la raison et conteste l'idée qui veut qu'un ordre et une mise en forme rigoureuse de la vie soient possibles et concevables seulement selon le schéma rationaliste, partant d'une imperméabilisation de l'existence face à l'élémentaire. Parmi les tactiques utilisées par le bourgeois, il y a celle qui consiste à «présenter toute attaque contre le culte de la raison comme une attaque contre la raison en elle-même, afin de pouvoir bannir cette attaque dans l'aire de l'irrationnel». En vérité, toute attaque peut s'identifier à une autre, mais seulement selon la vision bourgeoise, c'est-à-dire seulement sur base de «la conception spécifiquement bourgeoise de la raison, caractérisée par une “inconciliabilité” avec l'élémentaire». Cette antithèse ne peut être retenue comme valide par un nouveau type humain: du reste, cette antithèse est dépassée de fait par des figures «comme, par exemple, celles du croyant, du guerrier, de l'artiste, du navigateur, du chasseur, du travailleur et, aussi, finalement, du délinquant»; pour toutes ces figures, à l'exception de la dernière, le bourgeois nourrit une aversion plus ou moins ouverte, parce que «pour ainsi dire, elles portent déjà à l'intérieur même des cités, par leurs apparences, l'odeur du danger, parce que déjà leur simple présence représentent une instance dirigée contre le culte de la raison».
Mais «pour le guerrier la bataille est un événement dans lequel se réalise un ordre suprême, pour le poète les conflits les plus tragiques sont des situations où le sens de la vie peut se condenser en un mode particulièrement net»; la délinquence elle-même peut être expliquée par une rationalité lucide; quant au croyant, «il participe à la sphère plus vaste d'une vie pleine de signification. Soit par le malheur ou le danger ou le miracle, le destin l'englobe directement dans un tissu d'événements plus puissants. Les dieux aiment se manifester dans les éléments, dans les astres enflammés et dans la foudre, dans les ronces que la flamme ne consume pas». L'élément décisif qu'il s'agit surtout de reconnaître ici est que «l'homme peut demeurer en rapport avec l'élément(aire) sur un plan supérieur ou sur un plan inférieur et qu'en conséquence, multiples sont les plans sur lesquels tant la sécurité que le danger retournent dans l'ordre. Au contraire, dans le bourgeois, on perçoit un homme qui ne reconnaît comme valeur suprême que la sécurité, et détermine sa conduite de vie sur base de cet idéal de sécurité». «Les conditions pour promouvoir cette sécurité, que le progrès cherche à réaliser, sont corollaires de la domination universelle de la raison bourgeoise, laquelle devrait non seulement limiter, mais, en bout de course, détruire, toutes les sources de danger. Et, comme à la lumière de cette raison, le danger est présenté comme étant l'irrationnel, on ôte à celui-ci tout droit de faire partie de la réalité. Il est fort important, dès lors, dans un tel mode de penser, de voir l'absurde dans tout danger: celui-ci semble éliminé dès le moment où, dans le miroir de la raison, il apparait comme une erreur».
«Dans les ordonnancements tant spirituels qu'objectifs du monde bourgeois, on peut constater tout cela», poursuit Jünger. «En grand, on peut le voir dans la tendance à concevoir l'Etat —lequel, normalement, se base pour l'essentiel sur la hiérarchie, en termes de société— comme une forme ayant pour principe fondamental l'égalité et se constituant par le truchement d'un acte de la raison. Cette vision révèle la volonté d'imposer une organisation complexe, un système de sécurité devant ventiler et atténuer toutes les formes de risques, non seulement dans le domaine de la politique intérieure et extérieure, mais aussi dans celui de la vie individuelle, ce qui constitue une tendance à dissoudre le destin par un calcul de probabilités. Cette vision révèle enfin, dans ses multiples et complexes tentatives de ramener la vie de l'âme à des rapports de cause à effet, dans sa volonté de transférer la vie de l'âme du domaine de l'imprévisible à celui du calculable, et puis de l'insérer dans la sphère “éclairée” de la conscience extérieure». Dans tous les domaines, la tendance est d'éviter les conflits et de démontrer leur “évitabilité”. Mais vu que les conflits surviennent malgré tout, pour le bourgeois, «l'important est de démontrer qu'ils sont une erreur que l'éducation et une pédagogie “éclairée” des esprits devront empêcher la répétition».
Mais un tel monde ne serait qu'un monde d'ombres, où l'idéologie des Lumières surévaluerait ses propres forces, en croyant qu'il puisse tenir vraiment debout. En réalité, «le danger est toujours présent; comme un élément de la nature, il cherche continuellement à briser la digue que l'ordre a construit pour l'enserrer; et, par l'effet des lois d'une mathématique occulte mais infaillible, il se fait d'autant plus menaçant et mortel que l'ordre cherche à l'exclure. En fait, le danger veut être non seulement un élément de cet ordre mais, en plus, le principe d'une sécurité supérieure, que jamais le bourgeois ne pourra connaître». En règle générale, si l'on peut exclure l'élémentaire dans un type donné d'existance, cette exclusion «doit être soumise à certaines lois, parce que l'élémentaire n'existe pas seulement dans le monde externe mais est aussi inséparable de la vie de chaque individu». L'homme vit dans l'“élémentarité” dans la mesure où il est un être naturel, un être mu spirituellement par des forces profondes. «Aucun syllogisme ne pourra jamais se substituer au battement du cœur ou à l'activité des reins; il n'existe aucune grandeur qui puisse naître de la seule raison, qui, de temps en temps, doit bien se soumettre aux passions, nobles ou ignobles». Enfin, se référant au monde économique, Jünger note que «s'il est beau le mode par lequel nous nous voyons imposer des calculs, et si l'unique résultat de ceux-ci doit être le bonheur, il restera toujours un résidu qui se soutraira à toute analyse et l'être humain aura le sentiment d'être appauvri, de vivre une désespérance croissante».
Mais l'élémentaire a une double source. «D'une part, il a sa source dans un monde qui est toujours dangereux, comme la mer recèle en elle le danger même quand elle n'est pas troublée par le moindre ventelet. D'autre part, il a d'autres sources dans l'âme humaine, qui a soif de jeu et d'aventure, d'amour et de haine, de triomphe et de chute, qui ressent tant le besoin du risque que de la sécurité; et donc, pour cette âme humaine, un Etat absolument sécurisé apparaît comme un Etat d'incomplétude». En prononçant d'aussi audacieuses paroles, Jünger se réfère implicitement à un type humain différent de celui véhiculé par le monde bourgeois, mais que ce monde génère malgré lui.
La domination des valeurs bourgeoises peut donc se mesurer «à la distance que l'élémentaire semble avoir prise en se retirant de l'existence». Jünger dit “semble”, parce que l'élémentaire se sert de multiples masques et trouve toujours un moyen de se nicher au centre même du monde bourgeois, pour en miner les ordonnancements rationalisants et émerger dès que survient une crise. Par exemple, Jünger rappelle comme déjà dans le passé, sous le signe de la Révolution française, quelles noces cruelles furent celles qui unirent la bourgeoisie et le pouvoir. Le dangereux et l'élémentaire se sont réaffirmés «face aux astuces les plus subtiles par lesquelles on a cherché à les circonvenir; ils s'introduisent de façon imprévue dans les rouages mêmes de ces astuces, en prennent les travestissements, ce qui fait que tout ce qui est civilisation [au sens bourgeois] présente un visage ambigu; nous connaissons tous les rapports qui existent entre les idéaux de fraternité universelle et les gibets, entre les droits de l'homme et les massacres». Non que ce soit le bourgeois lui-même qui veuille imposer de telles circonstances contradictoires: car quand il parle de rationalité et de moralité, il se prend terriblement au sérieux: «tout cela est plutôt un terrible rire sarcastique qu'adresse la nature aux masques se présentant sous le visage de la moralité, une exultation frénétique du sang dirigée contre l'intellect, après que se soit achevé le prélude des beaux discours». En revanche, ce qui mérite d'être remarqué, c'est «le jeu ingénieux des concepts par lequel le bourgeois cherche à faire ressortir ces vertus et à ôter aux mots tout ce qu'ils ont de dur et de nécessaire, afin que transparaisse seulement une moralité que tous sont tenus de reconnaître». Par exemple, cette attitude est bien visible sur le plan international, «quand on cherche à présenter la conquête d'une colonie comme étant une pénétration pacifique ou comme une opération civilisatrice, ou l'incorporation d'une province appartenant à un pays voisin comme un effet de la libre auto-décision des peuples, ou, enfin, les rapines perpétrées par les vainqueurs comme des réparations». Il est évident qu'à ces exemples avancés par Jünger on pourrait facilement ajouter des faits plus récents. Parmi les cas les plus typiques, nous pourrions ajouter les «nouvelles croisades», les tribunaux de vainqueurs, les «aides aux pays sous-développés», etc.
Dans ce même ordre d'idées, est exact ce que dit Jünger quand il relève que c'est justement à l'époque où se sont officiellement et bruyamment propagées les valeurs bourgeoises de “civilisation” que l'on a assisté à des événements que l'on n'aurait plus cru possibles dans un monde éclairé: des phénomènes de violence et de cruauté, de délinquence organisée, de déchaînements d'instincts, de massacres. Tous ces événements représentent «la réduction à l'absurde de l'utopie bourgeoise de la sécurité». En guise de bon exemple, Jünger signale les conséquences qu'a déjà eues le prohibitionnisme aux Etats-Unis: il constitue une tentative moralisatrice, promise par une littérature faite d'utopisme social, et qui semble avoir été conçue comme une mesure de sécurité; elle n'a cependant réussi qu'à attiser des forces élémentaires du plus bas niveau. Ainsi, l'Etat, en suivant rigidement le principe bourgeois, se réfère à des catégories abstraites, rationnelles et moralisantes, et exclut l'élémentaire; mais, en réalité, cet Etat fait en sorte que cet élémentaire s'active en dehors du cadre qu'il installe. «Le moral et le rationnel n'étant pas des liens primordiaux mais seulement des liens propres à l'esprit abstrait, dit Jünger, toute autorité ou tout pouvoir qui veulent se baser sur eux, ne seront qu'autorité ou pouvoir apparents, et, simultanément, la sécurité bourgeoise ne tardera pas à manifester son caractère utopique et éphémère». Il serait bien difficile de contester la réalité de cette dialectique, surtout dans la période qui a suivi la rédaction du Travailleur. C'est effectivement à cette dialectique que se rapportent, d'une part, l'un des facteurs principaux de la crise du monde bourgeois, et, d'autre part, cette autre face, informe, obscure et dangereuse des structures sociétaires modernes, ordonnées et régulées seulement en surface, mais privées tant d'un sens supérieur que de racines dans les strates psychiques les plus profondes.
Déjà au moment de la rédaction du Travailleur, après la première guerre mondiale, il était clair qu'un phénomène analogue de contre-coup allait se produire quand on allait appliquer de tels principes, notamment celui qui se profile derrière le concept bourgeois de liberté abstraite: dans la mesure où l'on reconnaît au principe de la démocratrie nationale une validité universelle, sans opérer la moindre discrimination, on aboutit automatiquement à un état d'anarchie mondiale, suscitant de nouvelles causes de crise au sein de l'ordre ancien, telle la révolte des peuples colonisés et de toutes les forces auxquelles, en Europe et ailleurs, le principe d'auto-détermination des peuples a donné une souveraineté politique même quand il s'agissait de tribus ou de populations, explique Jünger, «dont le nom n'était pas connu de l'histoire politique mais seulement, à la rigueur, des manuels d'ethnologie. Cet état de choses a pour conséquence naturelle la pénétration dans l'espace politique de courants purement élémentaires, de forces appartenant moins à l'histoire qu'à l'histoire naturelle». Aujourd'hui, ce constat est encore plus exact qu'hier.
Pour nous, il est cependant plus important d'examiner la crise du système dans ses aspects spirituels. Jünger parle surtout de formes de défense et de compensation qui se sont déjà manifestées en marge de la société bourgeoise, avec le phénomène du romantisme. «Il y a des périodes où les relations de l'homme avec l'élémentaire se manifestent sous l'aspect de propensions au romantisme, lesquelles constituent déjà en soi un point de fracture. Selon les circonstances cette fracture se fera visible: on se perdra dans le lointain (l'exotique), dans l'ivresse, la folie, la misère ou la mort. Ce sont là toutes des formes de fuite où l'homme isolé, après avoir cherché en vain une voie de sortie dans tout l'espace du monde spirituel ou matériel, met bas les armes. Mais, en tant que telle, la capitulation, peut aussi revêtir les apparences d'une attaque, comme quand un navire de guerre, en sombrant, tire encore une ultime bordée à l'aveuglette».
«Nous avons su reconnaître la valeur de la sentinelle tombée sur sa position perdue, continue Jünger. Nombreuses sont les tragédies auxquelles se lient de grands noms, mais il y a aussi beaucoup de tragédies anonymes, où des groupes entiers, des strates sociales entières, qui subissent une raréfaction de l'air nécessaire à la vie, comme s'ils avaient été pris par un vent de gaz toxiques». Ce que Jünger ajoute ensuite a une base autobiographique et reflète ses propres expériences de jeunesse, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler: «Le bourgeois a presque réussi à persuader le cœur aventureux que le danger n'existe pas, qu'une loi économique gouverne le monde et l'histoire. Mais les jeunes gens qui dans la nuit et le brouillard abandonnent la maison de leur père ont le sentiment intime de devoir aller très loin à la recherche du danger, au-delà de l'océan, en Amérique, à la Légion Etrangère, dans des pays où poussent les arbustes qui donnent le poivre. Mais surgissent aussi des figures qui n'auront pas le courage de s'exprimer dans ce langage propre et supérieur, comme celle du poète qui se sent pareil au pétrel dont les ailes puissantes, créées pour la tempête, ne deviennent, hélas, plus qu'un objet de curiosité inopportune dans un milieu étranger, sans vent, ou comme celle du guerrier né, qui semble n'être qu'un bon à rien, parce que la vie du marchand le remplit de dégoût».
Pour Jünger, le point décisif de fracture a eu lieu pendant la première guerre mondiale. «Dans la joie, les volontaires l'ont saluée (écrit Jünger en se souvenant visiblement de ce qu'il a lui-même vécu) parce qu'elle leur procurait un sentiment de libération des cœurs et que, d'un trait, se révélait à eux une vie nouvelle, plus dangereuse. Dans cette joie, se cachait aussi, tapie, une protestation révolutionnaire contre les valeurs anciennes, tombées irrémédiablement en désuétude. A partir de ce moment-là, dans tous les courants de pensée, dans tous les sentiments et dans tous les événements, s'est infusé une couleur nouvelle, élémentaire». L'important, ici, est de voir comment, par la force même des choses, un nouveau mode d'être a commencé à se différencier. Jünger relève aussi le rôle qu'ont joué dans la jeunesse combattante, entraînée dans la complexité de cette guerre, les enthousiasmes, les idéaux et les valeurs du patriotisme conventionnel lié au monde bourgeois. Mais, bien vite, il est apparu clairement que cette guerre réclamait des réserves de forces bien différentes de celles nourries à ces sources bourgeoises: et cette différence est celle qui distingue les sentiments d'enthousiasme des troupes quittant les gares, d'une part, et «leur action entre les cratères, sous le fer et le feu d'une bataille de matériel», d'autre part. Alors, dans cette épreuve du feu, disparait le contexte qui justifiait la protestation romantique. Cette protestation-là, écrit Jünger, «est condamnée au nihilisme, là où elle est fuite, simple polémique contre un monde qui sombre, or en tant que telle, elle reste conditionnée par lui. Elle ne devient force que quand elle donne lieu à un type spécial d'héroïsme». Là s'annonce le thème central du Travailleur: traverser une zone de destruction sans être soi-même détruit. La même expérience aura des effets totalement opposés chez des hommes d'une même génération: «les uns se sont sentis déchirés par elle, les autres ont participé à un vécu jamais expérimenté auparavant, grâce à l'extrême proximité de la mort, avec le feu et le sang». La discordance découle de l'ambigüité d'avoir eu comme uniques béquilles les valeurs bourgeoises qui se basaient sur l'individu et sur l'exclusion de l'élémentaire, et d'avoir été capables de vivre une nouvelle liberté. S'il avait été déchiré, brisé, par la guerre, Jünger aurait pu se référer aux mots qu'Erich Maria Remarque a mis en exergue de son fameux livre A l'Ouest rien de nouveau: «Ce livre ne veut ni accuser ni démontrer une thèse; il veut seulement dire quelle fut une génération, déchirée par la guerre même quand les obus l'ont épargnée». Mais comme Jünger est de ceux qui savent intimement qu'ils ont vécu une expérience unique, il voit en ses compagnons de combat ceux qui anticipativement ont constitué le «type»: c'est-à-dire un homme qui se tient debout parce qu'il veut se rendre capable d'un rapport actif avec l'élémentaire, et, parallèlement, développer des formes supérieures de lucidité, de conscience et de maîtrise de soi, parce qu'il veut se dés-individualiser et accepter un réalisme absolu, parce qu'il connaît le plaisir des prestations absolues, de la plénitude maximale de l'action, assortie d'un minimum de “pourquoi?” et de “dans quel but?”. C'est là que «les lignes de la force pure et celles de la mathématique se rencontrent»; dans l'aire d'une conscience accrue, «il est possible de potentialiser les moyens et les énergies premières de la vie, dans un sens inattendu, jamais encore expérimenté».
«Dans les centres occultes de la force, par laquelle on domine la sphère de la mort, on rencontre une humanité nouvelle, qui se forme par le biais d'exigences nouvelles», écrit Jünger. «Dans un tel paysage, on ne peut plus apercevoir l'individu qu'avec beaucoup de difficultés; le feu a calciné tout ce qui n'a pas un caractère objectif». Les processus en plein développement sont tels que toute tentative de la raccorder encore au romantisme et à l'idéalisme de l'individu finissent par sombrer irrémédiablement dans l'absurde. Pour dépasser victorieusement «quelques centaines de mètres où règne la mort mécanique», on n'a nul besoin des valeurs abstraites, morales ou spirituelles, de la libre volonté, de la culture, de l'enthousiasme ou de l'ivresse aveugle qui méprise le danger. Pour cela, il faut une énergie nouvelle et précise, tandis que «la force combattive du milieu dans son ensemble assume un caractère moins individuel que fonctionnel». En outre, on découvre des correspondances entre le point de destruction et l'apogée spirituelle d'une existence; c'est là que se déchaînent les prémisses de la personne absolue. Les rapports avec la mort se transforment et «la destruction peut surprendre l'homme singulier dans ces instants précieux où on lui demande un maximum d'engagement vital et spirituel». Alors, «à la fin, on peut aussi reconnaître la liberté la plus élevée». Tout cela devient, finalement, un part naturelle, voulue d'avance, d'un nouveau style de vie. Finalement se présentent «des figures d'une suprême discipline du cœur et des nerfs, indices d'une froideur quasi métallique, extrême et lucide, où la conscience héroïque se montre capable d'utiliser le corps comme un pur instrument, en lui imposant une série d'actions complexes, au-delà de l'instinct de conservation. Entre les flammes d'un avion touché, dans les chambres d'air d'un submersible qui coule, on accomplit encore un travail qui, au sens propre, transcende la sphère de la vie et dont jamais aucun communiqué ne signalera». Les deux termes qui s'unissent dans ce «type» sont donc l'élémentaire en acte, en soi et en dehors de soi, d'une part, et la discipline, l'extrême rationalité, l'extrême objectivité, c'est-à-dire un contrôle abstrait et absolu de l'activation totale de son être propre, d'autre part.
C'est ainsi, d'après Jünger, que déjà au cours de la première guerre mondiale, s'annonçait l'avènement d'une nouvelle «forme intérieure», et nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'en elle, il voyait ce qui allait devenir décisif pour l'humanité en devenir, c'est-à-dire les culminations exceptionnelles, à l'image des extériorisations guerrières. La crise finale du monde bourgeois et de toutes les valeurs anciennes, pour Jünger, découle de la civilisation de la technique et de la machine, et de toutes les formes d'élémentarité qui leur sont consubstantielles. Et substantiellement identique serait le type d'homme qui, spirituellement, n'est pas le vaincu mais le vainqueur, que ce soit sur les champs de bataille modernes ou dans un monde absolument technicisé. Substantiellement identique serait le type de dépassement et de formation intérieure qui serait requis dans les deux cas. C'est ainsi que s'ébauche la figure de l'homme que Jünger nomme le “Travailleur”, qu'une continuité idéale unirait «au soldat vrai, invaincu, de la Grande Guerre».
Julius EVOLA.
(Chapitre extrait de L'«Operaio» nel pensiero di Ernst Jünger, éd. Volpe, Rome, 1974; trad. franç.: Robert Steuckers).
Julius EVOLA
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres allemandes, allemagne, lettres, italie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 septembre 2008
E. Jünger: 70 s'efface, IV

70 s'efface, IV
Karlheinz SCHAUDER
Il a largement dépassé le grand âge de Goethe: Ernst Jünger, le Patriarche de Wilflingen, vient de fêter ses 100 ans le 29 mars 1995. L'écrivain se sent comme l'Ahasver de la légende et s'étonne d'avoir atteint cet âge après toutes ses “tribulations”. Lui, l'auteur d'une œuvre exemplaire dans la littérature contemporaine, respectée par ses adversaires, remarque, à ce propos: «Depuis des années, l'âge avance, se place à l'avant-scène, se mue en une qualité que je n'avais pas prévue. Je suis frappé, comme toujours, par le nombre impressionnant de perspectives différentes par lesquelles je suis passé, depuis que je suis capable de penser. Cela a l'avantage de donner plus de poids à mes assertions, mais je n'en suis pas responsable».
Cette phrase se trouve dans le quatrième volume des Journaux qu'écrit Jünger depuis son 70ième anniversaire sous le titre de Siebzig verweht, traduit en français par Soixante-dix s'efface. Ce quatrième volume constitue, une fois de plus, une collection impressionnante de notules personnelles, rédigées entre janvier 1986 et décembre 1990. Avec les sens toujours en éveil, avec une force expressive intacte, Jünger enregistre ainsi toutes ses rencontres et ses conversations, ses lectures et ses réflexions. Une fois de plus, on est fasciné de voir comment cet écrivain et ce contemporain parvient à tirer l'essentiel d'une journée, à y goûter: «Parmi mes bonnes œuvres, il y a le fait que j'incite beaucoup de mes contemporains à tenir un journal. Quelle qu'en soit la teneur, il demeurera une prestation qui aura une valeur personnelle et documentaire. Ensuite, cette rédaction satisfait une pulsion: notre cheminement est balisé. Le sacré peut advenir; l'homme est seul avec lui-même. Il est bon qu'un Journal commence tôt dans la vie; mieux: qu'il se poursuive jusqu'à la fin, jusqu'à proximité de la mort».
En ce siècle, quelques écrivains et philosophes ont choisi d'écrire des notes quotidiennes, pour refléter leur temps et transmettre une pensée vraiment vivante. Ce sont particulièrement Léon Bloy et André Gide, Julien Green et Paul Léautaud qui ont veillé à ce que le Journal ne soit pas une simple habitude privée, mais un genre littéraire, permettant de communiquer des impressions ou des idées, créant un espace où l'on peut raconter et rêver. Chez Ernst Jünger également, les notes quotidiennes occupent une place essentielle dans l'œuvre complète. Lorsqu'il écrit ses Journaux, il ne néglige pas les autres formes de création littéraire, mais hisse tout simplement ses notes au rang d'une forme littéraire significative.
Dans ses notes de voyage et ses souvenirs, ses anecdotes et ses considérations, il s'exprime tout à la fois comme écrivain et comme penseur. Cette démarche n'autorise aucune dissipation ni aucun bavardage, comme c'est parfois le cas chez Thomas Mann. Les notes sont séparées par des dates ou des astérisques; souvent pendant plusieurs jours, voire pendant toute une semaine, on ne trouve rien. Sans nul doute, Jünger stylise et rédige ces notes pour qu'elles soient publiées ultérieurement. Il choisit et sélectionne celles qui lui paraissent les plus significatives, les plus chargées de sens, les plus précieuses. Ce qu'il veut communiquer est dit avec précision et concision. Certes, ces qualités-là ôtent quelque lambeaux de spontanéité et d'authenticité à l'écriture immédiate. La construction des phrases est objective et distanciée, souvent certains thèmes s'y répètent, ou un ton docte s'y insinue.
Les impressions de l'environnement le plus proche, du paysage des alentours de Wilflingen occupent un vaste espace dans ces annotations. Le très vieil écrivain vit intensément au rythme de la nature, note les observations qu'il glâne dans son jardin ou au cours de ses promenades. Il consigne les transformations saisonnières que subissent plantes et animaux, s'occupe d'ornithologie et de botanique, et surtout d'entomologie. Jünger est d'ailleurs devenu un entomologiste célèbre qui s'est fait un nom dans l'univers scientifique, si bien que quelques espèces portent son nom. C'est avec joie qu'il commente les envois d'insectes que des amis du monde entier lui expédient. C'est pour se livrer aux «chasses subtiles» que le nonagénaire entreprend encore de longs voyages vers les pays exotiques: en Malaisie par exemple où il a pu observer la comète de Halley qu'il avait vu pour la première fois il y a 76 ans avec ses parents, ses frères et ses sœurs; enfin, à Sumatra, dans les Seychelles et à l'Ile Maurice.
L'envie de voyager de l'écrivain, sa curiosité envers le monde, sont demeurées intactes. Sans cesse, il prend des vacances en compagnie de sa femme Liselotte, qu'il appelle affectueusement «Petit Taureau», et séjourne dans les pays européens, où il visite les bouquinistes et flâne dans les musées. Ou il circule en France, est reçu par les Chevaliers du Taste-Vin, visite en compagnie de Rolf Hochhuth les grottes de Lascaux et revient, en bout de course, dans l'appartement de Paris. L'octroi de prix ou de doctorats honoris causa le conduit à Palerme, à Rome ou à Bilbao, ce qui lui rappelle de nombreux souvenirs, ravive en lui des impressions anciennes. Jünger rencontre à Berne ou à Munich des amis et des collègues, participe aux jubilés et aux fêtes villageoises de Wilflingen. Dans la gestion quasi ménagère de son œuvre, Jünger consigne dans ses Journaux le meilleur de son courrier et les messages de remerciement. En dépit de tous les honneurs qu'on lui accorde, il conserve une distance par rapport à la gloire: «Les étapes de la gloire et leur mi-temps: depuis le moment où l'on arrive dans le dictionnaire jusqu'au moment où on en est radié. Un chapitre en soi: le rapport entre la gloire et l'après-gloire, riche en déceptions et en surprises, sans intérêt pour la personne concernée».
Outre les impressions de voyage, l'auteur honore les moments qu'il a vécu avec ses contemporains et ses compagnons de route: il nous évoque ainsi une visite du dramaturge allemand Heiner Müller, une virée avec Ionesco, une correspondance avec Wolf Jobst Siedler ou avec Rainer Hackel, d'anciennes rencontres avec Ernst Niekisch et Ernst von Salomon, des souvenirs d'Alfred Kubin et de Valeriu Marcu. Le nonagénaire relit ses anciennes lettres, se souvient de son père, de sa première femme, se rappelle avec chagrin de son frère Friedrich Georg, qui, lui aussi, fut un grand écrivain, et avec douleur de son fils Ernstel, tombé au champ d'honneur en Italie pendant la seconde guerre mondiale. Quand Jünger rumine tous ses souvenirs douloureux, il ne pense presque jamais à sa propre mort, mais surtout à la présence des disparus. Les défunts sont tout particulièrement présents dans les rêves du vieil homme.
Jünger accorde aux rêves une grande importance: ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface commence et se termine par la description d'un rêve. Dans un cas précis, Jünger raconte pendant quatorze pages en détails et avec minutie une de ses visions nocturnes. A côté du monde bizarre des rêves, il nous décrit une manifestation de l'inconscient, qu'il désigne comme “troisième voie”. Les Journaux offrent ainsi matière à réflechir pour les psychanalystes. Pour les jeux et joutes d'idées pendant l'éveil, la lecture est indispensable; on ne peut y renoncer et Jünger écrit: «Même si la journée d'hier a été fatigante, j'ai encore lu, la nuit tombée, quelques pages du Journal de Renard. Je ne peux imaginer un jour sans lecture et je me demande souvent si, au fond, je n'ai pas vécu la vie d'un lecteur. Le monde des livres serait ainsi le monde réel, et le vécu n'en serait que la confirmation —et cet espoir serait toujours déçu. Ce qui pourrait avoir pour effet que les auteurs présentent la matière sur un plan supérieur et que cette matière s'inscrusterait mieux que le tissu des hasards biographiques. Nous ne voyons que le dos du gobelin. Voilà pourquoi je m'y retrouve mieux dans un bon roman que dans ma propre biographie».
Jünger se préoccupe ensuite, dans ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface, des célèbres cas juridiques de Pitaval, se penche encore sur Montaigne, Léon Bloy et Léautaud, relit les œuvres de Tourgueniev, Dostoïevski et Tolstoï. Il note encore le texte d'antiques sagesses d'Egypte, des proverbes chinois dans ses chroniques quotidiennes et fait référence à des versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour ce qui concerne la littérature contemporaine, il a été séduit par un roman de Gabriel Garcia Márquez et sait apprécier les poèmes de Helena Paz, la fille d'Octavio Paz.
En guise d'anticipation à la publication prochaine de sa correspondance, Jünger reprend de nombreux extraits de lettres dans son Journal. Il cite des parties de lettres qui lui ont été adressées, note des salutations originales issues de cartes postales, nous révèle des réponses à ses traducteurs Henri Plard et Pierre Morel, qu'il consulte toujours en cas de litige. Avec des remarques bien étayées, il commente la préface qu'a rédigée Julien Hervier pour l'édition française du Travailleur, ou il reproduit le texte d'un interview téléphoné qu'il a accordé au Figaro. Il nous parle du travail qu'il a effectué dans le texte des Ciseaux, où il tente de nous léguer une théodicée, et introduit dans son Journal un passage qu'il a ôté du texte définitif. Il s'occupe de subtilités grammaticales et stylistiques avec une telle intensité que cette précision lui apparaît comme un phénomène de vieillissement! Autrement, il n'a que de petits tracas, constate-t-il: le principal, c'est qu'ils ne se répercutent pas sur sa prose.
En tant qu'anarque —c'est ainsi qu'il s'“auto-désigne”— il a l'impression de vivre davantage dans les livres que dans “notre misérable réalité”. Les rencontres immédiates avec la réalité, avec les événements politiques et culturels, sont quasiment absentes de cette partie du Journal, elles ne sont pas transposées dans l'écriture. Ainsi, les visites répétées à Wilflingen du Chancelier fédéral et du Président Mitterrand ou du Premier Ministre espagnol Gonzales. Ainsi, ses vols en hélicoptère vers Bonn, à l'invitation du Chancelier ou sa participation aux fêtes du jubilé du Traité d'amitié franco-allemand à Paris. Quand on a dépassé 100 ans, les événements du jour n'ont plus trop d'importance, car on a déjà vécu tout et le contraire de tout. Pourtant, deux événements l'ont touché: la fête en l'honneur de son 95ième anniversaire dans le Neuer Schloß de Stuttgart et le nuit de la réunification allemande en novembre 1989.
Le Journal de Jünger n'est nullement un “journal intime”, qui, en première instance, sert à exprimer les sentiments du moi qui écrit. Tout, dans les notices de ce Journal, semble être parfaitement maîtrisé, soupesé; la prose admirablement ciselée de ce monologue mis en écriture montre que le Journal de Jünger, en fait, est un moyen de prendre distance et non pas de rester trop proche du vécu. Il s'agit des visions et des expériences d'un homme qui, sans mélancolie, se meut dans la sphère du très grand âge, avec froideur, comme s'il n'était pas concerné. La propre vie et la propre œuvre de l'auteur lui servent à relier et à rapprocher les événements immédiats et lointains, le proche et l'éloigné, le rêve et l'imprimé. Les remarques philosophiques, culturelles, sociologiques et critiques de Jünger, les idées qu'il exprime sur l'histoire et la civilisation ne sont nullement des plaintes pessimistes. Il se borne à enregistrer les évolutions et les bouleversements, il décrit la destruction de la nature due à l'avancée de la technique. Sur notre situation globale, il écrit: «Ce que notre situation a de particulier et peut-être d'unique, c'est que nous sommes plongés non pas seulement dans une révolution mondiale mais aussi et surtout dans une révolution tellurique. Ainsi culmine la résistance qui s'oppose tant à l'artiste qu'au philosophe. Leur œuvre sera soit insuffisante soit provisoire. L'insuffisant sera détruit par les événements, mais le provisoire pourra se révéler si significatif que les événements ne le rattraperont pas».
Malgré des observations contrariantes et des détails effrayants, Jünger cherche la loi secrète, l'ordre caché, qui régit tout cela. Qu'il formule des observations sur une couleur ou sur une spirale, qu'il examine un insecte ou décrit une floraison, il s'efforcera toujours de déchiffrer l'«écriture imagée immédiate», de se rapprocher de la plénitude et de l'harmonie du tout cosmique. Il demeure animé par une volonté inconditionnelle de sens et ne se montrera jamais prêt à abandonner la foi en ce sens. Un jour, il s'est demandé: «Qu'est-ce qui est le plus important pour un écrivain? La redécouverte de l'impassable dans le temps passé: l'Etre dans l'existence».
Pour Jünger, l'écrivain est une personne morale qui s'est extraite de la quotidienneté sociale, qui, par la force de son imagination, peut reconnaître les rapports entre les choses. Ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface est lui aussi un outil idéal et sublime pour pénétrer, avec son «regard stéréoscopique», dans le monde pour le révéler, pour pénétrer dans sa pensée qui est un “voir” dans l'espace et dans les profondeurs. Cette collection de notices et de témoignages, de souvenirs et de lettres est un document littéraire de tout premier rang, une chambre aux trésors où l'on trouve les plans et les analyses les plus fines sur notre temps. Une lecture indispensable, captivante, fécondante.
Karlheinz SCHAUDER.
(recension tirée de Criticón, n°146/1995; adresse: Criticón Verlag, Knöbelstrasse 36/0, D-80.538 München; abonnement: DM 64; étudiants: DM 42; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres allemandes, lettres, allemagne, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 septembre 2008
Il volto ambiguo della Rivoluzione Conservatrice tedesca
Il volto ambiguo della Rivoluzione Conservatrice tedesca
La Rivoluzione Conservatrice - fenomeno essenzialmente tedesco, ma non solo - era un bacino di idee, un laboratorio, in cui vennero ad infusione tutti quegli ideali che da una parte rifiutavano il progressismo illuministico dell’Occidente, mentre dall’altra propugnavano il dinamismo di una rivoluzione in grande stile: ma nel senso di un re-volvere, di un ritornare alla tradizione nazionale, all’ordine dei valori naturali, all’eroismo, alla comunità di popolo, all’idea che la vita è tragica ma anche magnifica lotta.
 Tra il 1918 e il 1932, questi ideali ebbero decine di sostenitori di alto spessore intellettuale, lungo un ventaglio di variazioni ideologiche molto ampio: dalla piccola minoranza di quanti vedevano nel bolscevismo l’alba di una nuova concezione comunitaria, alla grande maggioranza di coloro che invece si battevano per l’estrema affermazione del destino europeo nell’era della tecnica di massa, mantenendo intatte, anzi rilanciandole in modo rivoluzionario, le qualità tradizionali legate alle origini del popolo: identità, storia, stirpe, terra-patria, cultura. Tra questi ultimi, di gran lunga i più importanti, figuravano personaggi del calibro di Jünger, Schmitt, Moeller van den Bruck, Heidegger, Spengler, Thomas Mann, Sombart, Benn, Scheler, Klages, e molti altri. In quella caotica Sodoma che era la Repubblica di Weimar - dove la crisi del Reich fu letta come la crisi dell’intero Occidente liberale - tutti questi ingegni avevano un denominatore comune: impegnare la lotta per opporsi al disfacimento della civiltà europea, restaurando l’ordine tradizionale su basi moderne, attraverso la rivoluzione. Malauguratamente, nessuno di loro fu mai un politico. E pochi ebbero anche solo cultura politica. Quest’assenza di sensiblerie fu il motivo per cui, al momento giusto, spesso la storia non venne riconosciuta. E, tra i più famosi, solo alcuni capirono che il destino non sempre può avere il volto da noi immaginato nel silenzio dei nostri studi, ma che alle volte appare all’improvviso, parlando il linguaggio semplice e brutale degli eventi.
Tra il 1918 e il 1932, questi ideali ebbero decine di sostenitori di alto spessore intellettuale, lungo un ventaglio di variazioni ideologiche molto ampio: dalla piccola minoranza di quanti vedevano nel bolscevismo l’alba di una nuova concezione comunitaria, alla grande maggioranza di coloro che invece si battevano per l’estrema affermazione del destino europeo nell’era della tecnica di massa, mantenendo intatte, anzi rilanciandole in modo rivoluzionario, le qualità tradizionali legate alle origini del popolo: identità, storia, stirpe, terra-patria, cultura. Tra questi ultimi, di gran lunga i più importanti, figuravano personaggi del calibro di Jünger, Schmitt, Moeller van den Bruck, Heidegger, Spengler, Thomas Mann, Sombart, Benn, Scheler, Klages, e molti altri. In quella caotica Sodoma che era la Repubblica di Weimar - dove la crisi del Reich fu letta come la crisi dell’intero Occidente liberale - tutti questi ingegni avevano un denominatore comune: impegnare la lotta per opporsi al disfacimento della civiltà europea, restaurando l’ordine tradizionale su basi moderne, attraverso la rivoluzione. Malauguratamente, nessuno di loro fu mai un politico. E pochi ebbero anche solo cultura politica. Quest’assenza di sensiblerie fu il motivo per cui, al momento giusto, spesso la storia non venne riconosciuta. E, tra i più famosi, solo alcuni capirono che il destino non sempre può avere il volto da noi immaginato nel silenzio dei nostri studi, ma che alle volte appare all’improvviso, parlando il linguaggio semplice e brutale degli eventi.
 Scrivevano di una Germania da restaurare nella sua potenza, favoleggiavano di un tipo d’uomo eroico e coraggioso, metallico, che avrebbe dominato il nichilismo dell’epoca moderna; descrivevano la civilizzazione occidentale come il più grande dei mali, il progresso come un dèmone, il capitalismo come una lebbra di usurai, l’egualitarismo e il comunismo come incubi primitivi … e riandavano alle radici del germanesimo, alle fonti dell’identità. Armato di Nietzsche e di antichi miti dionisiaci, c’era persino chi riaccendeva i fuochi di quelle notti primordiali in cui era nato l’uomo europeo… Eppure, quando tutto questo prese vita sotto le loro finestre, quando i miti e le invocazioni assunsero la forma di uomini, di un partito, di una volontà politica, di una voce, quando “l’uomo d’acciaio” descritto nei libri bussava alla loro porta nelle forme stilizzate della politica, molti sguardi si distolsero, molte orecchie cominciarono a non sentirci più… La vecchia sindrome del sognatore, che non vuol essere disturbato neppure dal proprio sogno che si anima… La Rivoluzione Conservatrice tedesca espresse spesso la tragica cecità di molti suoi epigoni dinanzi al prender forma di non poche delle loro costruzioni teoriche.
Scrivevano di una Germania da restaurare nella sua potenza, favoleggiavano di un tipo d’uomo eroico e coraggioso, metallico, che avrebbe dominato il nichilismo dell’epoca moderna; descrivevano la civilizzazione occidentale come il più grande dei mali, il progresso come un dèmone, il capitalismo come una lebbra di usurai, l’egualitarismo e il comunismo come incubi primitivi … e riandavano alle radici del germanesimo, alle fonti dell’identità. Armato di Nietzsche e di antichi miti dionisiaci, c’era persino chi riaccendeva i fuochi di quelle notti primordiali in cui era nato l’uomo europeo… Eppure, quando tutto questo prese vita sotto le loro finestre, quando i miti e le invocazioni assunsero la forma di uomini, di un partito, di una volontà politica, di una voce, quando “l’uomo d’acciaio” descritto nei libri bussava alla loro porta nelle forme stilizzate della politica, molti sguardi si distolsero, molte orecchie cominciarono a non sentirci più… La vecchia sindrome del sognatore, che non vuol essere disturbato neppure dal proprio sogno che si anima… La Rivoluzione Conservatrice tedesca espresse spesso la tragica cecità di molti suoi epigoni dinanzi al prender forma di non poche delle loro costruzioni teoriche.
 Non vollero riconoscere il suono di una campana, i cui rintocchi uscivano in gran parte dai loro stessi libri. Allora, improvvisamente, tutto diventò troppo “demagogico”, troppo “plebeo”. L’intellettuale volle lasciare la militanza, la lotta vera, a quanti accettarono di sporcarsi le mani con i fatti. Alcune derive del Nazionalsocialismo si possono anche storicamente ascrivere alla renitenza di intellettuali e ideologhi, che non parteciparono alla “lotta per i valori” e che, dopo aver lungamente predicato, nel momento dell’azione si appartarono in un piccolo mondo fatto di romanzi e divagazioni. Mentalità da club: “esilio interno” o piuttosto diserzione davanti ai propri stessi ideali? Eppure, un certo spazio critico dovette esistere, poi, anche tra le maglie del regime totalitario, se gli storici riportano di serrate lotte ideologiche intestine durante il Terzo Reich, di polemiche, di divergenze di vedute: Rosenberg non la pensava certo come Klages; Heidegger e Krieck erano avversari politici attestati su sponde lontane… Prendiamo Jünger. Ancora nel 1932, aveva parlato del Dominio, della Gerarchia delle Forme, della Sapienza degli Avi, del Guerriero, del Realismo Eroico, della Forza Primigenia, del Soldato Politico, della “Massa che vede riaffermata la propria esistenza dal Singolo dotato di Grandezza”… Ricordiamo di passata che Jünger negli anni venti collaborò, oltre che con le più note testate del nazionalismo radicale, anche col Völkischer Beobachter, il quotidiano nazionalsocialista e che nel 1923 inviò a Hitler una copia del suo libro Tempeste d’acciaio, con tanto di dedica… Alla luce dei fatti, è forse giunto il momento di considerare quelle proclamazioni solo come buoni esercizi letterari? Nell’infuriare della lotta vera per il Dominio che si ingaggiò di lì a poco, durante gli anni decisivi della Seconda guerra mondiale, noi troviamo Jünger non già nella trincea dove era stato da giovane, ma ai tavoli dei caffè parigini. Qui lo vediamo intento ad irridere Hitler nel segreto del proprio diario, sulle cui paginette si dilettava a chiamarlo col nomignolo di Knièbolo: un po’ poco. Tutto questo fu “fronda” esoterica o immiserimento del talento ideologico? Storico esempio di altèra dissidenza aristocratica o patetico esaurimento di un antico coraggio di militanza?
Non vollero riconoscere il suono di una campana, i cui rintocchi uscivano in gran parte dai loro stessi libri. Allora, improvvisamente, tutto diventò troppo “demagogico”, troppo “plebeo”. L’intellettuale volle lasciare la militanza, la lotta vera, a quanti accettarono di sporcarsi le mani con i fatti. Alcune derive del Nazionalsocialismo si possono anche storicamente ascrivere alla renitenza di intellettuali e ideologhi, che non parteciparono alla “lotta per i valori” e che, dopo aver lungamente predicato, nel momento dell’azione si appartarono in un piccolo mondo fatto di romanzi e divagazioni. Mentalità da club: “esilio interno” o piuttosto diserzione davanti ai propri stessi ideali? Eppure, un certo spazio critico dovette esistere, poi, anche tra le maglie del regime totalitario, se gli storici riportano di serrate lotte ideologiche intestine durante il Terzo Reich, di polemiche, di divergenze di vedute: Rosenberg non la pensava certo come Klages; Heidegger e Krieck erano avversari politici attestati su sponde lontane… Prendiamo Jünger. Ancora nel 1932, aveva parlato del Dominio, della Gerarchia delle Forme, della Sapienza degli Avi, del Guerriero, del Realismo Eroico, della Forza Primigenia, del Soldato Politico, della “Massa che vede riaffermata la propria esistenza dal Singolo dotato di Grandezza”… Ricordiamo di passata che Jünger negli anni venti collaborò, oltre che con le più note testate del nazionalismo radicale, anche col Völkischer Beobachter, il quotidiano nazionalsocialista e che nel 1923 inviò a Hitler una copia del suo libro Tempeste d’acciaio, con tanto di dedica… Alla luce dei fatti, è forse giunto il momento di considerare quelle proclamazioni solo come buoni esercizi letterari? Nell’infuriare della lotta vera per il Dominio che si ingaggiò di lì a poco, durante gli anni decisivi della Seconda guerra mondiale, noi troviamo Jünger non già nella trincea dove era stato da giovane, ma ai tavoli dei caffè parigini. Qui lo vediamo intento ad irridere Hitler nel segreto del proprio diario, sulle cui paginette si dilettava a chiamarlo col nomignolo di Knièbolo: un po’ poco. Tutto questo fu “fronda” esoterica o immiserimento del talento ideologico? Storico esempio di altèra dissidenza aristocratica o patetico esaurimento di un antico coraggio di militanza?
 E uno Spengler? Anch’egli, dopo aver vaticinato il riarmo del germanesimo e della civiltà bianca, non appena questi postulati ebbero il contorno di un partito politico, che pareva proprio prenderli sul serio, oppose uno sdegnoso distacco. E Gottfried Benn? Dopo aver cantato i destini dell’”uomo superiore che tragicamente combatte”, dopo aver celebrato la “buona razza” dell’uomo tedesco che ha “il sentimento della terra nativa”, come vide che tutto questo diventava uno Stato, una legge, una politica, lasciò cadere la penna…
E uno Spengler? Anch’egli, dopo aver vaticinato il riarmo del germanesimo e della civiltà bianca, non appena questi postulati ebbero il contorno di un partito politico, che pareva proprio prenderli sul serio, oppose uno sdegnoso distacco. E Gottfried Benn? Dopo aver cantato i destini dell’”uomo superiore che tragicamente combatte”, dopo aver celebrato la “buona razza” dell’uomo tedesco che ha “il sentimento della terra nativa”, come vide che tutto questo diventava uno Stato, una legge, una politica, lasciò cadere la penna…
Ma la Rivoluzione Conservatrice, per la verità, non fu solo questo. Fu anche il socialismo di Moeller, l’antieconomicismo di Sombart, l’idea nazionale e popolare di Heidegger, il filosofo-contadino vicino alle SA. In effetti, la gran parte degli affiliati ai diversi schieramenti rivoluzionario-conservatori confluì nella NSDAP, contribuendo non poco a solidificarne il pensiero politico e, in alcuni casi, diventandone uomini di punta: da Baeumler a Krieck. Secondo Ernst Nolte - il maggiore storico tedesco - la Rivoluzione Conservatrice ebbe l’occasione di essere più una rivoluzione che non una conservazione, soltanto perché si incrociò con la via politica nazionalsocialista: un partito di massa, una moderna propaganda, un capo carismatico in grado di puntare al potere. Tutte cose che ai teorici mancavano. “Non fu il nazionalsocialismo - si è chiesto Nolte -, in quanto negazione della Rivoluzione francese e di quella bolscevico-comunista, una contro-Rivoluzione tanto rivoluzionaria, quanto la Rivoluzione conservatrice non potrà mai essere?”.
Dopo tutto, come ha affermato il più esperto studioso di questi argomenti, Armin Mohler, “il nazionalsocialismo resta pur sempre un tentativo di realizzazione politica delle premesse culturali presenti nella Rivoluzione conservatrice”. Il tentativo postumo di sganciare la RC dalla NSDAP è obiettivamente antistorico: provate a sommare i temi ideologici dei vari movimenti nazional-popolari dell’epoca weimariana, ed avrete l’ideologia nazionalsocialista.
* * *
Tratto da Linea del 25 luglio 2004.
Luca Leonello Rimbotti
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, weimar, années 20, philosophie, lettres, lettres allemandes, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 septembre 2008
Comprendere il radicalismo nazionalista di Ernst Jünger
Comprendere il radicalismo nazionalista di Ernst Jünger
 La pubblicazione del terzo e ultimo volume degli Scritti politici e di guerra di Ernst Jünger, relativi agli anni 1929-1933, da parte della Libreria Editrice Goriziana, ci permette di mettere a posto, una volta per tutte, la controversa questione del nazionalismo dello scrittore tedesco e dei suoi rapporti con il Nazionalsocialismo. Se, già nel 1923, Jünger aveva scritto parole di apprezzamento per Hitler, cui aveva anche inviato una copia con dedica autografa del suo celebre volume Im Stahlgewittern, e se in quel medesimo periodo aveva anche collaborato al quotidiano della NSDAP Völkischer Beobachter, diretto da Alfred Rosenberg, negli anni a seguire i suoi rapporti con il Partito nazionalsocialista diventeranno più complessi. Ma mai di rottura. Anzi, di cameratesca solidarietà. A volte di critica su questo o quel punto, ma condotta sempre all’interno della galassia nazionalista e con i toni amichevoli del consapevole alleato di lotta.
La pubblicazione del terzo e ultimo volume degli Scritti politici e di guerra di Ernst Jünger, relativi agli anni 1929-1933, da parte della Libreria Editrice Goriziana, ci permette di mettere a posto, una volta per tutte, la controversa questione del nazionalismo dello scrittore tedesco e dei suoi rapporti con il Nazionalsocialismo. Se, già nel 1923, Jünger aveva scritto parole di apprezzamento per Hitler, cui aveva anche inviato una copia con dedica autografa del suo celebre volume Im Stahlgewittern, e se in quel medesimo periodo aveva anche collaborato al quotidiano della NSDAP Völkischer Beobachter, diretto da Alfred Rosenberg, negli anni a seguire i suoi rapporti con il Partito nazionalsocialista diventeranno più complessi. Ma mai di rottura. Anzi, di cameratesca solidarietà. A volte di critica su questo o quel punto, ma condotta sempre all’interno della galassia nazionalista e con i toni amichevoli del consapevole alleato di lotta.
Uno dei motivi contingenti dell’incomprensione tra alcuni ambienti nazionalisti e NSDAP fu alla fine degli anni venti la situazione dei contadini. Specialmente nella regione settentrionale dello Schleswig-Holstein, a seguito delle misure punitive dei trattati di pace, fortemente penalizzanti l’economia tedesca nel suo complesso, ed anche a seguito della crisi economica, si era avuto il progressivo collasso del ceto rurale, sempre più gravemente scivolato nel gorgo del debito, nella crisi produttiva e nella perdita crescente della piccola proprietà. Da questa situazione era andata prendendo forza una forma di protesta, gestita dalla potente Landvolkbewegung, il movimento contadino a forti tinte nazionaliste ed antisemite che, dal 1928, si rese protagonista anche di alcuni attentati dinamitardi contro la sede del Reichstag. Era una protesta nei confronti dello Stato e del governo, incapaci di garantire agli agricoltori quei sussidi e quelle protezioni dalla concorrenza estera, senza i quali l’economia agricola andava incontro alla rovina. Il movimento contadino trovò immediata sponda negli ambienti nazionalisti. Jünger stesso ne giustificò il terrorismo, prendendo le distanze da Hitler che, invece, pur alleato della protesta, condannò apertamente il ricorso alla violenza. Cosa che non impedì, di lì a poco, che l’intero movimento contadino confluisse nel Partito nazionalsocialista, costituendone anzi uno dei punti di forza sia politici che ideologici: basta pensare al ruolo svolto da Walther Darré.
Condannando la stampa borghese, compattamente ostile ai contadini del Nord, Jünger scrisse frasi pesanti: “È in atto un terrore mediatico di gran lunga più considerevole del terrore generato da qualsiasi bomba”. E condannò ugualmente il moderatismo di Hitler che, come tutti sanno, dopo il Putsch del 1923 era molto attento a marciare lungo i binari della legalità, operando, per tutto il periodo del Kampfzeit, cioè della lotta per il potere, come l’inflessibile elemento moderato che doveva sedare le spinte radicali della sua ala sinistra.
Jünger rimproverava Hitler anche di non essere abbastanza deciso a prendere le distanze da Hugenberg – il capo del Partito Nazionaltedesco – e da tutti gli ambienti reazionari e borghesi. Il fatto sorprendente, che esce a chiare lettere dai suoi scritti di questo periodo, è dunque che Jünger criticava la NSDAP non da “destra”, come si era abituati a pensare e come farà in seguito, bensì da “sinistra”. Ma, in ogni caso, si trattava pur sempre di critiche che non mettevano mai in discussione la consapevolezza che nazionalisti e nazionalsocialisti appartenevano al medesimo schieramento, con i medesimi ideali e i medesimi obiettivi. Si trattava, però, di arrivare al potere non con intermediazioni moderate o conservatrici, ma radicali. Parola di Jünger: “Le risoluzioni prese nell’ambito del partito nazionalsocialista – scrisse su “Wiederstand” dell’ottobre 1929 - non hanno affatto un’importanza esclusiva per questo partito. Dal momento, infatti, che esso attualmente rappresenta l’arma più forte e temibile della volontà nazionale, ogni sua azione o rinuncia andrà necessariamente a colpire tutte le forze che vogliono contribuire all’affermazione di questa volontà in Germania […] ma come ci si può assumere la responsabilità di suscitare la parvenza di un fronte comune con forze la cui vicinanza è intollerabile per un partito intitolato ai lavoratori tedeschi?”.
Domande che, certo, saranno suonate musica alle orecchie delle SA o di un Goebbels, e che non rappresentavano affatto le posizioni del nazionalismo conservatore, ma di quel nazionalismo radicale cui Jünger si era avvicinato tramite Ernst Niekisch, cui lo scrittore era stato presentato dal filosofo Alfred Baeumler. Ma Jünger venne presto accontentato: se si pensa alla rottura, voluta da Hitler, del “fronte di Harzburg” del 1931 – cioè l’alleanza tattica del Nazionalsocialismo con il nazionalismo conservatore, del tipo dello Stahlhelm –, oppure alla liquidazione di tutti gli ambienti conservatori dopo la presa del potere, o alla “purga” del 1934 (che non colpì solo la “sinistra” di Roehm, ma anche la “destra” di Schleicher), se pensiamo poi a come Hitler stesso pose brutalmente fine nel 1944 al conservatorismo junker – e all’esistenza storica della loro casta -, dovremmo riportarne la sensazione che Jünger avesse di che compiacersi dell’operato di Hitler. La storia vuole, invece, che proprio nella lotta di vertice dei conservatori contro il Nazionalsocialismo, Jünger si trovasse – beninteso, in accorta retroguardia - non dalla parte della “sinistra”, bensì della “destra”. Enigmi dell’aristocraticismo…
Jünger era apertamente a-partitico: “rinunciamo a qualsiasi appartenenza partitica…”, aveva scritto, e concepiva romanticamente il nazionalismo come un insieme di centri di lotta, sperando di “veder crescere tutti questi legami in maniera possente, serrata e unitaria, così da raggiungere le dimensioni necessarie al grande confronto…”. La storia ha dimostrato che, in Germania, il nazionalismo di partito non aveva la capacità di crescere fino al punto di diventare egemone. Nei primi anni trenta era chiaro che né Hugenberg né Seldte né tantomeno Niekisch sarebbero andati lontano. Figurarsi semplici ambienti sparsi. Vi andò invece Hitler, ma per vie politiche e non romantiche, e unificando per l’appunto tutti quei movimenti – da quello dei giovani, la Jugendbewegung, a quello contadino sopra ricordato – che, pur essendo nazionalisti, non erano reazionari, ma anzi rivoluzionari.
 Questo, Jünger non lo comprese mai. Non comprese l’identità di un movimento che trovò troppo conservatore nel ’29 e troppo rivoluzionario dal ’33 in poi… mentre la storiografia ha largamente dimostrato – da Nolte a Kershaw – che fu entrambe le cose contemporaneamente, dal 1923 al 1945. Gli amichevoli rimproveri di Jünger agli “amici del partito nazionalsocialista” miravano a scuoterne ciò che allo scrittore pareva eccessiva moderazione, ma che invece, semplicemente, era accortezza politica. Riferendosi ai movimenti nazionalisti intransigenti, Jünger formulò un’esortazione: “speriamo anche che il nazionalsocialismo, anziché combattere quelle forze, ne accetti e riconosca la parentela di fondo”. La parentela di fondo: questa esplicita definizione la dedichiamo a quanti, anche recentemente, non solo hanno negato ogni effusione jüngeriana nei confronti del Nazionalsocialismo, ma persino una sua ideologia nazionalista… E infine leggiamo l’auspicio rivoluzionario: “Al nazionalsocialismo – scrisse nel 1929 Jünger, in pagine che certo provocheranno terribile sconcerto nei suoi attuali ammiratori letterari – auguriamo di cuore la vittoria: conosciamo le sue forze migliori, dal cui entusiasmo trae sostegno e della cui volontà di sacrificio può al di là di ogni dubbio menare vanto. Sappiamo anche, però, che esso potrà combattere per vincere se le sue armi saranno forgiate nel più puro dei metalli, e se rinuncerà al supporto dei fragili resti di un’epoca passata”. Possiamo ribadire che, in questo, Jünger venne accontentato di brutto. I “fragili resti” non solo vennero ignorati, ma proprio distrutti. Il “realismo eroico” propugnato da Jünger altro non era che un radicalismo nazionalista privo di connotati politici. Il suo programma era semplicemente la Germania: “Vogliamo una Germania esattamente com’è”, scrisse nel marzo 1930. Egli conosceva solo un fine, “l’eterna realtà di un Reich che, in questo Paese, non mancò mai di entusiasmare la gioventù”. E un solo progetto: “Qui non c’è niente da augurarsi, allora, vi è piuttosto il rigoroso riconoscimento di un dovere, che trova ora espressione: allora come oggi, essere tedeschi significa essere in lotta”. La differenza tra il nazionalismo di Jünger e il Nazionalsocialismo è insomma la stessa differenza che corre tra il pensiero di un’associazione combattentistica e l’ideologia di un partito rivoluzionario, inteso a ribaltare i rapporti di forza tra le classi e tra le nazioni. Ma il milieu culturale, le aspettative ideali, i fini nazionali, appaiono fratelli: tali, comunque, da non giustificare i continui tentativi di sottrarre Jünger al suo mondo, volendolo ridurre ad agnostico e compassato letterato fine a se stesso.
Questo, Jünger non lo comprese mai. Non comprese l’identità di un movimento che trovò troppo conservatore nel ’29 e troppo rivoluzionario dal ’33 in poi… mentre la storiografia ha largamente dimostrato – da Nolte a Kershaw – che fu entrambe le cose contemporaneamente, dal 1923 al 1945. Gli amichevoli rimproveri di Jünger agli “amici del partito nazionalsocialista” miravano a scuoterne ciò che allo scrittore pareva eccessiva moderazione, ma che invece, semplicemente, era accortezza politica. Riferendosi ai movimenti nazionalisti intransigenti, Jünger formulò un’esortazione: “speriamo anche che il nazionalsocialismo, anziché combattere quelle forze, ne accetti e riconosca la parentela di fondo”. La parentela di fondo: questa esplicita definizione la dedichiamo a quanti, anche recentemente, non solo hanno negato ogni effusione jüngeriana nei confronti del Nazionalsocialismo, ma persino una sua ideologia nazionalista… E infine leggiamo l’auspicio rivoluzionario: “Al nazionalsocialismo – scrisse nel 1929 Jünger, in pagine che certo provocheranno terribile sconcerto nei suoi attuali ammiratori letterari – auguriamo di cuore la vittoria: conosciamo le sue forze migliori, dal cui entusiasmo trae sostegno e della cui volontà di sacrificio può al di là di ogni dubbio menare vanto. Sappiamo anche, però, che esso potrà combattere per vincere se le sue armi saranno forgiate nel più puro dei metalli, e se rinuncerà al supporto dei fragili resti di un’epoca passata”. Possiamo ribadire che, in questo, Jünger venne accontentato di brutto. I “fragili resti” non solo vennero ignorati, ma proprio distrutti. Il “realismo eroico” propugnato da Jünger altro non era che un radicalismo nazionalista privo di connotati politici. Il suo programma era semplicemente la Germania: “Vogliamo una Germania esattamente com’è”, scrisse nel marzo 1930. Egli conosceva solo un fine, “l’eterna realtà di un Reich che, in questo Paese, non mancò mai di entusiasmare la gioventù”. E un solo progetto: “Qui non c’è niente da augurarsi, allora, vi è piuttosto il rigoroso riconoscimento di un dovere, che trova ora espressione: allora come oggi, essere tedeschi significa essere in lotta”. La differenza tra il nazionalismo di Jünger e il Nazionalsocialismo è insomma la stessa differenza che corre tra il pensiero di un’associazione combattentistica e l’ideologia di un partito rivoluzionario, inteso a ribaltare i rapporti di forza tra le classi e tra le nazioni. Ma il milieu culturale, le aspettative ideali, i fini nazionali, appaiono fratelli: tali, comunque, da non giustificare i continui tentativi di sottrarre Jünger al suo mondo, volendolo ridurre ad agnostico e compassato letterato fine a se stesso.
* * *
Tratto da Linea del 29 maggio 2005.
Luca Leonello Rimbotti
00:35 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, nationalisme, radicalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du dandy

Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”
Intervention de Robert Steuckers au séminaire de “SYNERGON-Deutschland”, Basse-Saxe, 6 mai 2001
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais formuler trois remarques préliminaires:
◊ 1. J’ai hésité à accepter votre invitation à parler de la figure du dandy, car ce type de problématique n’est pas mon sujet de préoccupation privilégié.
◊ 2. J’ai finalement accepté parce que j’ai redécouvert un essai aussi magistral que clair d’Otto Mann, paru en Allemagne il y de nombreuses années (i. e. : Dandysmus als konservative Lebensform) (*). Cet essai mériterait d’être à nouveau réédité, avec de bons commentaires.
◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.
L’archétype: George Bryan Brummell
Notre perspective, à la suite de l’essai d’Otto Mann, est d’attribuer au dandy une dimension culturelle plus profonde que toutes ses superficialités “modieuses”, épicuriennes, hédonistes, homosexuelles ou donjuanesques. Pour Otto Mann, le modèle, l’archétype du dandy, reste George Bryan Brummell, figure du début du 19ième siècle qui demeurait équilibrée. Brummell, contrairement à certains pseudo-dandies ultérieurs, est un homme discret, qui ne cherche pas à se faire remarquer par des excentricités vestimentaires ou comportementales. Brummell évite les couleurs criardes, ne porte pas de bijoux, ne se livre pas à des jeux sociaux de pur artifice. Brummell est distant, sérieux, digne; il n’essaie pas de faire de l’effet, comme le feront, plus tard, des figures aussi différentes qu’Oscar Wilde, que Stefan George ou Henry de Montherlant. Chez lui, les tendances spirituelles dominent. Brummell entretient la société, raconte, narre, manie l’ironie et même la moquerie. Pour parler comme Nietzsche ou Heidegger, nous dirions qu’il se hisse au-dessus de l’«humain, trop humain» ou de la banalité quotidienne (Alltäglichkeit).
Brummell, dandy de la première génération, incarne une forme culturelle, une façon d’être, que notre société contemporaine devrait accepter comme valable, voire comme seule valable, mais qu’elle ne génère plus, ou plus suffisamment. Raison pour laquelle le dandy s’oppose à cette société. Les principaux motifs qui sous-tendent son opposition sont les suivants : 1) la société apparaît comme superficielle et marquée de lacunes et d’insuffisances; 2) le dandy, en tant que forme culturelle, qu’incarnation d’une façon d’être, se pose comme supérieur à cette société lacunaire et médiocre; 3) le dandy à la Brummell ne commet aucun acte exagéré, ne commet aucun scandale (par exemple de nature sexuelle), ne commet pas de crime, n’a pas d’engagement politique (contrairement aux dandies de la deuxième génération comme un Lord Byron). Brummell lui-même ne gardera pas cette attitude jusqu’à la fin de ses jours, car il sera criblé de dettes, mourra misérablement à Caen dans un hospice. Il avait, à un certain moment, tourné le dos au fragile équilibre que réclame la posture initiale du dandy, qu’il avait été le premier à incarner.
Un idéal de culture, d’équilibre et d’excellence
S’il n’y a dans son comportement et sa façon d’être aucune exagération, aucune originalité flamboyante, pourquoi la figure du dandy nous apparaît-elle quand même importante, du moins intéressante? Parce qu’elle incarne un idéal, qui est en quelque sorte, mutatis mutandis, celui de la paiedeia grecque ou de l’humanitas romaine. Chez Evola et chez Jünger, nous avons la nostalgie de la magnanimitas latine, de l’hochmüote des chevaliers germaniques des 12ième et 13ième siècles, avatars romains ou médiévaux d’un modèle proto-historique perse, mis en exergue par Gobineau d’abord, par Henry Corbin ensuite. Le dandy est l’incarnation de cet idéal de culture, d’équilibre et d’excellence dans une période plus triviale de l’histoire, où le bourgeois calculateur et inculte, et l’énergumène militant, de type hébertiste ou jacobin, a pris le pas sur l’aristocrate, le chevalier, le moine et le paysan.
A la fin du 18ième siècle, avec la révolution française, ces vertus, issues du plus vieux fond proto-historique de l’humanité européenne, sont complètement remises en question. D’abord par l’idéologie des Lumières et son corrolaire, l’égalitarisme militant, qui veut effacer toutes les traces visibles et invisibles de cet idéal d’excellence. Ensuite, par le Sturm und Drang et le romantisme, qui, par réaction, basculent parfois dans un sentimentalisme incapacitant, parce qu’expression, lui aussi, d’un déséquilibre. Les modèles immémoriaux, parfois estompés et diffus, les attitudes archétypales survivantes disparaissent. C’est en Angleterre qu’on en prend conscience très vite, dès la fin du 17ième, avant même les grands bouleversements de la fin du 18ième : Addison et Steele dans les colonnes du Spectator et du Tatler, constatent qu’il est nécessaire et urgent de conserver et de maintenir un système d’éducation, une culture générale, capables de garantir l’autonomie de l’homme. Une valeur que les médias actuels ne promeuvent pas, preuve discrète que nous avons bel et bien sombré dans un monde orwellien, qui se donne un visage de “bon apôtre démocratique”, inoffensif et “tolérant”, mais traque impitoyablement toutes les espaces et résidus d’autonomie de nos contemporains. Addison et Steele, dans leurs articles successifs, nous ont légué une vision implicite de l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe.
L’idéal de Goethe
Le plus haut idéal culturel que l’Europe ait connu est bien entendu celui de la paideia grecque antique. Elle a été réduite à néant par le christianisme primitif, mais, dès le 14ième siècle, on sent, dans toute l’Europe, une volonté de faire renaître les idéaux antiques. Le dandy, et, bien avant son émergence dans le paysage culturel européen, les deux journalistes anglais Steele et Addison, entendent incarner cette nostalgie de la paideia, où l’autonomie de chacun est respectée. Ils tentent en fait de réaliser concrètement dans la société l’objectif de Goethe: inciter leurs contemporains à se forger et se façonner une personnalité, qui sera modérée dans ses besoins, satisfaite de peu, mais surtout capable, par cette ascèse tranquille, d’accéder à l’universel, d’être un modèle pour tous, sans trahir son humus originel (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit). Cet idéal goethéen, partagée anticipativement par les deux publicistes anglais puis incarné par Brummell, n’est pas passé après les vicissitudes de la révolution française, de la révolution industrielle et des révolutions scientifiques de tous acabits. Sous les coups de cette modernité, irrespectueuse des Anciens, l’Europe se retrouve privée de toute culture substantielle, de toute épine dorsale éthique. On en mesure pleinement les conséquences aujourd’hui, avec la déliquescence de l’enseignement.
A partir de 1789, et tout au long du 19ième siècle, le niveau culturel ne cesse de s’effondrer. Le déclin culturel commence au sommet de la pyramide sociale, désormais occupé par la bourgeoisie triomphante qui, contrairement aux classes dominantes des époques antérieures, n’a pas d’assise morale (sittlich) valable pour maintenir un dégré élevé de civilisation; elle n’a pas de fondement religieux, ni de réelle éthique professionnelle, contrairement aux artisans et aux gens de métier, jadis encadrés dans leurs gildes ou corporations (Zünfte). La seule réalisation de cette bourgeoisie est l’accumulation méprisable de numéraire, ce qui nous permet de parler, comme René Guénon, d’un “règne de la quantité”, d’où est bannie toute qualité. Dans les classes défavorisées, au bas de l’échelle sociale, tout élément de culture est éradiqué, tout simplement parce que chez les pseudo-élites, il n’y a déjà plus de modèle culturel; le peuple, aliéné, précarisé, prolétarisé, n’est plus une matrice de valeurs précises, ethniquement déterminées, du moins une matrice capable de générer une contre-culture offensive, qui réduirait rapidement à néant ce que Thomas Carlyle appelait la “cash flow mentality”. En conclusion, nous assistons au déploiement d’une barbarie nantie, à haut niveau économique (eine ökonomisch gehobene Barbarei), mais à niveau culturel nul. On ne peut pas être riche à la mode du bourgeois et, simultanément, raffiné et intelligent. Cette une vérité patente : personne de cultivé n’a envie de se retrouver à table, ou dans un salon, avec des milliardaires de la trempe d’un Bill Gates ou d’un Albert Frère, ni avec un banquier ou un fabricant de moteurs d’automobile ou de frigidaires. Le véritable homme d’esprit, qui se serait égaré dans le voisinage de tels sinistres personnages, devrait sans cesse réprimer des baillements en subissant le vomissement continu de leurs bavardages ineptes, ou, pour ceux qui ont le tempérament plus volcanique, réprimer l’envie d’écraser une assiette bien grasse, ou une tarte à la façon du Gloupier, sur le faciès blet de ces nullités. Le monde serait plus pur —et sûrement plus beau— sans la présence de telles créatures.
La mission de l’artiste selon Baudelaire
Pour le dandy, il faut réinjecter de l’esthétique dans cette barbarie. En Angleterre, John Ruskin (1819-1899), les Pré-Réphaélites avec Dante Gabriel Rossetti et William Morris, vont s’y employer. Ruskin élaborera des projets architecturaux, destinés à embellir les villes enlaidies par l’industrialisation anarchique de l’époque manchesterienne, qui déboucheront notamment sur la construction de “cités-jardins” (Garden Cities). Les architectes belges et allemands de l’Art Nouveau ou Jugendstil, dont Henry Vandervelde et Victor Horta, prendront le relais. A côté de ces réalisations concrètes —parce que l’architecture permet plus aisément de passer au concret— le fossé ne cesse de se creuser entre l’artiste et la société. Le dandy se rapproche de l’artiste. En France, Baudelaire pose, dans ses écrits théoriques, l’artiste comme le nouvel “aristocrate”, dont l’attitude doit être empreinte de froideur distante, dont les sentiments ne doivent jamais s’exciter ni s’irriter outre mesure, dont l’ironie doit être la qualité principale, de même que la capacité à raconter des anecdotes plaisantes. Le dandy artiste prend ses distances par rapport à tous les dadas conventionnels et habituels de la société. Ces positions de Baudelaire se résument dans les paroles d’un personnage d’Ernst Jünger, dans le roman Héliopolis : «Je suis devenu le dandy, qui prend pour important ce qui ne l’est pas, qui se moque de ce qui est important » («Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte»). Le dandy de Baudelaire, à l’instar de Brummell, n’est donc pas un personnage scandaleux et sulfureux à la Oscar Wilde, mais un observateur froid (ou, pour paraphraser Raymond Aron, un “spectateur désengagé”), qui voit le monde comme un simple théâtre, souvent insipide où des personnages sans réelle substance s’agitent et gesticulent. Le dandy baudelérien a quelque peu le goût de la provocation, mais celle-ci reste cantonnée, dans la plupart des cas, à l’ironie.
Les exagérations ultérieures, souvent considérées à tort comme expressions du dandysme, ne correspondent pas aux attitudes de Brummell, Baudelaire ou Jünger. Ainsi, un Stefan George, malgré le grand intérêt de son œuvre poétique, pousse l’esthétisme trop loin, à notre avis, pour verser dans ce qu’Otto Mann appelle l’«esthéticisme», caricature de toute véritable esthétique.Pour Stefan George, c’est un peu la rançon à payer à une époque où la “perte de tout juste milieu” devient la règle (Hans Sedlmayr a explicité clairement dans un livre célèbre sur l’art contemporain, Verlust der Mitte, cette perte du “juste milieu”). Sedlmayr mettait clairement en exergue cette volonté de rechercher le “piquant”. Stefan George le trouvera dans ses mises en scène néo-antiques. Oscar Wilde ne mettra rien d’autre en scène que lui-même, en se proclamant “réformateur esthétique”. L’art, dans sa perspective, n’est plus un espace de contestation destiné à investir totalement, à terme, le réel social, mais devient le seule réalité vraie. La sphère économique, sociale et politique se retrouve dévalorisée; Wilde lui dénie toute substantialité, réalité, concrétude. Si Brummell conservait un goût tout de sobriété, s’il gardait la tête sur les épaules, Oscar Wilde se posait d’emblée comme un demi-dieu, portait des vêtements extravagants, aux couleurs criardes, un peu comme les Incroyables et les Merveilleuses au temps de la révolution française. Provocateur, il a aussi amorcé un processus de mauvaise “féminisation/dévirilisation”, en se promenant dans les rues avec des fleurs à la main. A l’heure des actuelles “gay prides”, on peut le considérer comme un précurseur. Ses poses constituent tout un théâtre, assez éloigné, finalement, de ce sentiment tranquille de supériorité, de dignité virile, de “nil admirari”, du premier Brummell.
Auto-satisfaction et sur-dimensionnement du “moi”
Pour Otto Mann, cette citation de Wilde est emblématique : « Les dieux m’ont presque tout donné. J’avais du génie, un nom illustre, une position sociale élevée, la gloire, l’éclat, l’audace intellectuelle ; j’ai fait de l’art une philosophie et de la philosophie un art; j’ai appris aux hommes à penser autrement et j’ai donné aux choses d’autres couleurs... Tout ce que j’ai touché s’est drapé dans de nouveaux effets de beauté; à la vérité, je me suis attribué, à juste titre, le faux comme domaine et j’ai démontré que le faux, tout comme le vrai, n’est qu’une simple forme d’existence postulée par l’intellect. J’ai traité l’art comme la vérité suprême, et la vie comme une branche de la poésie et de la littérature. J’ai éveillé la fantaisie en mon siècle, si bien qu’il a créé, autour de moi, des mythes et des légendes. J’ai résumé tous les systèmes philosophiques en un seul épigramme. Et à côté de tout cela, j’avais encore d’autres atouts». L’auto-satisfaction, le sur-dimensionnement du “moi” sont patents, vont jusqu’à la mystification.
Ces exagérations iront croissant, même dans l’orbite de cette virilité stoïque, chère à Montherlant. Celui-ci, à son tour, exagère dans les poses qu’il prend, en pratiquant une tauromachie fort ostentatoire ou en se faisant photographier, paré du masque d’un empereur romain. Le risque est de voir des adeptes minables verser dans un “lookisme” tapageur et de mauvais goût, de formaliser à l’extrême ces attitudes ou ces postures du poète ou de l’écrivain. En aucun cas, elles n’apportent une solution au phénomène de la décadence. En matière de dandysme, la seule issue est de revenir calmement à Brummell lui-même, avant qu’il ne sombre dans les déboires financiers. Car ce retour au premier Brummell équivaut, si l’on se souvient des exhortations antérieures d’Addison et Steele, à une forme plus moderne, plus civile et peut-être plus triviale de paideia ou d’humanitas. Mais, trivialité ou non, ces valeurs seraient ainsi maintenues, continueraient à exister et à façonner les esprits. Ce mixte de bon sens et d’esthétique dandy permettrait de dégager un objectif politique pratique : défendre l’école au sens classique du terme, augmenter sa capacité à transmettreles legs de l’antiquité hellénique et romaine, prévoir une pédagogie nouvelle et efficace, qui serait un mixte d’idéalisme à la Schiller, de méthodes traditionnelles et de méthodes inspirées par Pestalozzi.
Retour à la religion ou “conscience malheureuse”?
La figure du dandy doit donc être replacée dans le contexte du 18ième siècle, où les idéaux et les modèles classiques de l’Europe traditionnelle s’érodent et disparaissent sous les coups d’une modernité équarissante et arasante. Les substances religieuses, chrétiennes ou pré-chrétiennes sous vernis chrétien, se vident et s’épuisent. Les Modernes prennent le pas sur les Anciens. Ce processus conduit forcément à une crise existentielle au sein de l’écoumène civilisationnel européen. Deux pistes s’offrent à ceux qui tentent d’échapper à ce triste destin : 1) Le retour à la religion, ou à la tradition, piste importante mais qui n’est pas notre propos aujourd’hui, tant elle représente un continent de la pensée, fort vaste, méritant un séminaire complet à elle seule. 2) Cultiver ce que les romantiques appelaient la Weltschmerz, la douleur que suscitait ce monde désenchanté, ce qui revient à camper sur une position critique permanente à l’endroit des manifestations de la modernité, à développer une conscience malheureuse, génératrice d’une culture volontairement en marge, mais où l’esprit politiquepeut puiser des thématiques offensives et contestatrices.
Pour le dandy et le romantique, qui oscille entre le retour à la religion et le sentiment de Weltschmerz, cette dernière est surtout ressentie de l’intérieur. C’est dans l’intériorité du poète ou de l’artiste que ce sentiment va mûrir, s’accroître, se développer. Jusqu’au point de devenir dur, de dompter le regard et d’éviter ainsi les langueurs ou les colères suscitées par la conscience malheureuse. En bout de course, le dandy doit devenir un observateur froid et impartial, qui a dominé ses sentiments et ses émotions. Si le sang a bouillonné face aux “horreurs économiques”, il doit rapidement se refroidir, conduire à l’impassibilité, pour pouvoir les affronter efficacement. Le dandy, qui a subi ce processus, atteint ainsi une double impassibilité : rien d’extérieur ne peut plus l’ébranler; mais aucune émotion intérieure non plus. Pierre Drieu La Rochelle ne parviendra jamais à un tel équilibre, ce qui donne une touche très particulière et très séduisante à son œuvre, tout simplement parce qu’elle nous dévoile ce processus, en train de se réaliser, vaille que vaille, avec des ressacs, des enlisements et des avancées. Drieu souffre du monde, s’essaie aux avant-gardes, est séduit par la discipline et les aspects “métalliques” du fascisme “immense et rouge”, en marche à son époque, accepte mentalement la même discipline chez les communistes et les staliniens, mais n’arrive pas vraiment à devenir un “observateur froid et impartial” (Benjamin Constant). L’œuvre de Drieu La Rochelle est justement immortelle parce qu’elle révèle cette tension permanente, cette crainte de retomber dans les ornières d’une émotion inféconde, cette joie de voir des sorties vigoureuses hors des torpeurs modernes, comme le fascisme, ou la gouaille d’un Doriot.
Blinder le mental et le caractère
En résumé, le processus de deconstruction des idéaux de la paideia antique, et de déliquescence des substantialités religieuses immémoriales, qui s’amorce à la fin du 18ième siècle, équivaut à une crise existentielle généralisée à tous les pays occidentaux. La réponse de l’intelligence à cette crise est double : ou bien elle appelle un retour à la religion ou bien elle suscite, au fond des âmes, une douleur profondément ancrée, la fameuse Weltschmerz des romantiques. La Weltschmerz se ressent dans l’intériorité profonde de l’homme qui fait face à cette crise, mais c’est aussi dans son intériorité qu’il travaille silencieusement à dépasser cette douleur, à en faire le matériel premier pour forger la réponse et l’alternative à cette épouvantable déperdition de substantialité, surplombée par un économicisme délétère. Il faut donc se blinder le mental et le caractère, face aux affres qu’implique la déperdition de substantialité, sans pour autant inventer de toutes pièces des Ersätze plus ou moins boîteux à la substantialité de jadis. Baudelaire et Wilde pensent, tous deux à leur manière, que l’art va offrir une alternative, plus souple et plus mouvante que les anciennes substantialités, ce qui est quasiment exact sur toute la ligne, mais, dans ce cas, l’art ne doit pas être entendu comme simple esthétisme. Le blindage du mental et du caractère doit servir, in fine, à combattre l’économicisme ambiant, à lutter contre ceux qui l’incarnent, l’acceptent et mettent leurs énergies à son service. Ce blindage doit servir de socle moral et psychologique dur aux idéaux de combat politique et métapolique. Ce blindage doit être la carapace de ce qu’Evola appelait l’«homme différencié», celui qui “chevauche le tigre”, qui erre, imperturbé et imperturbable, “au milieu des ruines”, ou que Jünger désignait sous le vocable d’«anarque». “L’homme différencié qui chevauche le tigre au milieu des ruines” ou “l’anarque” sont posés d’emblée comme des observateurs froids, impartiaux, impassibles. Ces hommes différenciés, blindés, se sont hissés au-dessus de deux catégories d’obstacles : les obstacles extérieurs et les obstacles générés par leur propre intériorité. C’est-à-dire les barrages dressés par les “hommes de moindre valeur” et les alanguissements de l’âme en détresse.
Figures tchandaliennes de la décadence
La crise existentielle, qui débute vers le milieu du 18ième siècle, débouche donc sur un nihilisme, très judicieusement défini par Nietzsche comme un “épuisement de la vie”, comme “une dévalorisation des plus hautes valeurs”, qui s’exprime souvent par une agitation frénétique sans capacité de jouir royalement de l’otium, agitation qui accélère le processus d’épuisement. La mise en schémas de l’existence est l’indice patent que nos “sociétés”ne forment plus des “corps”, mais constituent, dit Nietzsche, des “conglomérats de Tchandalas”, chez qui s’accumulent les maladies nerveuses et psychiques, signe que la puissance défensive des fortes natures n’est plus qu’un souvenir. C’est justement cette “puissance défensive” que l’homme “différencié” doit, au bout de sa démarche, de sa quête dans les arcanes des traditions, reconstituer en lui. Nietzsche énumère très clairement les vices du Tchandala, figure emblématique de la décadence européenne, issue de la crise existentielle et du nihilisme: le Tchandala est affecté de pathologies diverses, sur fond d’une augmentation de la criminalité, de célibat généralisée et de stérilité voulue, d’hystérie, d’affaiblissement constant de la volonté, d’alcoolisme (et de toxicomanies diverses ajouterions-nous), de doute systématique, d’une destruction méthodique et acharnée des résidus de force. Parmi les figures tchandaliennes de cette décadence et de ce nihilisme, Nietzsche compte ceux qu’il appelle les “nomades étatiques” (Staatsnomaden) que sont les fonctionnaires, sans patrie réelle, serviteurs du “monstre froid”, au mental mis en schémas et, subséquemment, générateurs de toujours davantage de schémas, dont l’existence parasitaire engendre, par leur effroyable pesanteur en progression constante, le déclin des familles, dans un environnement fait de diversités contradictoires et émiettées, où l’on trouve
- le “disciplinage” (Züchtung) des caractères pour servir les abstractions du monstre froid,
- la lubricité généralisée comme forme de nervosité et comme expression d’un besoin insatiable et compensatoire de stimuli et d’excitations,
- les névroses en tous genres,
- les fascinations morbides pour les mécanismes et pour les enchaînements, limités, de sèches causalités sans levain,
- le présentisme politique (Augenblickdienerei) où ne dominent plus, souverainement, ni longue mémoire ni perspectives profondes ni sens naturel et instinctif du bon droit,
- le sensibilisme pathologique,
- les doutes inféconds procédant d’un effroi morbide face aux forces impassables qui ont fait et feront encore l’histoire-puissance,
- une peur d’arraisonner le réel, de saisir les choses tangibles de ce monde.
Victor Segalen en Océanie, Ernst Jünger en Afrique
Dans ce complexe de froideur, d’immobilisme agité, de frénésies infécondes, de névroses, une première réponse au nihilisme est d’exalter et de concrétiser le principe de l’aventure, où le contestataire quittera le monde bourgeois tissé d’artifices, pour s’en aller vers des espaces vierges, intacts, authentiques, ouverts, mystérieux. Gauguin part pour les îles du Pacifique. Victor Segalen, à sa suite, chante l’Océanie primordiale et la Chine impériale qui se meurt sous les coups de l’occidentalisme. Segalen demeure breton, opère ce qu’il appelait le “retour à l’os ancestral”, dénonce l’envahissement de Tahiti par les “romances américaines”, ces “parasites immondes”, rédige un “Essai sur l’exotisme” et “Une esthétique du divers”. Le rejet des brics et brocs sans passé profond ont valu à Segalen un ostracisme injustifié dans sa patrie : il reste un auteur à redécouvrir, dans la perspective qui est nôtre.
Le jeune Jünger, encore adolescent, rêve de l’Afrique, du continent où vivent les éléphants et d’autres animaux fabuleux, où les espaces et les paysages ne sont pas meurtris par l’industrialisation, où la nature et les peuples indigènes ont conservé une formidable virginité, permettant encore tous les possibles. Le jeune Jünger s’engage dans la Légion Etrangère pour concrétiser ce rêve, pour pouvoir débarquer dans ce continent nouveau, perclus de mystères et de vitalité. 1914 lui donnera, à lui et à toute sa génération, l’occasion de sortir d’une existence alanguissante. Dans la même veine, Drieu La Rochelle parlera de l’élan de Charleroi. Et plus tard, Malraux, de “Voie Royale”. A “gauche” (pour autant que cette dichotomie politicienne ait un sens), on parlera plutôt d’ “engagement”, où ce même enthousiasme se retrouvera surtout lors de la Guerre d’Espagne, où Hemingway, Orwell, Koestler, Simone Weil s’engageront dans le camp des Républicains, et Campbell dans le camp des Nationalistes, qui fut aussi, comme on le sait, chanté par Robert Brasillach. L’aventure et l’engagement, dans l’uniforme du soldat ou des milices phalangistes, dans les rangs des brigades internationales ou des partisans, sont perçus comme antidotes à l’hyperformalisme d’une vie civile sans couleurs. “I was tired of civilian life, therefore I joined the IRA”), est-il dit dans un chant nationaliste irlandais, qui, dans son contexte particulier, proclame, avec une musique primesautière, cette grande envolée existentialiste du début du 20ième siècle avec toute la désinvolture, la verdeur, le rythme et la gouaille de la Verte Eirinn.
Ivresses? Drogues? Amoralisme?
Mais si l’engagement politique ou militaire procure, à ceux que le formalisme d’une vie civile, sans plus aucun relief ni équilibre traditionnel, ennuie, le supplément d’âme recherché, le rejet de tout formalisme peut conduire à d’autres attitudes, moins positives. Le dandy, qui quitte la pose équilibrée de Brummell ou la critique bien ciselée de Baudelaire, va vouloir expérimenter toujours davantage d’excitations, pour le seul plaisir stérile d’en éprouver. La drogue, la toxicomanie, la consommation exagérée d’alcools vont constituer des échappatoires possibles: la figure romanesque créée par Huysmans, Des Esseintes, fuira dans les liqueurs. Thomas De Quincey évoquera les “mangeurs d’opium” (“The Opiumeaters”). Baudelaire lui-même goûtera l’opium et le haschisch. Ce basculement dans les toxicomanies s’explique par la fermeture du monde, après la colonisation de l’Afrique et d’autres espaces jugés vierges; l’aventure réelle, dangereuse, n’y est plus possible. La guerre, expérimentée par Jünger, quasi en même temps que les “drogues et les ivresses”, cesse d’attirer car la figure du guerrier devient un anachronisme quand les guerres se professionnalisent, se mécanisent et se technicisent à outrance.
Autre échappatoire sans aucune positivité : l’amoralisme et l’anti-moralisme. Oscar Wilde fréquentera des bars louches, exhibera de manière très ostentatoire son homosexualité. Son personnage Dorian Gray devient criminel, afin de transgresser toujours davantage ce qui a déjà été transgressé, avec une sorte d’hybris pitoyable. On se souviendra de la fin pénible de Montherlant et on gardera en mémoire l’héritage douteux que véhicule encore aujourd’hui son exécuteur testamentaire, Gabriel Matzneff, dont le style littéraire est certes fort brillant mais dans le sillage duquel de bien tristes scénarios se déroulent, montés en catimini, dans des cercles fermés et d’autant plus pervers et ridicules que la révolution sexuelle des années 60 permet tout de même de goûter sans moralisme étriqué à beaucoup de voluptés gaillardes et goliardes. Ces drogues, transgressions et sexomanies bouffonnes constituent autant d’apories, de culs-de-sac existentiels où aboutissent lamentablement quelques détraqués, en quête d’un “supplément d’âme”, qu’ils veulent “transgresseur”, mais qui, pour l’observateur ironique, n’est rien d’autre que le triste indice d’une vie ratée, d’une absence de grand élan véritable, de frustrations sexuelles dues à des défauts ou des infirmités physiques. Décidément, ne “chevauche pas le Tirgre” qui veut et on ne voit pas très bien quel “Tigre” il y a à chevaucher dans les salons où le vieux beau Matzneff laisse quelques miettes de ses agapes sexuelles à ses admirateurs un peu torves...
Ascèse religieuse
L’alternative véritable, face au monde bourgeois, des “petits jobs” et des “petits calculs”, moqués par Hannah Arendt, dans un monde désormais fermé, où aventures et découvertes ne sont plus que répétitions, où la guerre est “high tech” et non plus chevaleresque, réside dans l’ascèse religieuse, dans un certain retour au monachisme de méditation, dans le recours aux traditions (Evola, Guénon, Schuon). Drieu la Rochelle évoque cette piste dans son “Journal”, après ses déceptions politiques, et rend compte de sa lecture de Guénon. Les frères Schuon sont exemplaires à ce titre : Frithjof part à la Légion Etrangère, arpente le Sahara, fait connaissance avec les soufis et les marabouts du désert ou de l’Atlas, adhère à une mystique soufie islamisée, part ensuite dans les réserves de Sioux aux Etats-Unis, laisse une œuvre picturale étonnante et époustouflante. Son frère, nommé le “Père Galle”, arpente les réserve améridiennes d’Amérique du Nord, traduit les évangiles en langue sioux, se retire dans une trappe wallonne, y dresse des jeunes chevaux à la mode indienne, y rencontre Hergé et se lie d’amitié avec lui. Des existences qui prouvent que l’aventure et l’évasion totale hors du monde frelaté de l’occidentisme (Zinoviev) demeure possible et féconde.
Car la rébellion est légitime, si elle ne bascule pas dans les apories ou ne débouche pas sur un satanisme de mauvais aloi, comme dans certaines sectes néo-païennes, plus ou moins inspirées par les faits et gestes d’un Alistair Crowley. Ce dérapage s’explique : la rébellion, faute de cause, devient hélas service à Satan, lorsque le mal en soi —ou ce qui passe pour le “mal en soi”— est devenu l’excitation existentielle considérée comme la plus osée. Dans un monde désenchanté, comme le nôtre, livré aux plaisirs stupides et passifs fournis par les médias, ce satanisme, avec son cortège sinistre de gesticulations absurdes et infécondes, séduit des esprits faibles, comme ceux qui traînent, par puritanisme mal digéré et mal surmonté, dans les salons où agit Matzneff et “passivent” ses voyeurs d’admirateurs. Ce n’est en tout cas pas l’attitude que souhaitait généraliser Brummell.
Robert STEUCKERS,
Forest/Flotzenberg, Vlotho im Weserbergland, mai 2001.
Note:
(*) : Otto MANN, “Dandysmus als konservative Lebensform” in: Gerd-Klaus KALTENBRUNNER (Hrsg.), Konservatismus International, Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, ISBN 3-51200327-3, pp.156-170.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, lettres allemandes, lettres anglaises, synergies européennes, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 septembre 2008
Hermann Hesse: Le jeu des perles de verre
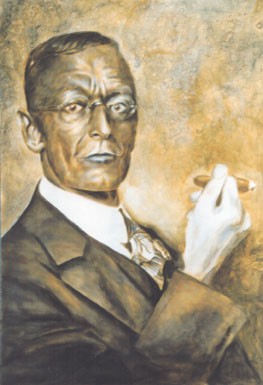
Laurent SCHANG :
HERMANN HESSE (1877-1962): «Le jeu des perles de verre»
Essai de biographie du Magister Ludi Joseph Valet accompagné de ses écrits posthumes
Mis en chantier à l'avènement du IIIième Reich mais édité dans sa version finale en 1943, Le jeu des perles de verre est de l'aveu même de Hermann Hesse le chef-d'œuvre de sa carrière d'écrivain.
Situé à une époque mal définie, estimée à 2500 ans après J.C., «2000 ans après la fondation de l'Ordre de Saint-Benoît et postérieurement à la mort de Pie XV», dans un monde utopique, la Castalie, province pédagogiaque réservée au seul talent et à l'expression élitiste du savoir, le “jeu des perles de verre” est la pierre philosophale qui ouvre l'humanité à un nouveau champ de perception. Alignement de perles multicolores sur un boulier rustique, le Jeu consiste en un système élaboré de combinaisons savantes maniées par une caste d'élus, synthèse suprême des arts et des sciences dont les clefs sont autant d'ouvertures à la catharsis et l'intégration dans le “Grand Tout” chanté par Hermann Hesse. Du monde castalien il dira: «Je n'eus pas besoin de l'inventer ni de le construire: sans que je m'en rendisse compte, il était préfiguré en moi depuis longtemps. Et du même coup j'avais trouvé ce que je cherchais: un lieu où respirer librement» (correspondance-lettre à Rudolf Pannwitz, 1955).
A travers le personnage central du roman, Joseph Valet, Hermann Hesse invite le lecteur à le suivre dans son initiation de jeune promu aux plus hautes responsabilités de l'Ordre, jusque son accession à la dernière marche: Maître du Jeu des Perles de Verre. Doté des meilleures dispositions, brillant intellectuel, humaniste raisonné, désintéressé et charismatique, Valet, au terme de sa progression dans les échelons castaliens, se détournera pourtant du pouvoir suprême pour ne plus se consacrer qu'à la méditation solitaire en simple précepteur.
Le jeu des perles de verre est l'occasion pour Hermann Hesse de rappeler les principes essentiels de sa conception de la place de l'Homme dans l'univers, qui le rapproche incontestablement des Ernst Jünger et autres Knut Hamsun, à savoir l'inopérance du pur intellect, le primat de l'âme et de l'irrationnel, la critique de toute collectivité et de l'étatisation des sociétés, l'éternel dilemme nature/culture. Sa quête de la réconciliation du piétisme mystique de son enfance et du rationalisme éclairé de l'Aufklärung s'effectuant sous les auspices des textes bouddhiques, de Lao Tse et de Nietzsche.
Un “Tolstoï” allemand?
Considéré par ses contemporains comme le Tolstoï allemand, précurseur de Kerouac et des écologistes, admiré de Mann, Gide et Rolland, Hermann Hesse, rebelle aristocrate et solitaire retiré dans le Tessin suisse dès avant 1914, a laissé à la postérité une œuvre dense, riche, à l'écriture musicale et au style ciselé où court de pages en pages la critique fondamentale de la société moderne qu'exprime avec le plus d'acuité le renforcement jusque dans les structures sociales les plus privées de la prégnance de l'Etat. De sa méfiance envers une démocratie, «cet Etat inconsistant, vide d'esprit et issu du vide et de l'épuisement qui ont suivi la guerre mondiale», dont il ne perçoit la déviance totalitaire —à l'instar de son compatriote Ernst von Salomon— qu'en tant que son expression la plus aboutie, prendra progressivement forme la Castalie.
Mais l'exemplarité du Jeu ne provient pas tant de son alternative que de la profonde sincérité de Hesse, qui dans son scepticisme rigoureux, se défie de son propre idéalisme et conserve à l'égard de sa création une position distante, n'omettant pas, après exposition des qualités de l'institution de Celle-les-Bois, d'en mentionner les tares inhérentes à tout corps administrativement constitué, mécanique bureaucratique parfaitement huilée qui, fonctionnant en roue libre, court le risque fatal de s'enliser dans sa routine scientifique, poussiéreuse et déshumanisante.
Moins sombre que George Orwell et Aldous Huxley mais davantage perspicace que Thomas More, Hesse, en orientaliste distingué, ne sépare jamais le yin du yang. Son Jeu des perles de verre vient ainsi parachever une vie de labeur littéraire où perce une image originale de la société occidentale, pour laquelle ses mots ne sont jamais assez durs: «La “société”, laquelle n'a plus qu'un semblant d'existence depuis que notre humanité s'est ou bien transformée en une masse uniforme et sans visage, ou bien fragmentée en des milliers d'individus isolés que rien ne rattache plus les uns aux autres, .sauf la peur de l'avenir et le regret du passé».
“Réfractaire au “tu dois”» selon la formule de Linda Lê, lecteur de Schopenhauer, Dostoïevski mais aussi Spengler, Klages ou encore Keyserling, le chemin vers les étoiles de Hermann Hesse est celui de la quête de toute une vie d'une spiritualité différente, éloignée de tous les dogmes incapacitants, ultime résonance d'un Age d'Or oublié. «...Je n'accorde qu'une place restreinte au temporel dans le compartiment supérieur de mes pensées», «il m'est impossible de vivre sans témoigner de la vénération à quelque chose, sans consacrer ma vie à un dieu», «Je n'ai jamais vécu sans religion et ne pourrais vivre un seul jour sans religion mais je m'en suis tiré pendant toute ma vie sans Eglise» (Mein Glaube).
Apoliteia
De nature rebelle, sa détestation de la bourgeoise Allemagne wilhelminienne le confirme dans sa soif de solitude et sa conscience d'artiste, si magistralement rendues dans sa nouvelle Le Choucas, extraite du recueil Souvenirs d'un Européen, où l'oiseau n'est autre que son double animalier: «Il vivait seul, n'appartenait à aucune communauté, n'obeissait à aucune coutume, à aucun ordre, à aucune loi (...) Bouffon pour les uns, obscur avertissement pour les autres (...)». Imprégné de l'idée du cycle naturel et cosmique, il se fait prophète, un demi-siecle avant Guénon et Evola, du Kali-Yuga, équivalent indien de l'Apocalypse dont il pressent tous les signes annonciateurs dans la décadence de l'Occident. En 1926, Hesse, répondant à une sollicitation de l'Ostwart-Jahrbuch, leur écrit: «J'estime que notre tâche est de consommer notre ruine et non pas de proposer pour modèles des œuvres et des discours dans lesquels nous tenterions de sauver quelque reste de la culture agonisante (...). Notre devoir est de disparaître dans les profondeurs, de nous en remettre à la nécessité et non pas d'en tirer des commentaires ingénieux. La façon dont Nietzsche, des dizaines d'années avant tous, a suivi le rude et solitaire chemin de l'abîme constitue un véritable exploit».
Apoliteia convaincu, opposant au titre d'“écrivain engagé” alors si abondamment représenté de par l'Europe (citons pour l'exemple Mann, Drieu, Malraux, Aragon, Shaw et Brecht) celui d'“auteur dégagé”, c'est dans le Moyen-Age, un Moyen-Age enchanteur et mythologique, et l'Orient, un Orient de lecture et de méditation, que Hesse puise l'essence de son art, et son attitude, toute de hauteur d'esprit et d'humilité, pourrait se résumer par ce livre de Romain Rolland: Au-dessus de la mêlée.
Ses ouvrages, du premier, Peter Camenzind, écrit en 1903, évocation de la communion intime de l'homme et de la nature accueillante une fois libérée du poids de la civilisation, à Siddharta en 1922, où Hesse expose toute sa passion pour l'hindouisme, sont un pas supplémentaire franchi dans l'élaboration progressive de sa foi profonde et intime. Anticipant sur le personnalisme d'Emmanuel Mounier, Hesse, dans une lettre envoyée à un admirateur, précise: «Chacun de vous doit tirer au clair la nature de sa propre personnalité, de ses dons, de ses possibilités et de ses particularités, il doit consacrer sa vie à se perfectionner moralement et à devenir ce qu'il est. Si nous accomplissons cette tâche, nous servons en même temps la cause de l'humanité (...) l'“indiviclualisme”, si souvent décrié, devient le serviteur de la communauté et perd le caractère odieux de l'égoïsme». Son roman le plus fameux, Le Loup des Steppes (l927), tirera toute sa substance de cette profession de foi.
Sollicité de toutes parts, collaborant a moultes revues littéraires, partageant son temps entre l'écriture et la peinture, c'est dans l'art et la culture que Hesse discernera finalement la dernière, et peut-être la seule trace de Dieu sur Terre, expression la plus pure et parfaite de la part de génie qui réside en tout homme, dès lors que celui-ci est à même de se développer en harmonie avec l'Univers, Alpha et Omega de son maître-roman, Le Jeu des perles de verre.
Laurent SCHANG.
indices bibliographiques:
- Le Jeu des Perles de Verre, Calmann-Lévy, 1996.
- Lettres (1900-1962), Calmann-Lévy, 1981.
- Souvenirs d'un Européen, Livre de Poche, 1994.
00:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, allemagne, hermann hesse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



